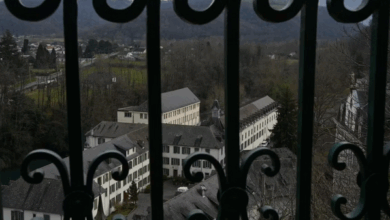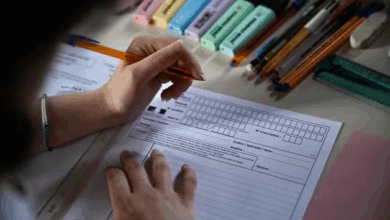– Il y a six ans, Edith (les interlocuteurs cités par leur prénom ont requis l’anonymat) est devenue la « maman » d’Eliora. C’est ainsi que l’adolescente appelle celle qui est sa grand-tante, et chez laquelle elle vit depuis ses 7 ans. « La vie de sa mère – ma nièce – était difficile, raconte Edith, blanchisseuse de 52 ans, employée dans une grande maison de Lomé, la capitale du Togo. Elle avait quatre enfants, pas de travail solide et le père était parti. Moi, j’affectionnais beaucoup la petite et j’avais les moyens de m’en occuper. »
Aujourd’hui, Eliora passe toujours quelques week-ends et des vacances chez sa génitrice qu’elle surnomme « [s]a grande sœur ». « Mais c’est moi qui assure ses besoins matériels et, sur presque tous les sujets, je me sens libre de l’élever comme je veux », confie Edith. Récemment, Eliora a pris un taxi moto sans sa permission. Un écart de conduite qui lui a valu une bonne correction à la chicote (une sorte de fouet). « Nous sommes très liées mais si ça déraille, je tape dur », assume la lingère.
Cette délégation de l’autorité parentale n’a rien d’exceptionnel au Togo. Dans ce petit pays d’Afrique de l’Ouest, la famille se comprend au sens large. Les cousins sont comme des frères et les enfants appartiennent à toute la communauté. Un collectif au sein duquel les oncles et tantes occupent un statut particulier. « Ils sont considérés à l’égal des parents biologiques, voire comme plus importants », résume la sociologue Ayawavi Sitsopé Toudeka, chercheuse à l’université de Lomé. Leur assentiment est requis lors des grands rites de la vie – choix du prénom, mariage, héritage, etc. –, et on trouve naturel qu’ils participent à l’éducation. Voire qu’ils se substituent, dans certaines circonstances, aux vrais parents.
Solidarité familiale
« Cela peut être pour des soucis de comportement : l’enfant est alors parfois confié à un oncle qui devra lui inculquer les règles avec plus de rigueur, détaille Ayawavi Sitsopé Toudeka. Ou encore pour être soulagé sur le plan matériel. Surtout quand un membre de la famille a réussi : on attend qu’il prête main-forte aux autres. » Un système de solidarité permettant de pallier la faiblesse des filets sociaux, dans un pays à l’économie fragile. Et fondé sur la conviction que les problèmes doivent d’abord se régler au sein du cercle familial, sans l’aide des institutions.
Ainsi, Ayité n’a pas hésité une seconde lorsqu’il a fallu prendre en charge les jumeaux de sa sœur, elle-même incapable de les élever à cause d’un trouble psychiatrique. Sa propre mère s’en est d’abord occupée pendant des années. Lui se trouvait en France depuis la fin de ses études de commerce. « Mais j’ai toujours su que, quand maman ne serait plus là, Laure et Laurent seraient sous ma responsabilité, témoigne avec chaleur cet homme de 38 ans. Même si j’avais ma vie en Vendée, une épouse française, deux enfants et un prêt sur vingt-cinq ans. »
Ce jour a fini par arriver et, le temps de mettre ses affaires en ordre, Ayité est reparti avec sa famille à Lomé. Depuis cinq ans, les jumeaux vivent sous son toit. Ils ont maintenant 20 ans et vont à l’université. Mais le « tonton-papa », comme il se définit, compte subvenir à leurs besoins jusqu’à ce qu’ils aient trouvé leur place dans la société. « Quand on a les moyens, cela ne se discute pas, explique cet entrepreneur, qui dirige une société de livraison de colis. Je n’aimerais pas qu’on dise à propos de moi : “Dieu l’a béni et il n’a pas distribué”. »
Source :
Diffusion partielle ou totale interdite sans la mention : Source www.kassataya.com