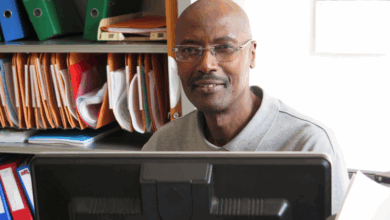Il est des moments où le destin intellectuel d’une nation prend la forme d’une cristallisation soudaine.
Deux textes, deux gestes souverains — la lettre historique rédigée par Mohamed Aly Chérif à Léopold Sédar Senghor sur la souveraineté fluviale, et la plaidoirie magistrale de Mohamed Ould Maouloud Ould Daddah à La Haye sur le conflit du Sahara occidental — ont récemment ressurgi de la mémoire collective. Deux actes d’intellect, deux fulgurances d’un génie mauritanien en habit diplomatique et en verbe savant.
Mais comme souvent dans les nations en gestation perpétuelle, la réception de ces chefs-d’œuvre fut marquée moins par l’élévation du débat que par le glissement vers des recoins anecdotiques, comme si l’audace du fond terrorisait ceux qui ne savent lire qu’en surface. À peine ces textes publiés, les réactions se sont succédé, certaines brillantes, d’autres troublantes, plusieurs allant jusqu’à exiler le débat de son terrain pour le noyer dans les marécages du soupçon, du ressentiment ou de l’ignorance feinte.
C’est dans ce vacarme que ressurgit, telle une lumière venue d’un temps plus sage, la pensée de Jemal Ould El Hassen, ce maître discret du verbe oral, cet artisan d’idées que la nation n’a pas su suffisamment écouter. Dans un exposé oral improvisé mais lumineux, prononcé à la Maison des Jeunes il y a plusieurs décennies, il formulait ce que seuls les grands penseurs osent poser : la primauté des idées structurantes sur les détails circonstanciels.
Il n’appelait pas à l’indifférence face aux faits, mais à leur relecture verticale, à leur intégration dans une pensée de la totalité. Car ce qui est en jeu, disait-il, ce ne sont pas les anecdotes de surface, mais le soubassement de nos fractures.
Avec un sens profond de la dialectique, Jemal posait une question fondatrice : sommes-nous en rupture, ou simplement en dispersion ?
Deux concepts qu’il distingue avec finesse. La rupture suppose une ligne continue que l’on brise. La dispersion, elle, suppose des parallélismes sans croisement, des bifurcations nées sans guerre ni rupture, mais qui finissent par rendre toute unité impensable. Autrement dit, deux consciences culturelles peuvent habiter le même espace-temps sans jamais se rencontrer.
À travers cette lecture, Jemal démonte l’idée paresseuse d’un conflit entre générations. Il récuse la tentation de faire de l’âge un critère de clivage. Pour lui, un jeune homme peut porter la sagesse des anciens, et un vieillard céder à l’hystérie des temps modernes. Ce qui distingue les êtres, c’est la matrice culturelle dans laquelle leur esprit a été fécondé.
À l’issue de son analyse, Jemal révèle le cœur du mal : un duel latent entre deux modèles de civilisation.
Le premier est endogène, historique, né dans les mahadras, nourri au lait du désert, poli par le vent du Chinguiti, forgé dans le compagnonnage avec l’austérité et la foi.
Le second est exogène, importé sous la contrainte, imposé par les institutions coloniales, nourri d’une épistémè étrangère et qui ne partage avec le peuple qu’un contrat de domination.
Mais là où certains parleraient de simple acculturation ou de colonisation mentale, Jemal voit un véritable conflit épistémologique, un affrontement entre deux visions du monde, entre deux façons de parler, de penser, d’aimer et de transmettre.
Et il insiste : il ne s’agit pas d’une rupture désincarnée, mais d’une guerre de position dans laquelle la culture dominée a développé des formes subtiles de résistance, souvent silencieuses, mais tenaces, portées par la poésie, par le rite, par la survivance d’un lexique que l’école moderne n’a jamais pu effacer.
Et voici que l’intuition de Jemal prend tout son sens aujourd’hui.
À l’heure où des débats de haute portée comme la lettre à Senghor ou la plaidoirie de La Haye ressurgissent, l’obsession du fragmentaire et la crispation sur les auteurs, les origines ou les nuances marginales des textes l’emportent sur l’essentiel.
Or, ce qui aurait dû être lu comme l’expression d’une mémoire nationale portée par des génies singuliers, est parfois réduit à une querelle d’attributions ou de filiations doctrinales. C’est la victoire du commentaire sur l’idée, du soupçon sur le style, de la réaction sur la réflexion.
Le legs de Jemal Ould El Hassen, encore trop peu exploré, nous invite à retrouver le goût des grandes lectures.
À dépasser les clivages de circonstance.
À comprendre que le savoir est un fleuve, parfois souterrain, parfois en crue, mais toujours là, pourvu qu’on sache en entendre le chant profond sous le sable.
Il nous tend une boussole pour naviguer dans notre pluralité sans sombrer dans l’éparpillement :
Non pas l’uniformité,
Non pas la nostalgie,
Mais une lucidité radicale sur les forces qui nous traversent, et une volonté ferme de bâtir à partir de ce que nous sommes, non de ce qu’on a voulu faire de nous.
L’heure est venue d’écouter Jemal. Non pour célébrer un passé figé, mais pour réconcilier nos intelligences dispersées, et rendre au débat mauritanien la verticalité qui seule honore les peuples grands.
Mohamed Ould Echriv Echriv
Les opinions exprimées dans cette rubrique n’engagent que leurs auteurs. Elles ne reflètent en aucune manière la position de www.kassataya.com
Diffusion partielle ou totale interdite sans la mention : Source www.kassataya.com