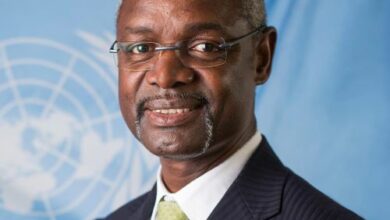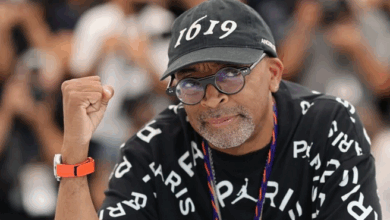– Mariane Ibrahim déteste l’adjectif « météorique », pour avoir trop souvent lu et entendu qu’elle est apparue dans l’art contemporain telle un météore. Il est vrai qu’elle est allée vite. Il lui a suffi d’une décennie pour s’imposer et disposer de trois galeries, à Chicago (Etats-Unis), à Mexico et, désormais, à Paris, avenue Matignon, dans le 8e arrondissement. Mais, plaisante-t-elle : « Une météorite, ça tombe, et je n’ai pas l’intention de tomber. » Ce qu’elle veut, c’est poursuivre son action pour les artistes afro-descendants, qu’elle considère, très justement, avoir été ignorés au XXe siècle et être encore aujourd’hui sous-représentés. « A l’origine de mon travail, il y a la frustration. Je n’étais pas prédestinée à devenir ce que je suis. »
C’est un euphémisme. Mariane Ibrahim est née à Nouméa, en Nouvelle-Calédonie, de parents somaliens. Son père a été marin, fait plusieurs fois le tour du monde, vécu à Dunkerque (Nord) et à Marseille. « Un ami lui a dit qu’en Nouvelle-Calédonie il y avait du travail, le nickel. Il a pensé que ce serait le bon endroit pour se poser. » De passage à Djibouti, sur sa route, il rencontre celle qui devient son épouse. Ils ont quatre enfants, elle est la deuxième. « En 1988, ma mère a eu le mal du pays. Nous sommes partis pour la Somalie. Mais la situation s’y gâtait déjà, et nous sommes arrivés à Bordeaux. Là, la question de savoir qui j’étais est devenue compliquée. »
A cette époque, son prénom s’écrit comme son père l’a voulu, avec deux « N », prénom français par excellence. « Avec “Ibrahim” pour suivre, ça faisait bizarre. Parce que “Ibrahim”, ce n’est pas très français… » Alors qu’elle n’a que 8 ans, elle décide de se faire appeler Mariane, afin, dit-elle, de « mieux concilier tout ce qu’il y a en [elle] ». Tout : l’Afrique de ses aïeux, l’Océanie de son enfance, la France de sa jeunesse. « Quand mes parents me conduisaient dans les musées, j’avais la sensation que ce qui me représentait le mieux, c’était l’Afrique. Je voulais garder un lien avec elle, mais je ne savais comment. »
Marketing numérique
Après des études de communication et de marketing au Royaume-Uni et au Canada, elle devient l’une des premières virtuoses d’un exercice qui n’est alors pas aussi répandu qu’aujourd’hui : le marketing numérique. Simultanément, elle fait « un peu de photographie ».
« Tout doucement », elle entre dans le monde de l’art actuel. « J’ai découvert ce qu’était une galerie. Je n’en avais jamais entendu parler avant. Je découvre les foires, et je m’aperçois que le milieu de l’art est d’abord un milieu de pouvoir. Et je constate l’absence des artistes d’origine africaine. » En ces premières années du XXIe siècle, l’une des rares exceptions, ce sont les photographes de Bamako. Un autoportrait de Seydou Keïta (1921-2001), tenant une fleur, la frappe : « C’était enfin une image qui avait quelque chose de familier pour moi. » Cette découverte la conduit vers d’autres photographes, Malick Sidibé (1935-2016), le Camerouno-Nigérian Samuel Fosso.
Elle vit alors à Seattle (Etat de Washington), où elle a suivi son compagnon, ingénieur chez Boeing, et travaille toujours dans le marketing. « Comme j’étais naïve, j’ai entrepris de convaincre des galeries d’exposer Sidibé. Je n’ai obtenu que des refus. Et j’ai décidé de faire le travail moi-même, en me disant que si je ne le faisais pas, personne ne le ferait. »
Elle lâche photo et marketing, trouve en deux jours un local et ouvre, en 2012, sa première exposition, avec des tirages de Sidibé. Elle appelle la galerie « M.I.A. », sigle de son nom complet, Mariane Ibrahim Abdi. « Mais ça peut aussi être missing in America [“disparu en Amérique”] ou missing in action [“porté disparu”]… Et ça me plaisait bien. »
Elle obtient un premier article dans le Seattle Times, l’exposition se passe bien. « Mais je me suis vite rendu compte que ce serait difficile. J’étais toute seule et je faisais tout, la comptabilité et le ménage, les accrochages et la communication. Je n’avais aucune expérience, pas de mentor. Je passais des journées sans voir personne dans la galerie, sur mon ordinateur, à chercher des contacts. Et Seattle, c’est loin des centres artistiques. »
Source :
Diffusion partielle ou totale interdite sans la mention : Source www.kassataya.com