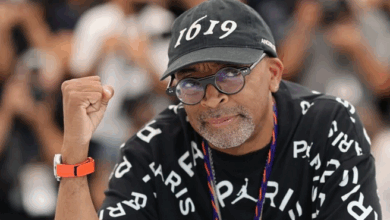– « Le 20 juillet 2023, j’atterris dans un foyer d’accueil à Briançon [Hautes-Alpes], après avoir traversé la frontière italienne : on nous distribue des vêtements trop grands, de la nourriture et, surtout, un billet de train pour Paris. “Là-bas, la vie est rude… Tu ne veux pas être transféré à Marseille ?”, me demande une bénévole. “Pas question !” A l’époque, la France se résume pour moi à deux choses : le Paris Saint-Germain et la tour Eiffel ! Alors, direction la capitale.
Ma première nuit dehors se passe au milieu des courants d’air, à la gare d’Austerlitz. Je suis tout seul, pourtant je n’ai pas peur. Allongé sur le sol, je serre mon sac à dos contre moi, j’écoute le grondement des trains. J’imagine mon futur : je vais apprendre la plomberie à Paris, métier que mon cousin m’a enseigné en Guinée, et, un jour, j’aiderai ma mère restée au pays avec mes trois frères et sœurs.
Le lendemain, je rassemble mes affaires et me dirige vers l’accueil des mineurs non accompagnés, à Tolbiac. C’est ici qu’est évaluée la minorité des jeunes exilés qui se présentent au guichet. Pas le choix : sans reconnaissance officielle de ma minorité, pas d’hébergement, pas de protection. Dans le métro, je découvre un tourbillon de mouvements et de bruits : les claquements des talons dans les couloirs, les annonces incompréhensibles, les sonneries bruyantes. Tout cela m’inquiète.
Je tends un bout de papier froissé, sur lequel est griffonnée une adresse, à certains passants qui s’arrêtent. Finalement, je monte dans la rame… dans la mauvaise direction. Demi-tour. Quand j’arrive enfin devant le bâtiment, j’ai le cœur qui cogne fort. L’entretien dure une trentaine de minutes : on me pose des questions sur l’âge de mes parents, ma vie en Guinée, mon parcours migratoire… Je ne me souviens plus exactement. Quelques jours plus tard, le verdict tombe : ma minorité est rejetée. Je serre les dents. Là encore, les bénévoles de Briançon m’avaient prévenu : peu de jeunes sont reconnus mineurs du premier coup.
« Le même rêve européen »
Mon papier de refus entre les mains, je vois un bénévole de l’association Utopia 56 s’approcher : “Toi aussi tu as été refusé ? Viens, on va discuter à Hôtel-de-Ville !” En arrivant, je suis frappé par l’immensité du lieu. L’édifice est majestueux, avec des centaines de fenêtres éclairées. Tout autour, des Parisiens pressés, des touristes avec leur appareil photo et, surtout, des jeunes comme moi. Dans le brouhaha, j’entends parler peul, malinké et soussou.
Là, j’intègre un petit groupe de Guinéens, regroupés en cercle. Tous ont quitté leur pays, poussés par le même rêve européen, celui qu’on fantasme sur les réseaux sociaux. Pendant qu’on échange nos premiers ressentis – la tour Eiffel, par exemple, n’est pas aussi belle qu’on l’imaginait –, des bénévoles circulent entre nous. Ils portent des caisses remplies de vêtements et des sacs de chaussures usées. On me tend des couvertures et une tente. Ce soir, je dormirai dans un campement de fortune à deux pas du Centre Pompidou. Mais je ne suis plus seul : j’ai trouvé des nouveaux compagnons de galère !
Nos journées sont rythmées par de longs trajets en métro. On y monte parfois sans but, afin de trouver un peu de chaleur. Dès qu’on voit un contrôleur, il faut courir vite. Il y a aussi les cours de français à Belleville, dispensés par des bénévoles. Et puis la Halte humanitaire, refuge d’un après-midi près de Rivoli, où on peut souffler et recharger nos téléphones. C’est pas grand-chose, mais c’est devenu notre routine. Le soir, j’arrive à 17 heures à l’Hôtel de ville, je discute avec les bénévoles de mon recours auprès du tribunal des enfants, puis je me glisse dans une longue file d’attente devant une marmite fumante. Pommes de terre, soupe, couscous… tout passe, sauf le fromage ! Certains grimacent en découvrant son goût, d’autres le recrachent discrètement derrière eux. Moi, j’ai essayé une fois. Plus jamais. Pour le dîner, on s’installe à même le sol, par petits groupes. Malgré le froid, malgré l’inconfort…
J’adore faire le pitre. On s’amuse à imiter les Parisiens qui courent partout. Fou rire général. Après le repas, on joue au Ludo sur notre téléphone ou on se regroupe devant un match de Ligue 1. On préfère débattre au sujet de Kylian Mbappé ou de Cristiano Ronaldo plutôt que de ressasser les épreuves du voyage. Moi, j’ai mis trois mois avant d’atteindre la France. Mali, Algérie, Tunisie, Italie… Une route éprouvante par la mer et par la terre. Inutile d’en parler.
« Je me bats pour avancer »
En Guinée, mes parents n’avaient pas les moyens de m’offrir un avenir. Ma mère, femme au foyer, s’occupait de nous comme elle pouvait, tandis que mon père, cultivateur de riz, mettait de la nourriture sur la table. Il est mort en 2019. Faute d’argent, l’école n’a jamais été une option pour moi. J’ai grandi dans la rue, entre les parties de football improvisées avec mes amis et les journées passées avec mon oncle, chauffeur de profession.
C’est lui qui m’a proposé de m’emmener en Europe et de prendre en charge mon trajet. Ma mère a accepté. Je revois son regard inquiet au moment du départ. “Fais attention”, m’a-t-elle murmuré. Une fois arrivé en France, je n’ai pas eu le courage de lui dire la vérité. Comment avouer à ma mère que je dormais sur un trottoir à Paris, après des semaines passées sur la route ? J’ai préféré tout garder pour moi.
Source :
Diffusion partielle ou totale interdite sans la mention : Source www.kassataya.com