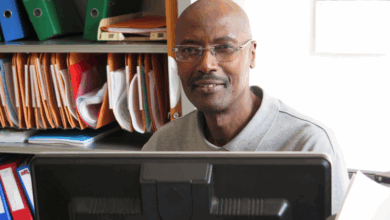Le Quotidien – On nous enseigne très tôt à rêver du mariage. Mais personne ne nous dit qu’on peut y mourir.
Je suis une fille du Sénégal, un pays riche de ses traditions, mais aussi modelé par des normes sociales profondément inégalitaires qui conditionnent le quotidien des femmes. C’est depuis cet endroit précis que je parle. Mon regard est celui d’une femme sénégalaise, ancrée dans une société où les structures du pouvoir reproduisent des hiérarchies de genre, perpétuant ainsi l’infériorisation des femmes à travers des institutions, des coutumes et des discours profondément enracinés.
Et dans ce contexte, je peux le dire avec fermeté : je ne me marierai pas, parce que je n’en vois pas la raison. Pas tant que le mariage reste ce lieu de déséquilibre où les femmes risquent davantage leur vie que d’y trouver un véritable refuge. Je n’y vois ni protection, ni épanouissement, ni reconnaissance. Juste un système qui, trop souvent, nous prend sans jamais nous rendre ce qu’on y a mis. Mon refus n’est pas une fuite, c’est une prise de position radicale : je refuse de risquer ma vie dans une union qui, pour beaucoup de femmes, se termine dans la douleur ou dans une tombe.
Non pas parce que je ne crois pas à l’amour ou à la beauté du lien conjugal, mais parce que la réalité autour de moi me dit autre chose : elle me dit que dans ce pays, trop de femmes n’en sortent pas vivantes. Que le mariage, ce lieu censé être de sécurité, peut aussi devenir un piège. Je n’ai aucune raison de me précipiter vers une institution dont la société elle-même ne garantit pas la sécurité. Mon refus de me marier aujourd’hui n’est pas un rejet de l’amour, c’est une réponse à un contexte d’insécurité, d’impunité et de déni. C’est un acte de lucidité.
Alors que l’on me pousse à «faire vite», à «me caser», à «fonder une famille», tout en m’assurant que le mariage est mon salut, moi je n’entends que les noms des femmes assassinées. Et je m’interroge : qu’est-ce qui protège une femme aujourd’hui ?
Ce refus est un acte politique. Dire non à une institution qui échoue à nous protéger, c’est refuser de normaliser le danger dans l’espace domestique. C’est dire que nous ne voulons pas être les prochaines.
Je ne peux pas détourner mon attention de ces drames : les féminicides captent davantage mon regard que les défilés de célébration, les sommes colossales dépensées en guise de dot ou les conventions pour marier les femmes à moindre coût. Malgré les morts, malgré l’horreur, la société s’acharne à repeindre le mariage comme une promesse de bonheur et de sécurité, enjolivant l’arnaque pour séduire encore plus de filles en quête d’avenir. Mais moi, je vois l’envers du décor. Je vois les tombes. Je vois le sang. Je vois l’absence totale de réaction. Et je refuse.
Au Sénégal, les féminicides continuent d’augmenter, un phénomène alarmant que l’on peine à enrayer face à l’indifférence persistante des autorités. De janvier à mai 2025, au moins sept femmes ont été brutalement assassinées dans des contextes familiaux ou conjugaux, souvent par leurs maris ou compagnons, dans des espaces où elles aspiraient à être protégées, aimées et respectées. Ces drames, parmi lesquels les meurtres de Souadou Sow, Yamou Ndiaye, Sadel Sow, Kindy Bah, Marie-Louise Ndour ou encore Fatou Guèye, ont profondément choqué l’opinion publique. Pourtant, la réponse institutionnelle reste en deçà de l’urgence. Malgré cette hécatombe, aucune parole forte n’a été prononcée par le président de la République, le Premier ministre ou encore la ministre de la Famille. Aucune réaction non plus de la part des chefs religieux ou coutumiers, ni même de ceux qui s’autoproclament «gardiens de la morale» dans l’espace public.
Ce mutisme généralisé, alors que les violences s’accumulent, contraste violemment avec la promptitude avec laquelle ces mêmes figures s’expriment pour condamner un slogan ou une tenue vestimentaire. Cette inégalité flagrante est une gifle infligée aux victimes et un message désespérant pour toutes celles qui espèrent encore une justice ou une reconnaissance de leur souffrance. Ce silence est une preuve accablante que la souffrance des femmes ne pèse pas sur l’agenda politique national.
C’était hier la fête des mères au Sénégal. Il y a eu des pleurs. Pourquoi le passé de nos mères est-il plus souvent synonyme de douleur que de joie ? Parce qu’elles ont tant donné, souvent sans retour. Parce qu’elles ont souffert en silence. Parce qu’elles ont cru que leurs enfants les sauveraient d’une vie de sacrifices. Combien ont vu leurs enfants réussir, d’autres mourir, d’autres encore devenir les bourreaux qu’elles redoutaient ? Et personne ne leur dit qu’elles peuvent partir. On préfère les chanter, les honorer, plutôt que de les libérer.
Aujourd’hui, je désobéis. Mon refus du mariage, c’est un acte de désobéissance civile. Comme les citoyens·nes qui refusent de se soumettre à un Etat injuste, je refuse de me soumettre à une institution patriarcale qui ne me protège pas. Le mariage, tel qu’il est, est un contrat de renoncement pour les femmes, et je ne le signerai pas.
Et ne venez pas me dire que les hommes aussi meurent. Oui, il y a des hommes tués. Mais ils ne sont pas assassinés dans leur lit par leurs femmes. Ils ne meurent pas dans des contextes où ils cherchaient l’amour et ont trouvé la mort. Comparer les féminicides à d’autres crimes, c’est invisibiliser ce que ces meurtres ont de systémique. C’est refuser de nommer ce que la société produit : des femmes tuées pour avoir aimé, pour avoir refusé, pour avoir existé.
Pourquoi alors devrais-je me marier ? Pour mon bonheur ? Il n’est pas garanti. Pour ma sécurité ? Elle est absente. Pour procréer et maintenir une lignée ? Et garantir au système qu’il perdure ? Non merci. Le mariage est une arnaque pour les femmes tant qu’il reste un espace de non-droit. On nous fait croire que nous y gagnerons tout, alors qu’on y perd souvent notre liberté, notre santé mentale, parfois même notre vie.
Je ne me marierai pas. Pas dans ces conditions. Pas avec ce risque. Pas avec ce mépris.
Lutter contre les violences faites aux femmes n’est pas un simple acte individuel, mais une révolte collective, une exigence politique et une solidarité radicale. Mon refus du mariage s’inscrit dans cette dynamique, comme un geste parmi tant d’autres dans un combat plus vaste.
Il est le reflet de mon refus catégorique d’une société patriarcale qui tolère l’inacceptable, qui ne daigne reconnaître la violence faite aux femmes que lorsqu’elle est trop tard, lorsqu’elle nous a détruites, qu’il n’y a plus rien à sauver. Mais cette lutte, elle est plus forte lorsqu’elle s’enracine dans nos consciences individuelles, quand chaque femme prend conscience de sa valeur et de son droit à la dignité. Elle prend vie dans les corps et les voix qui, ensemble, brisent le silence.
Ce n’est pas simplement une question de choix personnel, mais un acte politique : un refus catégorique de me soumettre à ces normes et de devenir une victime silencieuse d’un système qui nous tue lentement, mais sûrement. C’est mon choix conscient, celui de ne pas me laisser effacer, celui de participer à la construction d’un espace où l’assassinat des femmes ne sera plus un fait divers, une statistique ou un sujet de discussion à la marge. Là où chaque féminicide sera reconnu pour ce qu’il est : un crime systémique, un acte perpétré par un système défaillant, une société complice. Derrière chaque féminicide, il y a une femme, une vie, une communauté trahie. Et un système qui a failli.
Fatou Warkha Sambe
Le Quotidien (Sénégal)
Source : Seneplus (Sénégal)
Les opinions exprimées dans cette rubrique n’engagent que leurs auteurs. Elles ne reflètent en aucune manière la position de www.kassataya.com
Diffusion partielle ou totale interdite sans la mention : Source www.kassataya.com