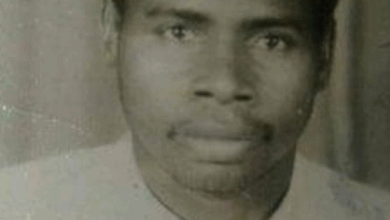Le Soleil – En 1901, presque dans l’anonymat total, un petit néon apparaissait à Bandiagara, dans un lieu empli d’histoires. Cependant, au cours du siècle, il va sortir petit à petit de l’ombre et devenir une lumière dans le paysage littéraire africain, avant de rendre l’âme le 15 mai 1991 à Abidjan, en Côte d’Ivoire. A l’occasion de la commémoration du 34ème anniversaire de sa disparition, retour sur son œuvre, son héritage, mais aussi sur ceux qui s’identifient toujours à Amadou Hampâté Bâ.
Dans l’histoire de la littérature africaine du 20ème siècle, le nom d’Amadou Hampâté Bâ ne passe jamais inaperçu, loin de là. Il est considéré comme l’un des plus grands écrivains de son temps, et peut-être même de l’histoire du continent, de par son œuvre, mais aussi de par son impact sur les générations futures. Amkoullel l’enfant peul, Oui mon commandant ! L’Etrange destin de Wangrin, Vie et enseignement de Tierno Bokar, sont autant d’œuvres majeures sorties de la plume de l’enfant de Bandiagara, qui, en grandissant dans cette mythique ville malienne, a su forger son esprit et sa plume à travers les différentes cultures qu’il y a rencontrées. Entre sa vie de jeune peul, les Toucouleurs, les Bambaras, Dogons, Mossis qu’il a côtoyés, ainsi que les personnages éminemment importants qui ont jalonné son existence, Amadou Hampâté Ba a su apprendre de tout cela pour tout absorber telle une éponge, avant de restituer allègrement le tout dans sa générosité intellectuelle.
Ecrivain et ethnologue malien, Amadou Hampâté Bâ a vu le jour en 1901. Un des « premiers fils » du 20ème siècle comme il aimait se décrire, l’enfant de Kadija Pâté Pullo a très vite pris goût à l’écriture. Etant un des rares enfants de Bandiagara à aller à l’école, il en a profité pour prendre goût à la langue française. Pur produit d’une époque tiraillée entre le désir d’authenticité négro-africaine, et la volonté du colon d’implanter sa propre culture, germent dans l’esprit d’Amadou Hampâté Bâ le désir d’établir l’identité culturelle africaine comme un outil de lutte.
Un destin hors du commun
Né en 1901 à Bandiagara, un creuset du métissage africain où se retrouvaient Dogons, Peuls, Toucouleurs…, Amadou Hampâté Bâ est le fils de Hampâté Bâ, un noble peul. Ce dernier avait grandi à Bandiagara après avoir fui son village lors d’une guerre entre Peuls et Toucouleurs. La mère d’A.H. Bâ, Kadija Diallo, est quant à elle la fille de Pâté Poullo Diallo, qui était un des compagnons d’El Hadj Omar dans ses différentes conquêtes. C’est donc avec cet héritage dans le sang qu’il arrive dans un monde qui se voulait gardien d’une tradition héritée des ancêtres, face à l’administration coloniale bien déterminée à imposer ses règles, sa culture, son mode de vie…
En y repensant, Roukiatou Bâ, fille d’Amadou Hampâté Bâ, qui gère la fondation éponyme basée à Abidjan en Côte d’Ivoire, nous confie ici que c’est comme si tout était écrit. « Le destin l’a placé à une période charnière, dans la mesure où il a vu le premier administrateur colonial s’installer à Bandiagara, et le dernier partir. Il a traversé le siècle. Il a fait partie des derniers à bénéficier des écoles initiatiques, de l’école africaine, de l’école de la parole, à l’ombre du Baobab, avec la présence des grands oralistes, des grands conteurs, dont Koullel. Et donc, imprégné de ça, il a commencé à développer une passion. Et en plus, il faut dire aussi qu’il a été parmi les premiers à aller à l’école occidentale. Donc, à partir de ce moment-là, il va bénéficier de la double culture africaine et occidentale, comme il le dit », nous renseigne-t-elle. Cependant, Amadou Hampâté Bâ va très vite se rendre compte qu’il n’y avait pas d’écrit auquel il pouvait se référer pour étudier sa culture puisque l’histoire, les livres, étaient faits par les Occidentaux.
Pont entre tradition et modernité
A partir de là, une mission nait dans le cœur d’Amadou Hampâté Bâ : être celui qui va recueillir son histoire, sa culture, afin de les transmettre au plus grand nombre. Ce vœu, loin d’être égocentrique, a plutôt comme fondement une envie manifeste de préserver un legs vieux de plusieurs siècles afin qu’il ne se perde pas dans les méandres de l’oubli. « Son œuvre est, pour ainsi dire une volonté de sauvegarder les traditions « en ce qu’elles sont conservables » pour reprendre l’expression d’Amadou H. BA qui marque son adhésion pour un métissage culturel. Par ailleurs, elle se veut une transmission de la culture et la tradition à partir des récits initiatiques traditionnels pour éventuellement leur conservation dans un monde en perpétuelle mutation », explique le professeur Assane Ka, qui écrit une thèse de Doctorat intitulée : La culture pastorale peule dans l’œuvre initiatique d’Amadou Hampâté Bâ. Il a, en outre, déjà écrit un mémoire de maitrise en 2009 : Le symbolisme du bovidé dans Kaidara et Koumen (d’A. H. Bâ) ainsi qu’un mémoire de D.E.A en 2011, toujours sur A. H. Bâ : Le symbolisme du bovidé dans Kaidara, Koumen et Ndjeddo Déwal, mère de la calamité.
L’aspect multidimensionnel d’Amadou Hampâté Bâ a ainsi pu toucher plusieurs générations de lecteurs, partout à travers le monde. Houleymata, l’une de ses ferventes admiratrices, a été éblouie par la qualité de la plume transcendante du fils de Kadija. « Dans mon esprit, il apparaît comme un grand père plein de sagesse, un maître détenteur d’une connaissance infinie qu’il s’est évertué à distiller affectueusement et méthodiquement en moi. Avant de découvrir Hampâte Bâ, j’étais une jeune fille, sénégalaise, africaine, peule. Après avoir lu Hampâte Ba, je me suis redécouverte. Il m’a permis de prendre toute la conscience de mon identité, toutes ses mesures et d’en être extrêmement fière ! Il nous réconcilie avec nos racines, non seulement sur un plan ethnique mais dans une plus large mesure encore. En effet, il nous fait voir le tableau d’une Afrique riche de sa diversité et de ses valeurs de solidarité, de partage, d’honneur, et d’humanisme », confie-t-elle.
Pionnier
L’écriture d’Amadou Hampâté Bâ se veut donc une passerelle entre les temps passé et présent. De plus, Roukiatou sa fille, est sans équivoque : la littérature africaine doit dire merci à Amadou Hampâté Bâ puisque ce dernier est, selon elle, un pionnier. Dans un contexte où l’Occidental a dressé le Nègre contre lui-même, en lui inculquant ses propres valeurs, tout en lui faisant abandonner les siennes jugées en déphasage avec la modernité, il fallait se lever et dire non. Si certains ont jugé nécessaire de prendre les armes lui, a préféré s’attaquer aux esprits. Il faut dire que son maitre spirituel, Tierno Bokar, était convaincu que « les armes matérielles ne peuvent détruire que la matière et non le principe du mal lui-même, qui renait toujours plus vigoureux de ses cendres. Le mal ne peut être détruit que par les armes du Bien et de l’Amour ». Donc, pour Amadou Hampâté, le bien c’était l’expression de toutes les cultures. Son esprit se voulait le terrain fertile de ce syncrétisme culturel car il considérait qu’il y avait largement de la place pour que tous puissent dérouler leur histoire, en revanche le négationnisme, le mal, n’avait pas son mot à dire. Et l’Amour, c’était la passion qui le guidait dans son approche pluridisciplinaire et particulière.
« Il est le père de la littérature africaine francophone, qui a marqué le passage de l’oralité à l’écrit. Bien avant les Cheikh Anta Diop,Léopold Sédar Senghor… Le plus ancien manuscrit qu’on a, date de 1925. Et bien avant cela, il avait commencé à effectuer son travail d’ethnologue. Donc, en résumé, ce que je retiens, c’est qu’il a eu une trajectoire exceptionnelle. Il a bien compris les enjeux du moment. Il a pu sauver de l’oubli de nombreux textes. Et il a fixé l’oralité pour qu’elle puisse traverser le temps. Et donc, c’est dans un acte de générosité, et surtout dans une volonté de servir les futures générations qu’il a agi. Parce que si Amadou Hampâté Bâ n’avait pas existé comme pont entre nos traditions et la modernité, on aurait perdu une source énorme de savoir. Il a aussi mené des combats, notamment contre la colonisation », avance la quinquagénaire, qui ne s’arrête pas là. « Comme il disait, on ne cultive pas dans la jachère, il faut tout défricher et implanter ses propres valeurs », poursuit Roukiatou, qui explique que la vie, c’est comme si on devait commencer une danse. Quelqu’un pose le premier pas et les autres suivent. C’est ce qu’a fait A.H. Bâ d’après elle. Il a posé les jalons d’une écriture engagée, d’un témoignage historique du passé, vecteur d’affirmation culturelle. « Amadou Hampâté Bâ restitue à l’Afrique son histoire. Il te connecte directement à la source », a dit un jour Cheikh Hamidou Kane.
Fervent religieux et une grande spiritualité
Dans ses différentes dimensions, Amadou Hampâté Bâ était aussi un fervent croyant. Fervent tidiane, fait Mokaddem de Cheikh Ahmed Tidiane en 1951. Avant cela, son maitre spirituel, Tierno Bokar, l’avait déjà considéré comme son « successeur ». C’était en 1933, renseigne Roukiatou Bâ, sa fille. Alors qu’il n’avait que 32 ans, A.H. Bâ a vu Tierno Bokar retirer son chapeau, en public, pour le mettre sur sa tête. Une manière de lui enjoindre d’accepter de devenir un chef religieux, même si l’écrivain n’a jamais eu la prétention de faire école. D’ailleurs, il ne commencera réellement à ordonner qu’en 1982, alors que ses dernières années s’approchaient. Au fil du temps, cet aspect de sa personne lui a permis de nouer des liens d’amitié et de fraternité avec plusieurs guides religieux dont Mame Abdou Aziz Sy Dabakh.
Oumar Boubacar NDONGO
Source : Le Soleil (Sénégal) – Le 15 mai 2025
Diffusion partielle ou totale interdite sans la mention : Source : www.kassataya.com