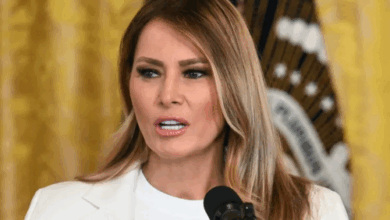L’époque – Le 1er juillet 2022, à 8 heures du matin, David Sina était le premier à entrer dans la mairie de Grenoble, papiers d’identité en main, direction les services de l’état civil. Lorsqu’il en est ressorti un peu plus tard, il n’était plus tout à fait le même. Le jeune homme de 27 ans allait pouvoir officiellement porter le nom de sa mère et s’appeler désormais David Marial, une fois passé le délai de réflexion d’un mois.
Selon le ministère de la justice, durant l’été 2022, ils ont été près de 40 000 citoyens français à demander, comme David, à changer leur nom de famille, une démarche autorisée par la loi Vignal du 2 mars 2022. Cette procédure, qui répondait à une demande sociétale forte, permet à toute personne majeure, une seule fois dans sa vie, de substituer gratuitement le nom de sa mère à celui de son père ou inversement, ou de les associer pour obtenir un double nom, dans le sens de son choix. Jusqu’ici, la démarche était coûteuse (il fallait auparavant payer la publication au Journal officiel et dans un journal local), longue et incertaine, basée sur des critères stricts (un nom ridicule, à consonance étrangère, qu’on veut sauver de l’extinction). En conséquence, elle était sollicitée par 4 000 personnes par an, contre 6 500 par mois depuis l’entrée en vigueur de la loi, le 1er juillet.
« Les noms portent une langue comme on porte un vêtement », écrit la psychanalyste Céline Masson dans l’article « La langue des noms : changer de nom, c’est changer de langue », paru dans la revue Cliniques méditerranéennes (Erès, 2011). Masque d’exil, héritage transgénérationnel, le nom revêt différents visages. Et, parfois, il pèse, irrite, incommode, au point de vouloir s’en délester. « Nous avons des récits tristes, à base de violences, d’abandon, de ruptures, par des personnes qui souhaitent se libérer d’un nom, des témoignages d’amour, de reconnaissance, notamment envers la mère qui a élevé seule ses enfants, ou de retour aux sources, au nom d’origine étrangère abandonné à l’arrivée en France », rapporte Marine Gatineau-Dupré, fondatrice du collectif Porte mon nom, à l’origine de la proposition de loi. Autant d’histoires singulières, intimes, qui racontent la diversité des situations familiales en France, vers la reconnaissance d’une identité filiale fondée sur le vécu propre.
« Mon frère m’appelle “le cousin” »
C’est le cas de David Marial. Né Arès, en Afghanistan, il s’est ensuite appelé Kamel à son arrivée en France, à l’âge de 3 ans. Il a, par la suite, changé Kamel en David à l’âge adulte, au moment de sa naturalisation. Voilà pour le prénom. Concernant son patronyme, son père, journaliste afghan, l’a modifié pour ne pas être reconnu lorsqu’il a fui le pays et les talibans qui le traquaient en 1996. Il a alors choisi pour lui et pour sa famille le nom Sina, en hommage à Ibn Sina, dit « Avicenne », philosophe et médecin aux théories empreintes d’Orient et d’Occident. Un nom que David ne souhaite plus porter, au contraire de Marial, celui de sa mère, d’origine australienne, qui a traversé les générations et est aujourd’hui porté par ses cousins de l’autre côté du globe. « J’ai toujours voulu changer Sina, ce “faux nom” auquel rien ne m’attachait, pour prendre Marial, garder les vraies racines, le vrai héritage. C’est aussi un hommage à mon grand-père maternel, qui est décédé. »
Après des années à se battre pour faire changer son nom, il s’appelle enfin David Marial. Ironie de l’histoire, sa sœur a entrepris les démarches en même temps que lui pour s’appeler Sina-Marial, tandis que le benjamin a souhaité conserver Sina. Tous les deux sont nés en France. « Désormais, aucun de nous trois ne porte le même nom, constate David. Mon frère m’appelle “le cousin”. »
« Le nom ne fait pas l’unité entre les membres d’une famille, à la différence du sentiment d’appartenance » – Pierre Dupré, porte-parole du collectif Porte mon nom
Preuve que l’identité constitue une trajectoire personnelle, par-delà celle, collective, de la famille. Et que le nom incarne, aujourd’hui plus que jamais, cette réalité. « Le nom ne fait pas l’unité entre les membres d’une famille, à la différence du sentiment d’appartenance », assure Pierre Dupré, médecin monégasque, porte-parole du collectif Porte mon nom. Il rappelle les cas, antérieurs à la loi, des familles recomposées et des personnes qui prennent le nom de leur conjoint en se mariant. « Faire coller l’identité de soi à l’identité civile est un des motifs récurrents du changement de nom, souligne-t-il. Avec, également, le motif du traumatisme familial, quand porter le nom apparaît comme un facteur de reviviscence de l’événement traumatique. »

Hélène D. est de ceux-là. L’infirmière de 39 ans a subi l’inceste de son beau-père toute son enfance – il a été condamné pour ces faits à dix ans d’emprisonnement. Elle refusait de continuer à porter ce nom transmis par « [son] violeur » quand il l’a adoptée, mais aucun juge ne lui a permis de s’en défaire, pas même après le procès, ni de casser son adoption plénière. Il lui fallait entamer des démarches auprès du garde des sceaux, comme tout citoyen français.
Avec calme, elle dit : « Cette loi a changé ma vie, bien plus que de mettre mon beau-père en prison », car « ce nom m’attachait encore à lui ». Et, aussi, « j’étais tétanisée à l’idée de mourir avec ce nom, de l’avoir sur ma tombe ». Pendant dix ans, et après une décennie d’amnésie traumatique, dire ce nom devient insurmontable. « Je pleurais à chaque fois que je l’entendais. J’étais incapable de le prononcer. Alors je l’épelais ou je montrais ma carte d’identité. On me prenait pour une folle. » Pour ces raisons, elle refuse de s’inscrire sur les listes électorales, demande au maire de citer juste l’initiale lors de son mariage, et continue à utiliser le nom de son ex-conjoint après leur divorce. Grâce à la nouvelle loi, Hélène a repris le nom de sa branche maternelle. « Ma mère ne m’a pas protégée. Nos relations sont compliquées. C’est plutôt par rapport à mon grand-père, mon papa de cœur. » Aujourd’hui, Hélène « recommence à vivre » et peut à nouveau prononcer ce nom qui n’est plus le sien : « Il n’a plus autant d’impact. C’est comme le nom d’un inconnu. »
Des mères invisibilisées
Au tout début du projet, il y a aussi parfois une discrimination vécue par les mères, divorcées ou non, qui portent un nom différent de celui de leur enfant et se retrouvent face à un imbroglio administratif – 81,4 % des enfants nés en 2019 héritent du nom du père, 6,6 % de celui de la mère et 11,7 % du double nom, selon l’Institut national de la statistique et des études économiques.
« J’étais sans cesse invisibilisée », témoigne Marine Gatineau-Dupré, divorcée, mère de deux enfants. Un jour, on lui refuse l’entrée à l’hôpital avec son fils malade, faute de documents prouvant leur lien. Un autre, on l’interpelle avec ses enfants, au moment d’embarquer dans l’avion. « J’étais cataloguée kidnappeuse d’enfant, c’était humiliant », poursuit-elle. Des souvenirs comme ceux-là, la conseillère municipale de Palavas-les-Flots (Hérault) en a des dizaines. Sans compter ceux qu’elle a recueillis par le biais de son collectif, liés à des situations similaires à la sienne, à des mères d’enfants métis au nom distinct, à des situations de remariage où la nouvelle femme porte, à la différence de la mère, le nom des enfants, à d’ex-conjoints qui refusent l’ajout du nom de la mère à celui des enfants.
Source : L’époque – Le Monde (Le 14 janvier 2023)