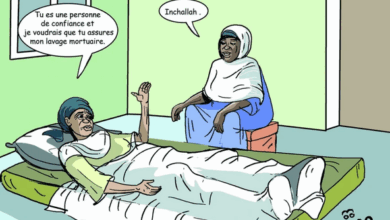M le Mag – Portrait – Son nom a émergé à la faveur du Lion d’argent décerné lors de la Mostra de Venise à « Saint-Omer », son premier film de fiction, en salle le 23 novembre. Cela fait pourtant vingt ans qu’Alice Diop, 43 ans, tourne des documentaires, souvent récompensés.
« Je fais des films depuis vingt ans, mais c’est comme si j’étais née le 10 septembre », sourit Alice Diop. La date en question est celle de la cérémonie de clôture de la Mostra de Venise. Sur la scène du Palais du cinéma, sur l’île du Lido, la réalisatrice française remportait le Lion d’argent (Grand Prix du jury) et le prix du premier film pour Saint-Omer, en salle le 23 novembre. Elle en éclipsa presque la star mondiale Cate Blanchett, récompensée comme meilleure actrice pour son rôle de cheffe d’orchestre dans Tár (de Todd Field). Lors de son allocution, Alice Diop s’est d’abord étonnée de « ne plus avoir les mots », avant de citer la féministe noire américaine Audre Lorde : « Mes silences ne m’avaient pas protégée. Votre silence ne vous protégera pas non plus. » Puis elle a conclu : « Nous ne nous tairons plus. »
Un mois plus tard, dans un café de Montreuil, tout près de chez elle, en Seine-Saint-Denis, elle évoque ces dernières semaines, épuisantes. Elle porte une robe noire aux coutures rouges comme des sutures, de lourdes boucles d’oreilles dorées, un bracelet en forme de serpent au poignet et de longues tresses relevées en chignon. Elle a entre-temps reçu le prestigieux prix Jean Vigo, et Saint-Omer a été désigné pour représenter la France aux Oscars, en février 2023.
https://www.youtube.com/watch?v=SXBFgcerZho&feature=emb_logo&ab_channel=LesFilmsduLosange
Un succès personnel, bien sûr, pour la cinéaste de 43 ans. Mais aussi un signe de l’époque, qui consacre une femme noire, issue du monde longtemps confidentiel du documentaire. Pas encore un symbole ni un porte-voix, mais bien l’indice d’une évolution du cinéma français qui, depuis quelques années, a fait apparaître des visages nouveaux, issus de la diversité ou des communautés LGBT, devant et derrière la caméra.
Et une sorte de pied de nez à la une du Film français qui a défrayé la chronique en septembre. Sous le titre Objectif : reconquête !, le magazine spécialisé faisait poser, autour de Jérôme Seydoux, président de Pathé, six acteurs blancs et hétérosexuels (Guillaume Canet, Pierre Niney, Vincent Cassel…). Noire, femme (membre du Collectif 50/50 qui milite pour l’égalité entre les sexes et la diversité dans le cinéma français), Alice Diop pourrait apparaître comme un nouveau visage du cinéma français. Sauf qu’elle y officie depuis deux décennies. La diversité dans la culture a toujours été là. L’époque commence à peine à le constater.
Huit documentaires remarqués
La réalisatrice est donc loin d’être une débutante : Saint-Omer est certes son premier long-métrage de fiction, mais elle a déjà signé huit documentaires aux formats variés et a été abondamment récompensée au fil des ans. Prix du festival Cinéma du réel en 2016, La Permanence filmait des migrants venus consulter un médecin pour des maux du corps qui racontaient leurs parcours de vie douloureux. Couronné du César du meilleur film de court-métrage en 2017, Vers la tendresse se penchait sur « la façon dont des hommes des quartiers parlent de leur vie amoureuse ou sexuelle », selon les mots de la réalisatrice dans une interview à la revue littéraire Vacarme, en 2016.
Avec Nous, prix du meilleur film documentaire et prix de la sélection parallèle Encounters à la Berlinale en 2021, Alice Diop chroniquait le quotidien d’une poignée de personnes vivant ou travaillant le long de la ligne du RER B, qui traverse la région parisienne du nord au sud, de l’aéroport Charles-de-Gaulle à Saint-Rémy-lès-Chevreuse, et y intercalait des images de son père. Déjà, dans Les Sénégalaises et la Sénégauloise (2007), elle braquait son objectif sur trois femmes de sa famille, au Sénégal, et interrogeait sa place dans cette lignée bouleversée par l’exil.
https://www.youtube.com/watch?v=dj_7m9-tS9A&ab_channel=NewStory
Dans Saint-Omer, elle reconstitue, à travers les yeux de Rama, une universitaire française, noire, et enceinte de quelques mois, le procès d’une mère infanticide inspirée de Fabienne Kabou, qui noya en 2013 sa petite fille de 15 mois dans les eaux froides de la Manche en l’abandonnant, à la marée montante, sur une plage de Berck-sur-Mer. Dans les deux rôles principaux, les actrices Kayije Kagame (dont c’est la première apparition sur grand écran) et Guslagie Malanda. Pour préparer son film, Alice Diop n’a pas cherché à rencontrer Fabienne Kabou, condamnée en appel à quinze ans de réclusion. Elle est en contact avec son avocate, mais le film – une fiction – refuse délibérément de s’inscrire dans le traitement traditionnel d’un fait divers.
La réalisatrice y poursuit un geste entamé au mitan des années 2000, au début de sa carrière : une recherche « très cérébrale et volontairement intuitive », autour d’un sujet « intime et politique ». Ce passage à la fiction, largement plus diffusée que le documentaire dans les salles de cinéma, traduirait-il un changement dans son approche, une envie de s’ouvrir à un public plus large ? Alice Diop parle plutôt de « prolongement ». Elle rapproche sa méthode des cinémas de Claire Denis et de Chantal Akerman, des réalisatrices aux films « fébriles », qui, comme elle, « cherchent » et « prennent donc à chaque fois le risque de passer à côté ». Deux cinéastes pas forcément grand public, mais adorées des cinéphiles, et dont les films, justement, entrecroisent réalisme et fiction.
Inversion du regard sur la femme noire
Pour écrire Saint-Omer, Alice Diop a d’abord travaillé avec Amrita David, la monteuse de tous ses films – les deux femmes se sont rencontrées au cours d’un atelier à la Fémis, en 2005 –, avant de se rapprocher de l’écrivaine Marie NDiaye. Soulignant la « beauté du style » de la réalisatrice, la lauréate du prix Goncourt en 2009 pour Trois femmes puissantes (Gallimard) raconte une amitié récente et forte. « La rencontre avec Alice est fondamentale dans ma vie, dit-elle. Nous avons du plaisir à discuter ensemble parce que nous partageons des points de vue bizarres sur les choses : on s’attarde sur des détails, on peut parler de choses banales, triviales, ordinaires, de la vie la plus basique, comme de Marguerite Duras ou de Michel Leiris. Elle et moi, on est de plain-pied. »
Egalement d’origine sénégalaise (par son père, qu’elle a à peine connu), Marie NDiaye a cependant une « histoire d’immigration » différente : « Celle d’Alice est frontale ; ses parents viennent du Sénégal. Moi, j’ai une histoire de métissage, je ne connais pas le Sénégal, je n’ai jamais vécu avec mon père. » Et pourtant, comme beaucoup, Marie NDiaye a elle aussi été percutée par l’image de Fabienne Kabou, cette Sénégalaise ayant vécu à Dakar jusqu’à ses 18 ans avant de s’installer en France, et par cet infanticide qui échappe à toutes les tentatives de compréhension. « Il y a dans cette affaire une énigme que le film ne résout pas parce que c’est impossible : le mystère d’un amour très grand pour une enfant qu’on choisit de tuer », résume la romancière. Pour Alice Diop, Fabienne Kabou est « cette femme noire qui est une surface de projection tellement puissante qu’elle nous oblige à tomber dans nos propres souterrains ».
« Le récit des miens a été confisqué pendant si longtemps que la nécessité de prendre la parole et de dire des choses précises est la raison pour laquelle je suis devenue cinéaste. » Alice Diop
Et c’est une modification, voire une inversion du regard sur la femme noire, justement, qu’opère Alice Diop. Amrita David, pour la première fois sa coscénariste, décrit la séquence d’ouverture de Saint-Omer : « Cette scène où le personnage de Rama, chercheuse et enseignante, donne un cours, debout derrière le pupitre sur la scène du grand amphithéâtre de Sciences Po, était là très tôt. Derrière elle sont projetées des images de femmes tondues, tournées à la Libération par Robert Capa, et Rama lit un passage d’Hiroshima, mon amour, de Marguerite Duras. » Tout y est : des femmes confrontées à l’opprobre pour un crime qui fait vaciller la morale, et une femme noire en pleine possession de ses moyens, sous le regard d’élèves blancs captivés. Le tout regardé avec une méticulosité presque clinique par la caméra d’Alice Diop.
Dès le scénario, l’étrange langue de Fabienne Kabou s’impose, ce français littéraire, fabriqué, contraint par des parents qui, lors de son enfance au Sénégal, interdirent à la petite fille de parler wolof. Alice Diop, née en France, est elle aussi une exilée de la langue de ses aïeux. Dans les années 1970, l’institutrice d’une de ses sœurs conseilla aux Diop de ne pas parler wolof ou sérère à leurs enfants, au risque, défendait l’enseignante, de leur rendre l’apprentissage du français plus difficile.
Depuis bien longtemps, la langue est, admet la réalisatrice, un « point de névrose ». « Le récit des miens a été confisqué pendant si longtemps que la nécessité de prendre la parole et de dire des choses précises est la raison pour laquelle je suis devenue cinéaste. J’avais mal de ne pas parler et de ne pas être comprise. » A la naissance de son fils, comme confrontée aux abîmes d’une transmission amputée, elle a un temps « perdu sa langue », raconte-t-elle, peinant à trouver ses mots.
Entrelacer le personnel et le politique
Le changement d’identité fait aussi partie de l’histoire de la réalisatrice. Très vite, Umi, son premier prénom, dérivé en « Mimi » par ses proches, a été supplanté par son second, Alice. « A l’école, “Alice” a été le choix de mes parents, mais aussi l’injonction d’une société qui refuse les Umi et le wolof », dit-elle. C’était dans la cité des 3000, à Aulnay-sous-Bois. Lectrice vorace dès son plus jeune âge, excellente élève qui étudia l’histoire à l’université avant de s’orienter vers les études postcoloniales, Alice Diop a toujours entrelacé le personnel et le politique.
Au début des années 2000, alors qu’elle entame sa thèse de doctorat sur « la fabrication intellectuelle de la négritude à travers la revue Présence africaine », organe de presse marquant de la pensée panafricaine, elle opère un virage soudain et s’oriente vers le documentaire.
« Ce que j’avais découvert en études coloniales à la Sorbonne a été fracassant et fondamental dans ma vie, explique-t-elle. Ça éclairait mon expérience intime, celle de ma famille et de la société dans laquelle je vis. Mais ces questions n’étaient pas commentées dans l’espace public ; ça n’intéressait personne, on travaillait au sous-sol du Centre de recherches africaines de la Sorbonne… C’était génial mais trop petit, pas assez reconnu, très marginal. J’étouffais. » C’est en visionnant, dans un cours sur les sources historiques, les films documentaires et ethnographiques de Jean Rouch et d’Eliane de Latour qu’il lui apparaît soudain « possible d’aborder des questions politiques, anthropologiques, sociologiques en les diffusant sous une forme sensible ».
Diffusion partielle ou totale interdite sans la mention : Source www.kassataya.com