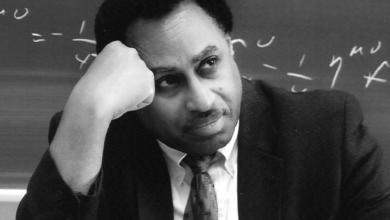Le Monde – Début novembre 1922. Le monde retentit encore de la Marche sur Rome de Benito Mussolini quelques jours plus tôt et de l’accession du leader fasciste au poste de président du conseil italien. Dans le milieu plus confidentiel et plus feutré de l’égyptologie, on vient de célébrer le centenaire du déchiffrement des hiéroglyphes par Jean-François Champollion, sans deviner que, sur les rives du Nil, une découverte est sur le point d’époustoufler la planète.
Inconnu des non-spécialistes, un pharaon du XIVe siècle avant notre ère va passer de l’obscurité la plus totale à la lumière la plus éclatante, réfléchie par les monceaux d’or de son tombeau, par les objets sublimes qu’il recèle, par ce masque à l’expression énigmatique qui le symbolise aujourd’hui. Son nom : Toutankhamon.
Il faut donc de cent ans remonter le cours du temps, retourner au matin de ce 4 novembre 1922, quand l’archéologue britannique Howard Carter arrive dans la vallée des Rois où il mène la sixième campagne de sa carrière. Elle risque d’être la dernière, son mécène, George Edward Stanhope Molyneux Herbert, cinquième comte de Carnarvon, ayant décidé de ne plus financer des travaux aux trop maigres résultats.
Mais, ce matin-là, sur le chantier qu’il a entrepris en contrebas de la tombe de Ramsès V et VI, les ouvriers ne travaillent pas et l’attendent. Dans son Toutankhamon, monographie publiée en 2015 (éd. Pygmalion), Marc Gabolde, professeur d’égyptologie à l’université Paul-Valéry-Montpellier, écrit : Howard Carter « comprit immédiatement que quelque chose sortant de l’ordinaire avait été découvert. Les ouvriers lui annoncèrent alors que, sous les remblais (…), ce qui semblait une marche de pierre creusée dans le roc avait été dégagé. »
Il y a quelque chose, là. Probablement le début d’un hypogée, c’est-à-dire d’une construction souterraine, forcément une sépulture royale en ce lieu. Violée ou pas ? On déblaie. Une volée de marches apparaît, ainsi qu’une porte dont l’enduit laisse encore voir des empreintes de sceaux. En creusant un petit trou sous le linteau, l’archéologue distingue un corridor comblé de gravats, ce qui renforce les chances de trouver un tombeau intact. Howard Carter ne va pas plus loin. Il envoie un télégramme à Lord Carnarvon car à tout seigneur, tout honneur : « Avons enfin fait une merveilleuse découverte dans la vallée : une magnifique tombe avec sceaux intacts. Tout recouvert en attendant votre arrivée. Félicitations. »
Un tombeau ouvert à la barre à mine
Laissons le temps à Lord Carnarvon et à sa fille Evelyn Herbert de faire le voyage jusqu’à Louxor (nom moderne de l’ancienne Thèbes pharaonique), de l’autre côté du Nil, pour nous demander comment Howard Carter en était arrivé à fouiller à cet endroit précis. Au printemps 1922, il travaille sur un autre secteur puis, l’été passé, il se décide à revenir au pied de la tombe de Ramsès V et VI.
« Dans le récit qu’il en fait, il fait passer ça pour un éclair de génie, dit en souriant le jeune égyptologue Simon Thuault, postdoctorant à l’université de Pise. Carter, c’est un très bon conteur d’histoires. Dans ses journaux, il a parfois tendance à arranger un peu les choses pour rendre la narration la plus efficace possible. En fait, il était au courant que l’équipe qui l’avait précédé soupçonnait l’existence d’une tombe à cet endroit. » Lui-même recherche depuis un moment la dernière demeure de l’obscur Toutankhamon, dont on sait qu’il a été inhumé dans les parages.
Quoi qu’il en soit, le 24 novembre, l’archéologue accueille sur place Lord Carnarvon et sa fille. On dégage de nouveau les marches. Le lendemain, la porte est débloquée et il faut vider le corridor, qui s’enfonce sous le sol, de toute la caillasse qui le remplit. Le 26 novembre dans l’après-midi, une seconde porte apparaît, qui porte des sceaux au nom de Toutankhamon. Tout va beaucoup plus vite que sur une fouille archéologique de 2022, on ne fait pas forcément dans la dentelle et, muni d’une barre à mine, Howard Carter pratique une petite ouverture. A la lueur d’une bougie, il jette un coup d’œil pour regarder ce que personne n’a contemplé depuis plus de trente-deux siècles. Il est muet de sidération et Lord Carnarvon, impatient, lui demande s’il voit quelque chose. La réponse de l’archéologue est entrée dans les livres d’histoire : « Oui, des merveilles ! »
Officiellement, on se contente ce jour-là d’admirer par cet orifice le contenu de l’antichambre du tombeau, en particulier plusieurs chars démontés et, sur la droite de la pièce, deux grandes statues à l’effigie du roi qui encadrent une nouvelle porte scellée. Là encore, dans ce récit, Howard Carter prend ses aises avec la vérité. En réalité, l’archéologue fait agrandir l’ouverture et se faufile dans la pièce, accompagné de son assistant Arthur Callender, de Lord Carnarvon et de Lady Evelyn.
Ils constatent les traces d’un pillage antique, qui ne dut pas aller très loin puisque les objets volés avaient été rapportés et rangés à la va-vite. Les visiteurs découvrent l’annexe de l’antichambre mais on ne sait pas s’ils poussent ce jour-là l’audace jusqu’à percer la porte murée qui les sépare du tombeau. Mais que ce soit le 26 novembre ou l’un des jours suivants, la petite bande finit par pénétrer dans la chambre funéraire aux murs peints.
Il y a là peu de place pour circuler. La dépouille du pharaon est en effet enchâssée dans ce qui s’apparente à un grand jeu de poupées russes, comme on s’en apercevra lors des campagnes suivantes, qui s’étendront sur plusieurs années. Recouverte de son fameux masque d’or, la momie prend place dans un premier cercueil – en or également –, inséré dans un deuxième cercueil qui est lui-même placé dans un troisième. Le tout s’intègre dans un grand sarcophage en pierre. Et ce n’est pas terminé car pas moins de quatre « chapelles » dorées constituées de panneaux de bois s’emboîtent les unes dans les autres et encadrent ce sarcophage. Enfin, vient la quatrième salle, dite du trésor, qui, parmi une foule d’objets, contient notamment les vases canopes où sont conservés les viscères du défunt.
Il faudra une décennie à Howard Carter pour fouiller ce petit tombeau et inventorier les quelque cinq mille pièces de mobilier funéraire qui y avaient été placées pour accompagner le roi dans l’éternité. Avec, à la clé, un fascinant paradoxe : grâce à ce trésor somptueux, grâce aussi à la légende purement médiatique de la « malédiction » de la momie, qui prit racine à partir de la mort de Lord Carnarvon en avril 1923, le nom de Toutankhamon est devenu mondialement célèbre ; pourtant, personne dans le grand public ne saurait raconter la vie de ce roi. Comme le résume avec justesse Marc Gabolde dans l’introduction de son ouvrage, « le trésor de Toutankhamon, par son omniprésence, constitue une sorte d’écran éblouissant qui empêche d’apprécier la richesse documentaire de ce règne singulier ».
Recyclage de mobilier
Que disent en effet, de ce roi de la XVIIIe dynastie, son tombeau et son matériel funéraire ? Peu de choses. Le texte d’un éventail trouvé par terre, entre deux des chapelles, rapporte que Toutankhamon avait chassé, dans le désert, les autruches dont les plumes paraient l’objet. Un autre texte, inscrit sur une canne très simple, dit que le roseau qui la compose a été coupé de la main même du roi, probablement dans le delta du Nil. Plus émouvantes sont les deux petites momies de fœtus féminins retrouvées dans la tombe, ce qui fait supposer qu’il s’agit de ses filles. L’analyse ADN suggère que les deux ne sont pas de la même mère. Le pharaon s’était marié enfant avec sa sœur Ankhésénamon mais, bien qu’il soit mort au sortir de l’adolescence, rien ne l’a empêché d’avoir des épouses dites secondaires.
L’information essentielle que révèle sa tombe est ailleurs. Ecoutons ce que nous explique Marc Gabolde dans l’interview qu’il nous a accordée : « Pour partie, le mobilier funéraire de Toutankhamon, qui fait sa gloire, n’est pas le mobilier funéraire original de Toutankhamon. Je pense que tout le mobilier funéraire que son prédécesseur féminin s’était fait préparer a été réutilisé pour Toutankhamon, mais on n’en voit les traces que sur une toute petite partie. »
Tous ces objets ont certainement été remisés dans les magasins royaux et modifiés dix ans plus tard lorsque Toutankhamon est mort. Marc Gabolde poursuit : « Dans les pièces dont je suis sûr qu’elles ont été fabriquées pour la reine-pharaon, on a deux des grandes chapelles dorées où l’on voit les traces de retravail, le masque d’or et les petits sarcophages en or pour les vases canopes. Le sarcophage de pierre a, lui aussi, été usurpé. » On aboutit donc au plus extraordinaire des paradoxes : le visage que, d’après le célèbre masque d’or de 11 kilogrammes retrouvé sur la momie du roi, le monde entier prend pour celui de Toutankhamon est celui de la mystérieuse reine-pharaon qui l’a très brièvement précédé…
Pour se dépêtrer de cet imbroglio, il faut retourner à la fin du règne d’Akhénaton, le père de Toutankhamon. « Akhénaton et son épouse Néfertiti avaient tous les deux moins de 30 ans à leur mort, rappelle Marc Gabolde. On est dans un contexte où le roi précédent est mort relativement jeune après avoir pas mal modifié les cultes égyptiens, d’abord en en fermant un certain nombre et ensuite en privilégiant le culte du disque solaire et de la lumière, le culte d’Aton, en remplacement de tous les autres. Mes collègues sont parfois réservés mais je n’hésite pas à utiliser le mot de monothéisme. »
Le principal devoir du pharaon consiste à accomplir le culte, ce qui permet, dans l’esprit égyptien, de maintenir le monde dans un équilibre bienfaisant, d’écarter la menace du chaos
La période est donc trouble sur les plans politique et religieux, sans compter qu’une épidémie partie d’Egypte traverse le Proche-Orient et que l’armée égyptienne a été malmenée par les Hittites dans ce qui est aujourd’hui la Syrie. A la disparition d’Akhénaton, son seul héritier mâle, Toutankhamon (qui n’avait que 4 ans et s’appelait alors Toutankhaton, en hommage à Aton), aurait dû lui succéder mais ce n’est pas le cas. Quelques égyptologues intercalent le règne d’un très nébuleux Smenkhkaré mais celui-ci n’est sans doute jamais monté sur le trône et fait figure de roi fantôme. En revanche, plus sûre est la piste d’une reine-pharaon : selon les travaux de Marc Gabolde, la propre sœur aînée de Toutankhamon, la princesse Mérytaton, lui aurait grillé la politesse.
On ne sait pour ainsi dire rien du règne de Mérytaton – si ce n’est qu’elle a régné moins de trois ans – ni des circonstances de son décès. Arrive enfin l’heure de Toutankhamon. « Il devient roi parce qu’il est le dernier prince survivant de la lignée, explique Marc Gabolde. Est-il préparé à régner ? Oui, tous les enfants royaux le sont. Mais est-ce que, entre 7 et 8 ans, on connaît son métier de roi ? Non, pas forcément très bien. Il est secondé, certains diront téléguidé, et là, deux grands personnages interviennent. Tout d’abord le “père divin” Aÿ – probablement un oncle plus ou moins éloigné de Toutankhamon – qui va lui enseigner le métier de roi. »
Le principal devoir du pharaon consiste à accomplir le culte, ce qui permet, dans l’esprit égyptien, de maintenir le monde dans un équilibre bienfaisant, d’écarter la menace du chaos. Le second « mentor » du jeune roi est le général Horemheb, que Marc Gabolde décrit comme « un remarquable administrateur et un excellent militaire ». Ces deux éminents personnages, Aÿ puis Horemheb, succéderont d’ailleurs à Toutankhamon sur le trône d’Egypte.
Le jeune roi se trouve dans une position inconfortable. D’un point de vue dynastique, explique Marc Gabolde, « il doit être le fils d’un roi, donc d’Akhénaton. Mais du point de vue théologique, et notamment pour le puissant clergé d’Amon, il ne peut pas se réclamer d’Akhénaton qui avait fait marteler les images d’Amon partout » afin d’imposer le culte d’Aton. L’atonisme passera par la suite pour une hérésie. « Officiellement, poursuit l’égyptologue, Toutankhamon doit renier ses parents, ce qu’il a très bien fait puisqu’on n’a pas une seule inscription qui le mette en relation, pendant son règne, avec son géniteur. » Dans la même logique, le roi change assez vite de nom et Toutankhaton devient Toutankhamon, en référence au dieu Amon, puisque les anciens cultes sont restaurés.