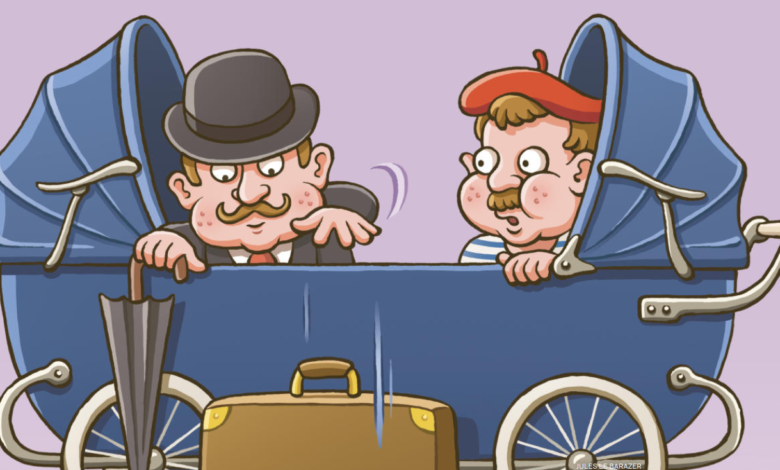
– Nous sommes à l’été 2008. Ma femme est enceinte de nos jumeaux. Il nous faut trouver un appartement plus grand, mais décrocher un prêt est compliqué.
Les banques françaises veulent la preuve que l’on peut rembourser l’emprunt quoi qu’il arrive. Nous leur montrons nos placements, ils nous répondent avec dédain que leur valeur peut s’écrouler. Une banque m’envoie chez un cardiologue qui m’examine sous toutes les coutures. Alors qu’il s’apprête à me congédier sans un mot, je me risque à lui demander s’il a trouvé quelque chose. « Rien », grommelle-t-il. En fait, il n’est pas à mon service, mais à celui de la banque, qui doit savoir si je vais vivre assez longtemps pour rembourser un emprunt sur vingt-cinq ans.
Sur le moment, je trouve tout cela ridicule : ces précautions extrêmes ne sont qu’un énième exemple de l’appréhension qu’inspire la finance moderne à la France. Mais, un mois à peine après l’obtention de notre prêt, la crise financière mondiale éclate et la Bourse s’effondre. Les prix de l’immobilier dévissent à cause de faillites en cascade, mais pas en France, où les prêts hypothécaires à risque sont rares.
Lorsque je m’expatrie à Paris en 2002, j’emporte avec moi pas mal de préjugés sur les Français. Pétri de French bashing britannique, je suis persuadé qu’ils finiront un jour par se réveiller, enfin prêts à devenir comme nous. C’est-à-dire décidés à rallonger leurs journées de travail, réduire les dépenses publiques, soutenir les Etats-Unis quand ils partent faire la guerre, etc. Bref, j’espère que la France acceptera enfin la mondialisation comme nous, Anglo-Saxons, l’avons fait : il nous a suffi de la baptiser « modernité ». Pourtant, vivre en France m’a fait évoluer pour rejoindre la fameuse formule du romancier anglo-irlandais Laurence Sterne dans son Voyage sentimental à travers la France et l’Italie, publié en 1768 : « Cette affaire, dis-je, est mieux ordonnée en France. » Le personnage qui dit cela bluffe – il n’a jamais visité la France –, mais il a raison.
A première vue, le Royaume-Uni et la France sont quasi jumeaux : environ 67 millions d’habitants chacun, une centralisation folle, des PIB presque identiques et une frustration postimpériale. Malgré cela, les deux pays suivent des trajectoires différentes. Dès que j’apprends à voir la France « de l’intérieur », je me rends compte que l’on déforme sa voix à l’étranger – quand on l’entend. Comme pour une transmission de longue distance, la pensée française n’est perçue qu’à travers beaucoup d’interférences. Sans doute en grande partie parce qu’elle ne s’exprime pas en anglais, lingua franca de la mondialisation. Si les Lumières françaises s’allumaient au XXIe siècle plutôt qu’au XVIIIe siècle, le monde ne les remarquerait peut-être pas.
Tour d’esprit britannique et emphase française
En 2003, le gouvernement français condamne l’invasion de l’Irak, ce qui donne libre cours aux moqueries habituelles sur votre aversion supposée pour la culture anglo-américaine − que, personnellement, j’ai rarement constatée. S’ajoute un procès en lâcheté affirmant que les Français – des « singes qui mangent du fromage et rendent les armes », pour reprendre l’expression ironique du dessin animé Les Simpson – soutiennent Saddam Hussein à cause d’une prétendue haine des juifs. J’ai demandé à l’historien britannico-américain Tony Judt comment a émergé une théorie aussi farfelue. Il souligna que les seuls épisodes de l’histoire moderne de France familiers aux Anglo-Saxons sont l’affaire Dreyfus, le gouvernement de Vichy et la Shoah.
En février 2003, alors que les débats aux Nations unies portent sur l’invasion américaine, déjà programmée, le ministre des affaires étrangères français, Dominique de Villepin, impeccablement parisien jusqu’à ses boutons de manchette, se lance dans un plaidoyer contre la guerre. Il parle, bien sûr, en français, la plupart des délégués écoutant la traduction simultanée grâce à leurs écouteurs. Belle métaphore pour décrire le rôle dévolu à la France sur la scène mondiale : le ministre espère encore y être audible, mais ce n’est plus tout à fait le cas.
Appelant à la paix, de Villepin fait cette remarque : « Et c’est un vieux pays, la France, un vieux continent comme le mien, l’Europe, qui vous le dit aujourd’hui, qui a connu les guerres, l’Occupation, la barbarie. » Son homologue britannique, Jack Straw, lui répond indirectement : « Monsieur le président, je parle au nom d’un pays très ancien, fondé en 1066 par les Français. » Les délégués – ayant alors presque tous reposé leurs écouteurs – s’esclaffent. Le tour d’esprit britannique fait pièce à l’emphase française, avec pour résultat une énième victoire des Anglo-Saxons. Les Français remportent cependant un lot de consolation : l’histoire leur donne raison.
J’admire vos hôpitaux, qui ont guéri
le cancer agressif de mon épouse
Dans la crise financière, le Royaume-Uni a bien plus souffert que la France, Londres n’ayant jamais voulu brider la croissance démesurée de son secteur bancaire. En 2016, alors que le premier ministre britannique, David Cameron, annonce avec allégresse un référendum sur le Brexit, je commence à remarquer une différence émotionnelle entre les deux pays. Quand les Français adoptent volontiers un ton apocalyptique, se croyant toujours sur le point de basculer dans une nouvelle guerre de Religion ou de subir une catastrophe néolibérale, les Anglais (plus que les Britanniques) restent complaisants. Après trois siècles sans invasion étrangère, sans révolution, sans famine ou sans guerre civile, le peuple britannique imagine qu’il n’y a aucun souci à se faire : tout ira bien.
C’est ainsi que le comédien Boris Johnson a pu mener campagne, avec succès, en faveur du Brexit, sans y croire vraiment lui-même. Et puis il est nommé premier ministre ! Décidément, les Britanniques s’amusent bien. Mais je dois reconnaître que le Brexit a un (unique) avantage : je saute enfin le pas et consacre l’énergie nécessaire, durant des années, à rassembler les documents afin d’obtenir la nationalité française et de demeurer citoyen européen. Mon parcours du combattant passe par un entretien avec deux bureaucrates au sous-sol d’un bâtiment ministériel, qui veulent savoir si je suis un espion. Je réponds que non. En janvier dernier, j’obtiens la meilleure nationalité au monde, selon le classement établi par Christian Kaelin et Dimitry Kochenov.
Le Brexit fait l’effet d’un électrochoc aux Français parce qu’ils ont compris que la même chose aurait pu leur arriver. J’évoquais un jour auprès d’un responsable politique un potentiel « Frexit » en rappelant le choix des Britanniques en 2016. Il m’a répondu : « C’est vrai. Mais on n’aurait jamais été assez cons pour organiser un référendum. » Après mûre réflexion, je crois même que les Français n’auraient jamais eu la bêtise de voter pour une sortie de l’Union. Parce que, au fil des années, j’ai pris conscience de l’écart entre les paroles et les actes chez les Français : ils sont moins radicaux qu’ils n’en ont l’air.
Simon Kuper
Le journaliste et écrivain chroniqueur au « Financial Times » et installé à Paris
Traduit de l’anglais par Lucas Faugère.
Suggestion kassataya.com :
A Londres comme à Paris, la fabrique contestée des élites
L’anglais, le français : deux langues, mon cauchemar
Source : (Le 29 juillet 2022)
Diffusion partielle ou totale interdite sans la mention : Source www.kassataya.com






