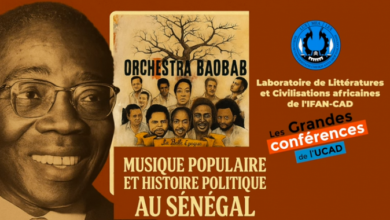Le Monde – A travers l’écran de l’ordinateur, les grands yeux bruns et le sourire engageant de Maaza Mengiste abolissent la distance. La propagation rapide du variant Omicron a convaincu l’écrivaine d’annuler sa venue en France mi-décembre. « Tout a changé si vite, explique-t-elle depuis son bureau à New York. Mais je reviendrai bientôt. Nous avons le temps. »
Sa réponse ne surprend pas, tant son parcours montre à quel point elle sait prendre son temps. Son deuxième roman, Le Roi fantôme, finaliste du prestigieux Booker Prize en 2020, paraît en France dix ans après Sous le regard du lion (Actes Sud, 2012), traduit dans plusieurs langues. Entre les deux, elle a signé une vingtaine de textes sur le coût humain de la guerre, d’Homère à Svetlana Alexievitch, sur la mémoire, l’Ethiopie et l’actualité africaine, dans des titres renommés de la presse anglo-saxonne (Granta, The New Yorker, Rolling Stone). Maaza Mengiste est une autrice à succès qui compose une œuvre à un rythme tranquille. Et qui a mis des décennies à s’imaginer devenir écrivaine.
Se perdre entièrement dans les livres
Lorsqu’elle était enfant, en Ethiopie, son père, employé dans une compagnie aérienne, et sa mère, qui s’occupait de ses enfants, la voyaient médecin. Jamais ils ne l’ont encouragée à écrire, mais voilà : elle a découvert l’anglais et la lecture, et compris qu’elle pouvait se perdre entièrement dans les livres, ce nouveau territoire. « Je me souviens que chaque fois que je lisais un ouvrage en anglais, je ressentais une émotion compliquée à décrire, mais qui explique pourquoi j’écris : celle d’entrer dans une conversation qui a commencé il y a des millénaires. Quelque chose de plus grand que moi », confie-t-elle.
L’écrivaine revoit avec une grande clarté les violences qui ont suivi le coup d’Etat contre l’empereur Haïlé Sélassié, en 1974, contraignant sa famille à l’exil un an plus tard, d’abord dans les pays d’Afrique anglophone, puis aux Etats-Unis. A l’époque, quand elle parlait avec ses parents des soldats, des tanks, des arrestations, ils lui disaient qu’ils n’en avaient aucun souvenir, et s’étonnaient qu’elle puisse en avoir alors qu’elle n’avait que 3 ans. Ou alors ils refusaient de répondre à ses questions. « Ce fut mon premier rapport avec l’histoire : des souvenirs que personne ne voulait ou ne pouvait m’expliquer car les traumatismes étaient encore présents », explique-t-elle. D’où son besoin de combler les silences de ses proches par des recherches.
Dans les années 1980, les ouvrages sur les guerres civiles en Ethiopie (1974-1991) manquent. Sa famille refusant toujours de répondre à ses questions sur la révolution éthiopienne, elle se replie sur les révolutions en Iran, en Chine, à Cuba, et même en France, grâce au Conte de deux villes, de Charles Dickens (1859). Dans chaque livre, la jeune femme retrouve les mêmes expériences humaines, « de gens à la merci d’un pouvoir qui les dépasse ». Ce détour par l’ailleurs explique pourquoi ce n’est pas tant l’histoire de son pays natal que les thèmes universels de la guerre, de la transmission des traumatismes d’une génération à l’autre, de la possibilité de la résilience et du pardon qui l’intéressent aujourd’hui dans son travail d’écrivaine.
Le récit de sa mère, entrecoupé de larmes
« Je n’avais que les livres », remarque-t-elle. Tel l’Iliade, dont le mot « Ethiopie » lui donne l’impression d’être « reflétée » dans l’épopée homérique. D’Homère, elle retient aussi que le langage peut décrire la violence d’une bataille, puis, en se faisant plus poétique, permettre aux personnages et au lecteur de s’en extraire. Au début des années 2000, des ouvrages de sciences sociales sur l’Ethiopie des années 1970 commencent enfin à paraître. « C’est de là qu’est née ma motivation. Je lisais et je me disais : “D’une part, je déteste mon travail de consultante en stratégie commerciale ; d’autre part : et si j’écrivais un livre ?” »
En 2007, Maaza Mengiste sort diplômée d’un master de création littéraire de l’université de New York. Sous le regard du lion, qui relate le quotidien d’une famille à Addis-Abeba pendant le coup d’Etat de 1974, paraît aux Etats-Unis trois ans plus tard. Elle a 39 ans. Ses parents font le voyage depuis Addis-Abeba pour assister à la première rencontre en librairie de leur fille. « Sur le chemin, ma mère m’a dit : “J’ai lu ton livre, et maintenant je vais répondre à tes questions” », se remémore-t-elle en éclatant de rire. Le récit de sa mère est entrecoupé de larmes. La romancière pense aujourd’hui, onze ans plus tard, qu’elle ne lui a pas encore tout raconté. Mais, pour cela aussi, elle a le temps.
Il faut l’écouter expliquer comment elle se documente, voyage, éprouve peu à peu ce qu’un livre vient changer en elle. Elle songeait à écrire sur l’invasion de l’Ethiopie par les troupes mussoliniennes en 1935, sujet du Roi fantôme, bien avant de se lancer dans son premier roman. En 2010, une bourse Fulbright lui permet de financer un an de recherches à Rome. Fascinée par les clichés d’Ethiopiens pris pendant le conflit – qui dura jusqu’en 1941 –, Maaza Mengiste se rend compte, en passant du temps dans les archives, que ces photos sont des outils de propagande, sélectionnés et censurés par les autorités fascistes, « une représentation du pouvoir des Italiens ». Elle décide de leur donner une voix dans son roman, non pas en reproduisant les photos, mais par le biais de portraits écrits. Sa grande trouvaille se fera sur les marchés aux puces de Rome : les journaux intimes de soldats italiens et des ascaris – les supplétifs indigènes de l’armée italienne. « Le roman a pris une tout autre ampleur à partir de ces découvertes inattendues », constate-t-elle.
Dix jours durant sur les routes d’Ethiopie
Cinq ans plus tard, elle termine un premier jet. Il décrit avec précision les forces en présence et les batailles vécues par les différents protagonistes. « Mais tout cela tombait à plat. » Pourquoi ? Elle comprend que les personnages féminins manquent et que ça l’intéresse moins sans eux. Consciencieuse, Maaza Mengiste retourne à ses notes et tombe sur un article du New York Times daté de 1935. Il parle d’une femme soldat qui a mené deux mille hommes dans une bataille. Une information palpitante que cette perfectionniste avait négligée. « J’ai regardé mon roman, que je devais rendre depuis un moment à mon éditeur, et j’ai tout jeté. »
Retour à la case départ. Avec en tête de raconter ce conflit depuis un point de vue féminin, et de faire entendre la multitude de voix qui confèrent de la complexité au récit historique. Cette seconde version la conduit à demander un nouveau délai à sa maison d’édition pour enquêter sur des sites de bataille. Sa mère l’accompagne dix jours durant sur les routes d’Ethiopie. Lors de son retour aux Etats-Unis, elle dit à sa fille : « Tu sais, ton arrière-grand-mère a participé à cette guerre. » La voilà qui tombe des nues. Comment sa mère avait-elle pu taire cette information pendant tout le voyage ? « Mais tu ne m’as pas posé la question », répond cette dernière.
Pourquoi l’aurait-elle fait quand, depuis son enfance, elle s’était confrontée à un mur de silence ? Quand le passé de sa famille avait toujours été révélé inopinément, sur un ton presque anecdotique ? « Aujourd’hui, les histoires qui ne sont pas encore racontées dans ma famille sont dans mon roman », conclut la romancière. Si la fiction n’a pas permis à Maaza Mengiste de combler les vides de la mémoire familiale, elle lui a permis de se déplacer dans quelque chose de plus grand qu’elle : la conversation qui occupe les êtres humains depuis le jour où se sont racontées les premières histoires.
Parcours
1971 Maaza Mengiste naît à Addis-Abeba (Ethiopie).
1975 Sa famille fuit la révolution, arrivant finalement aux Etats-Unis.
2010 Sous le regard du lion (Actes Sud, 2012).
2010-2011 Voyages en Italie pour travailler sur les archives de l’invasion de l’Ethiopie par les troupes mussoliniennes en 1935.
2019 Le Roi fantôme (L’Olivier).
Critique
La bravoure des combattantes
« Le Roi fantôme » (The Shadow King), de Maaza Mengiste, traduit de l’anglais (Etats-Unis) par Serge Chauvin, L’Olivier, 464 p., 24 €, numérique 17 €.
Le Roi fantôme est le roman d’une résistance devenue mythique : de l’invasion de l’Ethiopie par les troupes de Mussolini, en 1935, à la victoire miraculeuse d’un peuple peu armé contre les tanks et les armes chimiques des Italiens, en 1941. Dans un savant dosage de détails documentés et de références homériques, Maaza Mengiste orchestre scènes de combats, d’exactions et d’arrière-front, tandis qu’un chœur chante la gloire ou porte les drames des protagonistes.
Voici la cruauté d’un général fasciste ; la solitude de l’empereur Haïlé Sélassié en exil ; l’espoir suscité par un villageois prénommé Minim (mot qui signifie « rien » en amharique) ; la bravoure des combattantes éthiopiennes. Parmi elles, Hirut, « fille de Getey et Fasil, née en un temps de moisson bienheureuse, épouse aimée et mère aimante, soldat ». Orpheline, héritière du fusil de son père, elle mène des centaines d’hommes au combat.
Source : Le Monde (Le 09 janvier 2022)
Diffusion partielle ou totale interdite sans la mention : Source www.kassataya.com