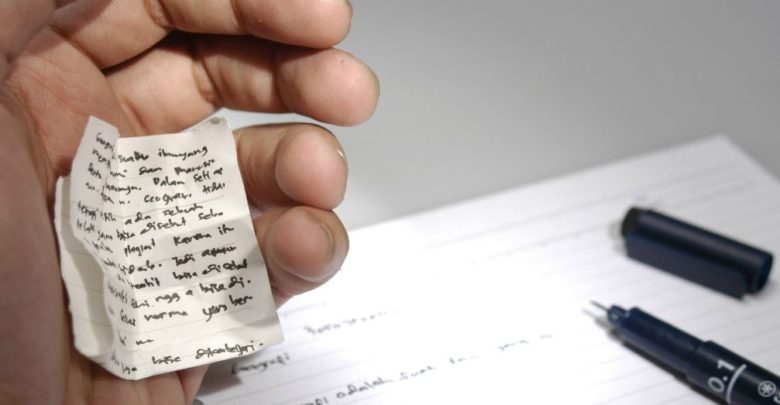
La tricherie touche les universités d’élite comme les établissements moins bien classés, et elle est pratiquée par des étudiant·es de tous niveaux.
Quand les écoles et les universités se mobilisent contre la tricherie, il s’agit bien sûr pour elles de garantir la valeur des examens et de veiller à l’égalité entre les étudiant·es. Mais ces institutions étant des lieux d’éducation et de socialisation, les enjeux de cette lutte se répercutent au-delà de l’enseignement supérieur, comme le rappelle Déborah L. Rhode, professeure de droit. En effet, une personne commençant à tricher tôt sera plus encline à reproduire ce comportement au cours de sa vie.
Pis encore, un·e étudiant·e risque de s’identifier à ce rôle, si l’on se réfère aux analyses de Dan Ariely. «Une fois que vous avez commis votre premier acte malhonnête, il est plus probable que vous en commettiez d’autres, observe ce spécialiste de l’économie comportementale. Une fois que les gens commencent à se voir comme des tricheurs, il devient plus probable qu’ils tricheront.»
Pour enrayer un phénomène, encore faut-il en connaître mieux les tenants et les aboutissants. Une démarche d’autant plus nécessaire que la tricherie interroge tous les acteurs de l’enseignement. Aux États-Unis aujourd’hui, plus de 90% des étudiant·es interrogé·es déclarent qu’il y a un problème de ce type dans leur université, et deux tiers des chef·fes d’établissement considèrent que le phénomène est en augmentation. Et, si les taux de signalement varient selon les pays, le phénomène se révèle d’une quasi-ubiquité.
Mesures et définitions
La première étude de grande ampleur sur la tricherie en milieu étudiant remonte aux années 1960. Un professeur à l’Université Northeastern, William Bowers, a enquêté alors avec son équipe sur de multiples campus états-uniens, avec une échelle standardisée.
Afin de mieux cerner le phénomène de triche, ils la divisèrent en treize items –comme «copier quelques phrases sans en indiquer la source en note», «donner des réponses à d’autres étudiants pendant un examen», «obtenir les questions ou les réponses d’un examen par quelqu’un l’ayant déjà passé», etc.– et distribuèrent un questionnaire anonyme aux étudiant·es en les interrogeant sur leur recours à ces pratiques, et avec quelle fréquence.
Si l’on considère qu’un tricheur ou une tricheuse active est un·e étudiant·e ayant commis au moins trois de ces actes, alors 19% le sont dans l’étude de 1962. Cette enquête sera réalisée régulièrement par la même équipe (avec quelques variations) puis reprise par un professeur de la Rutgers Business School, Donald McCabe.
Sur le temps long, les taux relevés dans ces enquêtes déclinent, mais les moyennes dissimulent des mutations dans les pratiques. En réalité, ce sont les mentalités des étudiant·es qui évoluent –et leur manière d’évaluer ces actes– plus que la tricherie qui diminue.
Motivations
Pourquoi les élèves trichent-ils? Les raisons sont multiples et Pascal Guibert et Christophe Michaud en ont identifié un certain nombre. Sans surprise, les concerné·es vont invoquer des enjeux stratégiques: on triche plus volontiers dans des matières qu’on ne valorise pas (comme les langues mortes), ou lorsqu’on estime que, face à une charge de travail trop importante, on prendrait le risque de rater son diplôme.
Contrairement à certains stéréotypes, leur étude montre également que la triche n’est pas l’apanage des moins assidu·es et autres cancres –elle est aussi pratiquée par les meilleur·es. Une observation qui recoupe les résultats de Deborah L. Rhode. Passant en revue les études académiques sur le sujet, elle souligne que le phénomène concerne les institutions d’élite, telles Harvard ou Yale, aussi bien que les plus modestes, mais également en leur sein, les moins bon·nes étudiant·es comme les têtes de promotion.
Elle y voit plusieurs raisons, comme la pression des parents ou l’arrivée des nouvelles technologies qui facilitent la tricherie. Le phénomène est aussi largement amplifié par la permissivité –voire l’indifférence– des professeur·es, des surveillant·es et des institutions, ou l’intensité de la tricherie, qui enclenche un cercle vicieux –les étudiant·es qui ne trichaient pas se sentent poussé·es à le faire pour ne pas être désavantagé·es.
Pascal Guibert et Christophe Michaud soulignent eux aussi le rôle important du contexte, tout en notant que les élèves qui ne rentrent pas dans le jeu de la triche ne sont pas forcément des modèles de vertu et d’éthique. Quand on les interroge sur les motifs qui les guident, ils parlent plutôt de la peur de se faire prendre, peu évoquent l’honnêteté.
Endiguer le problème
Les études académiques conduites sur la tricherie estudiantine donnent quelques pistes aux institutions qui souhaiteraient s’attaquer aux phénomènes de triche sur leur campus. Sans surprise, selon les économistes Collins, Judge et Rickman (2007), plus la sanction est importante, moins la triche sera présente et plus la valeur du diplôme sera conservée.
Pour McCabe et son équipe, il est plus facile de changer les comportements en matière de triche si le campus est de taille plus réduite, si les élèves en classe sont moins nombreux ou si les cours magistraux impersonnels sont moins fréquents.
Selon les sociologues Pascal Guibert et Christophe Michaud, la pression sociale joue également un rôle important dans la normalisation de la déviance, parfois plus encore qu’un manque de connaissance et/ou de travail de la part des tricheurs et des tricheuses.
Une étude en cours
Pour aller plus loin, nous venons de lancer une étude au niveau national sur le sujet. Si l’échantillon actuel commence à être conséquent (près d’un millier de répondant·es), il est encore trop tôt pour en tirer une analyse scientifiquement rigoureuse.
Quelques tendances se dessinent cependant:
- Si l’on considère comme tricheur quelqu’un qui pratique au moins trois formes de triche plusieurs fois par an, alors 55% des personnes interrogées le sont.
- À critère égal, les étudiant·es de notre échantillon (en France) tricheraient dans l’ensemble bien plus que les États-unien·nes –surtout pendant les examens (antisèche et/ou communication des réponses), ou en ce qui concerne les copier-coller qui ne citent pas leurs sources.
- Nous avons établi un «score de triche» (issu d’une pondération des réponses sur douze formes de triche) dont la moyenne dans notre échantillon est d’environ 1,5. Les élèves en écoles de commerce, souvent décrits comme individualistes et ambitieux, ont une moyenne légèrement plus élevée (1,74, soit environ 20% de plus) –mais les profils restent, en première analyse, relativement similaires.
Des représentations en jeu
L’un des points intéressants qui émergent concerne le travail à plusieurs sur des devoirs donnés à faire individuellement. Près de la moitié des personnes interrogés déclarent le faire plus d’une fois par an –et 20% plusieurs fois par semestre. Mais quand on leur demande si elles considèrent que cela relève de la triche, bien que 65% d’entre elles répondent par l’affirmative, les réponses divergent fortement sur le degré.
Or, c’est l’évaluation du degré de gravité de l’acte qui va influencer la tendance à tricher ou non. Quand un·e étudiant·e considère que travailler à plusieurs sur un devoir individuel n’est «pas vraiment» ou «pas du tout» de la triche, sa tendance à le faire augmente de plus d’un tiers.
Mais, comme nous l’avons dit, l’échantillon recueilli pour l’instant ne permet pas encore tous les traitements statistiques nécessaires. Si vous souhaitez répondre à l’étude ou la faire circuler auprès d’étudiant·es français·es, vous pouvez la trouver ici.
Yoann Bazin
Cet article a été réalisé avec Gauthier Omnes, Benjamin Rétaux et Camille Vermande, étudiants à l’EM Normandie sur le campus d’Oxford.

Cet article est republié à partir de The Conversation sous licence Creative Commons. Lire l’article original.
Source : Slate (France)
Diffusion partielle ou totale interdite sans la mention : Source : www.kassataya.com






