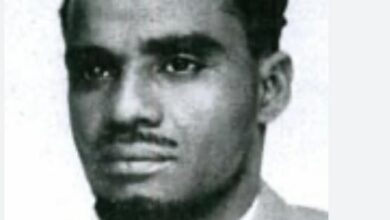Le pouvoir et l’opposition semblent avoir trouvé en ce qui se passe en Tunisie et en Egypte une sorte de « carburant » pour ce dialogue informel qu’ils mènent depuis le déclenchement de la crise en août 2008 et son prolongement dans l’élection présidentielle de juillet 2009.
Le pouvoir et l’opposition semblent avoir trouvé en ce qui se passe en Tunisie et en Egypte une sorte de « carburant » pour ce dialogue informel qu’ils mènent depuis le déclenchement de la crise en août 2008 et son prolongement dans l’élection présidentielle de juillet 2009.
Chacun y va de son interprétation des faits : Attention, danger, menace l’opposition, tentant de faire peur au régime en place par la transposition, jugée possible, des événements vécus en Tunisie et en Egypte, à la Mauritanie.
Ce scénario catastrophe pour le pouvoir est cependant écarté d’un tour de main par une majorité qui se complait même à dire que la Mauritanie a déjà vécu sa « révolution » (allusion on ne peut plus clair au coup d’Etat contre Sidi) et qu’il n’y a aucune raison objective à tenter une comparaison entre ici et ailleurs.
Pourtant, cet « ailleurs » est de plus en plus présent ici. Il est devenu une référence au dialogue qui s’instaure sous forme de polémique qui ne finit pas, de jugements de valeur sur ce qui est « l’Etat de la Nation », après plus de deux années de gouvernance azizienne.
Si l’on tente de ramener l’attitude du pouvoir – et de ses soutiens – aux premières déclarations du Guide libyen qui n’a pas hésité à condamner la révolution qui a emporté son ami, le désormais ex président Zine El Abidine Ben Ali, sans pourtant se prononcer sur le sort identique arrivé à Moubarak, on pourrait alors penser qu’il ne s’agit, ni plus ni moins, que de la manifestation d’un instinct de conservation que partagent aujourd’hui tous ceux qui se sentent menacés !
Dans tous les autres pays de ce que l’on appelle communément l’Union du Maghreb Arabe (UMA), sans véritablement pouvoir donné un contenu clair (politique, économique ou social) à un tel regroupement, les dirigeants ont adopté une attitude de prudence, un silence de mort, laissant les peuples – mais aussi les opposants – revendiquer une sorte d’affinité avec leurs frères tunisiens. Jusqu’au moment où l’on s’est rendu compte que le bras de fer a tourné à l’avantage du peuple souverain. Alors, ici en Mauritanie, le ministère des Affaires étrangères et le parti au pouvoir se sont décidé, enfin, à aller dans le sens de l’Histoire.
« La Mauritanie n’est pas la Tunisie »
La Mauritanie n’est pas la Tunisie. Oui, c’est un fait. On peut aussi ajouter qu’elle est loin d’être l’Egypte. Cela ressemble bien, dans la bouche des soutiens du pouvoir, à une espèce de conjuration du (mauvais) sort qui a frappé les dirigeants de ces deux pays. Mais quand l’opposition tente de prouver le contraire, elle verse dans cette polémique stérile qui n’a aucun rapport avec le dialogue qu’elle dit rechercher, et encore moins avec la nécessité d’épargner à la Mauritanie de tomber dans les travers des deux révolutions menées par le peuple dans ces deux pays.
Chacun pense, sans réellement comprendre, comment un régime aussi fort que celui du président Ben Ali, qui se vante d’avoir construit une économie forte grâce à des investissements énormes dans les domaines de l’éducation, de la santé, des infrastructures et du tourisme, peut-il s’écrouler comme un château de cartes ?
L’idée que le chômage des jeunes diplômés mais aussi la répression aveugle des intellectuels et des opposants au pouvoir dictatorial de Ben Ali aient été le talon d’Achille d’un système qui donnait pourtant l’impression d’être bien huilée, donne à réfléchir à tous ceux qui comptent sur la seule force pour aller au-delà des vingt ans de règne de l’ex – président tunisien condamné maintenant à vivre en exil en Arabie saoudite, à quelques centaines de kilomètres d’un autre président, Maaouiya, dont les méthodes tendaient à reproduire, à l’identique, celles d’un homme arrivé au pouvoir trois ans après lui.
Et d’aucuns de se rappeler que ce qui vient d’arriver en Tunisie puis en Egypte, à un mois d’intervalle peut n’être que le prolongement, tardif certes, de la dislocation du bloc soviétique, il y a un peu plus de trois décennies, quand le mur de Berlin a chuté. Comme en 2005 en Mauritanie, la Tunisie et l’Egypte vivront, elles aussi, leurs transitions, certes de courte durée, mais devant leur permettre d’entrer, véritablement, dans le club des nations dites démocratiques.
Et, encore une fois, le mot est lâché. Chez nous, en Mauritanie, quand les militaires qui ont déposé le président Taya, le 3 août 2005, ont repris le pouvoir au « président démocratiquement élu », deux années plus tard (6 août 2007), on a préféré parlé plutôt de « rectification » ! On s’était peut-être dit qu’une transition ça va mais que deux, cela prête à équivoque et traduit même le caractère instable d’une démocratie qui se cherche.
Ainsi, la Mauritanie n’a pas encore recouvré totalement sa « normalité » démocratique que la Tunisie et l’Egypte la rejoignent dans la transmutation du politique par des revendications économiques et sociales. Et même si on a aujourd’hui un président élu, la crise qui ne finit pas nous replace dans une sorte de « transition » qui dure plus qu’il n’en faut.
L’examen de cette généalogie et du travail que subit ce concept pour être finalement appliqué à l’Europe de l’Est, puis à l’Afrique, permet de critiquer sa validité explicative : Si la «transition » ainsi définie caractérise parfaitement les processus de mutation politique en cours chez nous (Africains et Arabes), comment expliquer que certains doutent de sa réussite, ou évoquent la possibilité qu’elle échoue – comme si la transition pouvait ne pas advenir?
Qu’il y ait des scénarios transitionnels (après la chute de Taya) et d’autres qui ne le soient pas (après la destitution de Sidi) est un élément lourd de présupposés. Ould Taya aurait pu partir autrement, c’est certain, mais au prix d’un bain de sang ou d’une dictature d’un demi-siècle avec risque de transformation de celle-ci en « République monarchique ».
Sidioca ne présentait pas un risque pareil parce que ceux qui l’avaient déposé avaient toutes les cartes en main. Pourtant, la «transition» telle qu’elle a été théorisée et menée en Mauritanie, après avoir été vécue douloureusement ailleurs, se présente avant tout comme un modèle à l’aune duquel on peut porter un jugement sur le postcommunisme en Europe de l’Est et les « nouveaux pouvoirs » en Afrique.
Ainsi, de plus en plus, l’utilisation de ce concept renvoie moins à une fonction explicative qu’à son caractère opératoire et fonctionnel. Le discours de la transition démocratique n’est pas en effet un discours scientifique mais l’acteur du procès qu’il désigne. Si les événements mondiaux qui ont jalonné les années 1989 et 1990 (Allemagne, URSS) sont de nature démocratique, comme nous en sommes convaincus maintenant, il est par ailleurs patent que leur cours a été finalisé.
Chez nous, pour que le processus qui s’est enclenché depuis le 03 août, avec la chute du régime de Ould Taya, puisse être appelé «transition démocratique», il faudrait que la démocratie soit et reste son moteur intrinsèque et vivant, constitué et alimenté par l’organisation collective des intérêts – ce qu’elle doit nécessairement être.
Mais alors comment ne pas voir la gigantesque récupération en cours, quand la démocratie est confisquée et déplacée vers l’avant, non plus comme procès subjectif, mais comme un but idéal et surtout, comme un pouvoir préconstitué qu’il ne s’agirait plus que de réaliser, ou mieux, d’étendre puisqu’il fonctionne déjà ailleurs, c’est-à-dire dans les régimes libéraux d’Europe et d’Amérique?
C’est très précisément cette manipulation qui caractérise les « débats », actuels et à venir, entre la majorité et l’opposition sur des questions dont la solution est, nécessairement, hors transition.
On tricherait, énormément, quand on voudrait régler d’un seul coup des questions nationales endurcies par le temps comme la cohabitation entre communautés nationales, le problème de l’esclavage et le tribalisme. Le dialogue, si un jour il a lieu, ne doit pas porté sur la gestion du pouvoir – ou son partage – mais sur ces questions existentielles pour nous.
Regardons donc l’après 6 août comme une seconde transition qui ne constituait pas uniquement une simple alternative, mais qui devait, au contraire, mobiliser un seul et même modèle politique avec une forte cohérence de fond qui pose la démocratie comme un effet institutionnel et non comme la dynamique même de l’institutionnalisation. Nous devons tous avoir pour credo ceci: Les institutions d’abord, la démocratie après, au sens d’alternance.
C’est la logique que les Mauritaniens de tous bords doivent savoir dépasser après avoir vécu leurs deux « transitions ». Sinon, rien ne garantit qu’on ne se retrouvera pas dans le cas de la Tunisie quand les questions laissées pendantes par le passage d’un régime à un autre vont refaire surface à nouveau. Car, si le pouvoir de Taya était tombé comme un fruit mûr, c’est justement parce qu’il n’avait pas pensé, exactement comme Ben Ali, que le peuple, s’il ne sort pas lui-même dans la rue, peut pousser l’armée à agir par procuration.
Sneiba Mohamed
Source : L’Authentique via Boolumbal le 19/02/2011