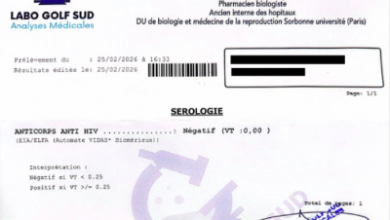Afrique XXI – Les prisons contemporaines du Niger, loin d’être des instruments dépolitisés de gestion pénale, révèlent comment s’exerce concrètement le pouvoir de l’État. Elles incarnent des dispositifs de contrainte, expressions des formes institutionnalisées de violence, bien au-delà du seul legs colonial souvent mobilisé pour les expliquer.
Dans le débat public comme dans la littérature académique en effet, la prison en Afrique est souvent présentée comme une technologie de répression exogène qui a été importée par les colonisateurs européens pour asseoir leur domination. Mais une telle lecture, si elle éclaire nombre de pratiques carcérales contemporaines, ne suffit pas à en saisir la complexité historique. Les recherches sur l’histoire de l’espace nigérien montrent que l’enfermement étatique est bien plus ancien, largement antérieur à l’arrivée des colonisateurs. Dès le XVe siècle, des formes coercitives d’enfermement ont été attestées au nom du souverain.
Dans cette perspective, il ne s’agit donc pas tant d’opposer le temps précolonial au temps colonial – une opposition qui, par ailleurs, maintient la colonisation comme référent central de l’analyse – que de penser leur articulation : la prison coloniale est un moment structurant, non un commencement. À partir de l’exemple du Niger, il s’agit de penser des continuités et des dimensions universelles, en s’engageant dans une histoire plus longue des prisons1.
Une institution marquée par la coercition
Ces dernières années, le Niger a connu une augmentation sans précédent du nombre de personnes détenues. Longtemps parmi les États incarcérant le moins au monde, avec un taux de 40 détenues pour 100 000 habitantes en 2019, le pays a vu ce chiffre passer à 59 en 2024. Sur la même période, le nombre total de personnes incarcérées est passé de 9 158 à 15 831, selon les données du ministère de la Justice, soit une hausse de près de 70 %.
Or l’État nigérien n’a jamais fondamentalement investi dans le système judiciaire. En vingt ans, le budget alloué à la justice n’a dépassé 1 % du budget national qu’à deux reprises2, révélant le désintérêt structurel pour cette fonction régalienne. Les effets sont concrets : moins de 300 francs CFA (moins de 50 centimes d’euro) par jour dépensés pour l’alimentation et les soins des personnes détenues, pas de budget spécifique pour les frais de carburant nécessaires aux extractions judiciaires, peu d’investissements de l’État dans la réhabilitation des infrastructures… Dans des établissements souvent vétustes, les conditions de détention sont très dégradées, avec un accès limité aux soins, une absence fréquente de produits d’hygiène, des installations sanitaires détériorées, une surpopulation parfois aiguë. En pratique, l’alimentation des détenues repose largement sur les apports extérieurs, principalement ceux des familles. Fin 2024, 62 % des détenues étaient en détention préventive, mêlangées aux condamnées dans les mêmes quartiers.
Dans ce contexte, la prison ne punit pas pour réhabiliter ou réformer : elle incarne un mode d’exercice du pouvoir fondé sur un encadrement à dominante militaire. Alors que l’administration pénitentiaire est officiellement rattachée au ministère de la Justice depuis 1991, elle ne dispose ni des moyens humains ni du contrôle effectif. En effet, les prisons nigériennes relèvent en pratique du ministère de l’Intérieur, via la Garde nationale de Niger (GNN), héritière des gardes-cercles coloniaux3 et dotée d’attributions très étendues. Ses membres se considèrent avant tout comme des militaires. Outre ses missions dans les prisons, la GNN assure la surveillance du territoire, la sécurité publique, le maintien et le rétablissement de l’ordre, ou encore la protection des édifices publics, des personnes et des biens – cette liste n’étant pas exhaustive. Hormis dans quelques établissements jugés sensibles, elle ne dispose pas de personnel dédié ni spécifiquement formé pour intervenir en milieu carcéral.
Une conception sécuritaires de l’enfermement
De ce fait, la GNN exerce un pouvoir sans contrepoids. Son approche essentiellement sécuritaire de l’enfermement repose sur la surveillance, l’obéissance et la prévention des évasions : aucune mission liée à la réinsertion ou à la réhabilitation ne lui est confiée. Une réforme engagée pour créer un corps civil de l’administration pénitentiaire, porteur d’une vision plus progressiste de l’enfermement, a été abandonnée en 2024, quelques mois après l’arrivée au pouvoir de la junte.
Ainsi structurée, l’institution carcérale nigérienne donne à voir une conception sécuritaire de l’enfermement. Elle prolonge des logiques de gouvernement par la contrainte, dont les racines peuvent être cherchées dans des héritages plus anciens.
Le poids de la colonisation française dans les prisons nigériennes contemporaines est indéniable. Sur les 41 prisons en activité en 2022, plus de la moitié ont été construites avant l’indépendance. Ces infrastructures ne sont pas de simples témoins de la période coloniale : elles forment encore aujourd’hui l’ossature du système carcéral nigérien.
Une prison coloniale au cœur de la domination raciale
Mais l’administration coloniale ne s’est pas contentée de construire des murs. Comme l’ont montré nombre de travaux depuis la fin des années 1990, dans le sillage de l’ouvrage coordonné par Florence Bernault4, la prison coloniale ne visait pas la réinsertion, mais la contrainte et l’affirmation d’un ordre colonial dont la violence structurelle contrastait avec le projet civilisateur. Dans l’espace nigérien, comme ailleurs, elle s’appuyait sur un double dispositif répressif exclusivement réservé aux populations africaines : le régime disciplinaire de l’« indigénat » et la justice « indigène ».
Carole Berrih est docteure en administration publique, chercheuse associée au Centre d’Études et de Recherche sur la Diplomatie
Source : Afrique XXI – (Le 10 novembre 2025)
Diffusion partielle ou totale interdite sans la mention : Source www.kassataya.com