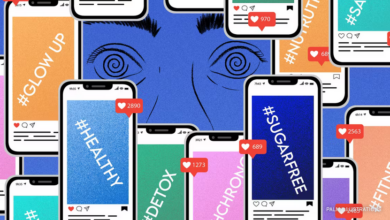– Au printemps 1982, étudiants et chercheurs se pressent à l’université de Dakar pour écouter le célèbre Cheikh Anta Diop (1923-1986). L’auteur de Nations, nègres et cultures (Présence africaine, 1965) fascine autant qu’il divise ses contemporains. Dans la foule dense, un adolescent ne perd pas une miette du discours pionnier de l’intellectuel sur l’Egypte antique peuplée de Noirs et la diffusion de la langue et de la culture égyptiennes en Afrique de l’Ouest : David Diop, 16 ans. « J’ai été extrêmement impressionné par ses propos sur l’Egypte ancienne, se souvient le romancier lors d’un entretien accordé en septembre au “Monde des Livres”. Je pense que je mûris, à l’insu de ma conscience, un sujet de livre sur l’Egypte depuis ce jour-là. »
Où s’adosse le ciel, qui entrelace le voyage de Bilal Seck – un pèlerin sénégalais survivant d’une épidémie de choléra à La Mecque, à la fin du XIXe siècle – avec le récit de l’exil en masse d’Egyptiens vers l’ouest du continent africain au IIIe siècle av. J.-C., est le fruit de cette longue maturation. Si l’idée vient de loin, ce n’est cependant qu’en 2021, et après avoir publié deux romans (Frère d’âme, Goncourt des lycéens 2018, et La Porte du voyage sans retour, 2021, tous deux au Seuil), que l’universitaire, spécialiste des littératures du XVIIIe siècle, commence un intense travail de documentation. Il fait des recherches comme jamais auparavant, plongeant dans les travaux de l’égyptologue Aboubacry Moussa Lam, avec la crainte de se perdre dans cette histoire égyptienne immense.
Que cherche David Diop en parcourant près de 3 500 ans d’histoire ? Découvrir, dans l’histoire de l’Egypte antique, des événements historiques permettant de corroborer les récits des griots du Sénégal, collectés au début du XXe siècle par des Français, et qui évoquent un « peuplement de l’Afrique de l’Ouest par des populations venues d’Egypte au cours de plusieurs migrations, dont une au IIIe siècle avant notre ère », explique-t-il. Commence alors un jeu de pistes, dont il trouve l’une des clés dans L’Egypte des pharaons, de Damien Agut et Juan Carlos Moreno Garcia (Belin, 2016) : un moment, sous la dynastie des Ptolémées (323-30 av. J.-C.), où des pharaons grecs réforment le panthéon égyptien. « Il m’a semblé qu’un schisme religieux pouvait justifier une grande migration », confie l’auteur. C’est le point de départ du « récit des origines » que nous donne à lire Où s’adosse le ciel : l’histoire d’un exil des Egyptiens conduit par le grand prêtre Ounifer, transmis à l’oral depuis des siècles, dont Bilal Seck est le 72e passeur.
Seul, avec les livres
Le pèlerin le psalmodie pour ne pas l’oublier tandis qu’il met ses pas dans ceux de ses lointains ancêtres, alors qu’il regagne le Sénégal, en passant par l’Egypte et le sud du Sahara. « Dans la fiction, j’invente cette chaîne de la parole, précise l’auteur. Mais je m’appuie sur des données historiques. Marguerite Yourcenar [1903-1987], que je cite en exergue, a écrit : “Quoi qu’on fasse, on reconstruit toujours le monument à sa manière. Mais c’est déjà beaucoup de n’employer que des pierres authentiques.” J’ai besoin d’écrire à partir de bases vraies avant de pouvoir m’en détacher. »
Pendant trois ans, David Diop a travaillé seul, avec les livres. Dans les quatre tomes de La Littérature de l’Egypte ancienne, de Bernard Mathieu (Les Belles Lettres, 2021-2025), il a puisé les hymnes, prières, contes mythologiques et rituels funéraires qui scandent le roman et donnent une vision profonde de l’Egypte des pharaons, trop souvent caricaturée. Parallèlement, il se penche sur l’Afrique du XIXe siècle dans laquelle évolue Bilal Seck. Comme il veut que son personnage rentre à pied de La Mecque à Saint-Louis du Sénégal, il fait coïncider son voyage avec une épidémie de choléra qui a réellement frappé la ville sainte en 1893. Puis il imagine la biographie de Bilal à partir de cette date : s’il est adulte en 1893, il peut avoir connu, enfant, l’« école des otages » – cet établissement créé par Faidherbe, en 1855, pour former, parmi les fils de notables, les futurs administrateurs profrançais.
Une fois ces jalons posés, le romancier se met en tête de réunir les deux épopées en un lieu précis, afin de faire « coïncider le mythe et la réalité ». Il y parvient grâce à un « alignement des planètes géographiques », à Djenné, où l’on a retrouvé des vestiges de la ville ancienne de Djeno, datant du IIIe siècle av. J.-C. Cette cité est célèbre pour sa mosquée de terre crue, reconstruite en 1907. Ce sera la date du passage de Bilal lors de son voyage de retour. Les trois ans de documentation achevés, David Diop passe à l’écriture, « qui va très vite ».
Pendant tout ce temps, il ne dit pas un mot à ses éditeurs (Frédéric Mora et Adrien Bosc) du travail en cours. Aussi, en découvrant le manuscrit d’Où s’adosse le ciel, Frédéric Mora a été surpris et « fasciné par le geste du romancier, transmettant par l’écriture une parole nomade qui, par essence, échappe à l’écriture ». Car la question de la transmission est ici centrale. « Au Sénégal, comme en Egypte, il y a des savoirs secrets auxquels nous n’avons pas accès, car la transmission est sacrée. Or, ne pas recevoir cette transmission, c’est passer à côté d’un savoir fondamental. L’enjeu de ce livre a été de mettre en lumière la possibilité d’une transmission, ainsi que les risques de sa perte », explique David Diop. Roman profondément africain, qui raccroche les mythes à l’histoire factuelle, l’Egypte ancienne aux empires maliens, et témoigne de l’unité géographique de l’Afrique, Où s’adosse le ciel nous éloigne un peu de ces risques.
Une double épopée
Bilal Seck a l’étoffe des héros. Quand il apparaît, c’est un homme « presque nu », dont l’habit en lambeaux raconte les ravages de l’épidémie de choléra à laquelle il survit, en 1893. Abandonné par son ami à La Mecque, où ils étaient arrivés du Sénégal, le pèlerin n’a qu’un fil auquel se raccrocher : le récit secret des origines, transmis à l’oral, dont il est le 72e passeur.
D’emblée, Où s’adosse le ciel bascule avec ivresse dans le temps et l’espace d’une double épopée. Le mythe psalmodié par Bilal relate une grande migration du peuple égyptien. Exilé de force après un schisme religieux sous le joug des Ptolémées (323-30 av. J.-C.), le grand prêtre Ounifer veut fonder une nouvelle Abydos en « Extrême-Occident », « au pied de la montagne de Bakhou, là où s’adosse le ciel ». Tandis que Bilal entreprend de rentrer au Sénégal en suivant la route de ses ancêtres, il entretisse son histoire avec celles d’Ounifer, de l’ardente Kémi et de l’archer Antef. « Le premier passeur du chant des origines a dit, et je le répète tel que je l’ai entendu et appris », affirme Bilal avant de passer au récit du mythe, porteur d’une faute originelle qui condamne la lignée de Bilal à l’impureté de sang.
Et si ce voyage était l’occasion de réhabiliter sa lignée et de forger son propre destin ? Un grand Diop, qui d’une épopée antique éclaire nos chemins de vie. Maudit par la parole, Bilal Seck sera sauvé par l’écrit. Un dénouement stupéfiant qui n’a pas fini de faire parler.
Extrait
« Ainsi soit-il. C’est le prix à payer, se disait Bilal Seck en attachant une dernière bandelette de tissu autour des chevilles d’un défunt qu’il avait enveloppé dans son suaire. De ce malheur peut surgir la chance de ma vie. Aucun de mes soixante et onze prédécesseurs passeurs du récit des origines n’a pu mettre ses pas dans ceux des ancêtres partis du Double Pays pour le Bel Horizon. Je serai le premier à retrouver la route qu’ils ont suivie. J’éluciderai les mystères de la parole sacrée dont la signification s’est égarée sur les sentiers innombrables des possibles. Pour être voyant, il faut avoir vu. Afin que mes yeux puissent remonter les siècles, sonder les cœurs et les esprits des Anciens, je partirai d’Egypte à pied pour rejoindre ma patrie, dussé-je y mettre des années. »
« Où s’adosse le ciel », de David Diop, Julliard, 368 p., 22,50 €, numérique 15 €.
Diffusion partielle ou totale interdite sans la mention : Source www.kassataya.com