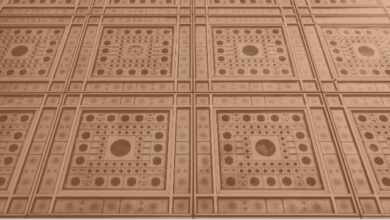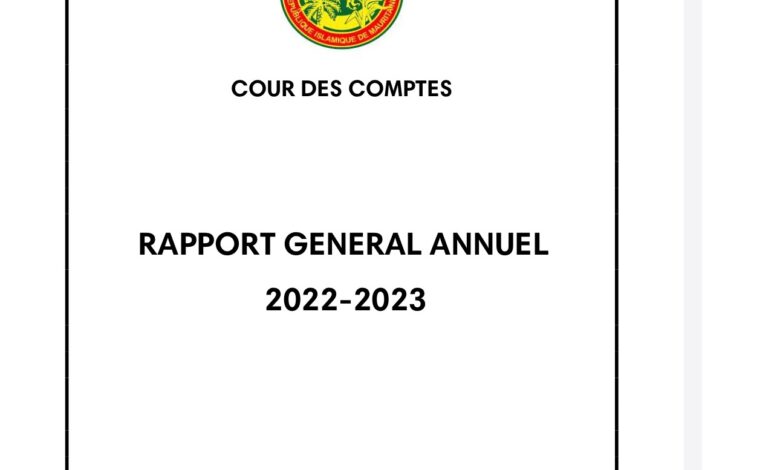
Le Calame – La Cour des Comptes a rendu public son rapport général annuel sur l’exécution des lois de finances de l’État pour les exercices 2022 et 2023. Outil majeur de contrôle et de transparence dans la gestion des ressources publiques, ce document met en lumière plusieurs anomalies budgétaires et pratiques assimilables à des malversations ou à des manquements graves dans la gestion des finances de l’État. Il dresse un tableau préoccupant de la gestion de plusieurs secteurs stratégiques de l’État, révélant des dysfonctionnements financiers et administratifs majeurs. Elle tire la sonnette d’alarme sur la gestion des finances publiques. L’institution dénonce de graves irrégularités dans plusieurs secteurs vitaux – notamment le pétrole, les mines, la santé, l’énergie et les infrastructures – et met en garde contre les risques croissants pesant sur la bonne gouvernance et la transparence de l’action publique.
Des défaillances généralisées dans la gouvernance financière
Considéré comme le principal instrument de contrôle des fonds publics, le rapport révèle un irrespect répété des procédures de passation des marchés et une faible efficacité du recouvrement des recettes publiques. Il pointe également un suivi insuffisant des obligations financières imposées aux opérateurs privés et publics, traduisant, selon la Cour, une gouvernance financière « défaillante et mal encadrée ».
Le rapport révèle également de forts décalages entre les prévisions de recettes et de dépenses et leur exécution réelle. Ainsi, en 2022, les recettes prévues à 90,4 milliards MRU n’ont été réalisées qu’à hauteur de 82,7 milliards MRU, soit un déficit de près de 7,7 milliards MRU. Du côté des dépenses, le taux d’exécution a plafonné à 87,3 %, malgré une augmentation substantielle du budget en loi de finances rectificative. Ces écarts sont principalement liés à une gestion approximative des financements extérieurs, dont une partie considérable – plus de 5,7 milliards MRU en recettes et 9,9 milliards MRU en dépenses – échappe encore au contrôle du Trésor public. La Cour souligne que l’origine et la traçabilité de ces chiffres restent floues, ce qui représente une faille majeure en matière de transparence financière.
Recettes fiscales et dépenses publiques : anomalies et pertes importantes
Si certaines catégories d’impôts, comme l’impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux (BIC) ou l’impôt sur les salaires (ITS), ont connu des taux de réalisation supérieurs aux prévisions, d’autres rubriques présentent de graves insuffisances : absence totale de collecte pour la taxe sur la main-d’œuvre et les impôts sur la propriété, alors qu’ils étaient inscrits au budget ; déficit marqué des accises (taxes sur les produits pétroliers, ciment, sucre, thé, tabac), avec un taux de réalisation de seulement 82,6 %, entraînant une perte de plus de 650 millions MRU ; non-recouvrement de la patente, inscrite dans la taxe sur le chiffre d’affaires, dont les recettes se sont avérées nulles. Ces défaillances traduisent, selon la Cour, un manque de suivi rigoureux et une faiblesse dans le recouvrement des impôts, privant ainsi l’État de ressources essentielles pour financer ses politiques publiques.
Côté dépenses, la Cour met en évidence des écarts inexpliqués dans les subventions et transferts, dont près de 10 milliards MRU demeurent non justifiés ; l’enregistrement de certaines taxes (notamment la taxe d’apprentissage) dans des comptes spéciaux du Trésor, en contradiction avec la nomenclature budgétaire officielle ; un déficit budgétaire global qui s’est établi à 12,2 milliards MRU, certes en amélioration par rapport aux prévisions, mais financé, en grande partie, par des mécanismes bancaires et des avances du Trésor, posant la question de la soutenabilité de la dette intérieure.
Lacunes structurelles, risques de malversations et gestion désastreuse
Au-delà des chiffres, le rapport met en évidence des pratiques problématiques pouvant ouvrir la voie à des malversations : non-alignement du Compte Général de l’Administration Financière (CGAF) avec les réformes fiscales en vigueur, entraînant une opacité dans la comptabilisation de certaines recettes ; insuffisance de contrôle sur les recettes issues des prestations des non-résidents, pourtant budgétisées à plus de 2,7 milliards MRU mais absentes des réalisations ; dépendance excessive aux financements extérieurs dont la gestion échappe encore aux circuits classiques de reddition de comptes.
Au ministère de la Santé, des dépassements budgétaires de plusieurs milliards d’ouguiyas, des contrats passés sans respect des règles de marchés publics et des programmes mal exécutés ont été relevés. Avec un budget de 4,66 milliards d’ouguiyas en 2021, le ministère affiche un déficit de 278 millions. La Cour signale, notamment, la passation directe de contrats, des retards de livraison dépassant 1 300 % et des dépenses non justifiées, dont 40 millions d’ouguiyas versés à une société pharmaceutique hors cadre contractuel. Des équipements médicaux défectueux ou inutilisés et des programmes sous-utilisés révèlent des lacunes persistantes dans la planification et le contrôle. Un accord conclu avec le laboratoire suisse Roche, pour la fourniture de médicaments contre le cancer et l’insuffisance rénale, s’est accompagné d’un manque de documentation sur la réception des produits et d’un retard de paiement de 71 millions d’ouguiyas. La Cour dénonce, en outre, l’acquisition d’équipements médicaux coûteux, tels que des stations à oxygène défectueuses ou inutilisées, ainsi que des générateurs neufs achetés pour un hôpital déjà équipé. Le programme de santé reproductive n’a mobilisé que 77 % de son budget, faute d’une base fiable de données. Quant au programme de sécurité routière, doté de 63,7 millions d’ouguiyas, il souffre d’une mauvaise planification et de la disparition inexpliquée de matériel.
La Caisse nationale d’assurance maladie (CNAM) est, elle aussi, au cœur des préoccupations de la Cour. L’institution dénonce l’absence d’un plan comptable propre à la caisse et d’une base fiable de données regroupant les cotisants et les assurés. Cette situation, selon le rapport, met en péril la continuité et la fiabilité du service public d’assurance-maladie.
Anomalies à la pelle, endettement hors contrôle, impayés colossaux
À la SOMELEC, la société nationale d’électricité, la Cour pointe des dettes colossales, une accumulation de factures impayées et des anomalies dans la gestion des marchés publics. La dette globale a explosé et l’entreprise peine à assurer la régularité de la fourniture d’électricité. Entre 2021 et 2022, cette dette est passée de 385 % à 800 %. Ses fonds propres, qui devraient représenter au moins 50 % de ses ressources, se limitent désormais à 17 %, mettant en péril sa capacité à financer ses activités courantes. La société traîne également une montagne de factures impayées. Plus de 20 000 abonnés n’ont jamais réglé leurs consommations, parfois depuis plus de vingt ans, pour un total avoisinant 6 milliards d’ouguiyas anciennes. Malgré ces arriérés, leur alimentation en électricité n’a jamais été interrompue, en contradiction avec la réglementation. Les administrations publiques figurent aussi parmi les mauvais payeurs, avec près de 6 milliards d’ouguiyas anciennes d’impayés.
Gestion archaïque, personnel précaire, pertes énergétiques faramineuses
La Cour dénonce, par ailleurs, un système informatique obsolète, incapable d’assurer un suivi rigoureux des abonnés. Sur le plan social, plus de la moitié du personnel (57 %) travaille sans contrat, dans une précarité qui fragilise encore davantage l’entreprise. Chaque année, la SOMELEC enregistre des pertes techniques et commerciales évaluées à plus de 700 000 MWh, représentant un manque à gagner supérieur à 28 milliards d’ouguiyas anciennes.
Concernant Mauritania Airlines, la compagnie aérienne nationale reste plombée par une gouvernance lourde, des anomalies comptables et des arriérés fiscaux dépassant 270 millions MRU. L’immobilisation prolongée de plusieurs avions a contraint la compagnie à recourir à la location d’appareils, grevant sa trésorerie malgré une recapitalisation publique de 4,8 milliards MRU. La Cour des comptes appelle donc à un assainissement urgent de la gestion publique : renforcement du contrôle interne, régularisation des comptes, récupération des fonds détournés et recentrage des activités sur les missions prioritaires, afin de rétablir la transparence et protéger les finances publiques.
Hydrocarbures et mines : contrats opaques et manque de suivi
Le secteur des hydrocarbures mauritanien est à nouveau épinglé par la Cour des comptes. Dans le secteur des hydrocarbures et des mines, la Cour relève des irrégularités majeures dans la conclusion des contrats d’exploration et d’exploitation. Elle note un irrespect des procédures de négociation et une absence de suivi des engagements contractuels, notamment ceux relatifs à la formation et à la qualification des cadres nationaux. Le rapport évoque aussi une prise en compte insuffisante des risques environnementaux, lors de l’attribution des permis miniers, une carence qui expose le pays à de graves conséquences écologiques à long terme.
Dans son rapport annuel 2022-2023, l’institution révèle de graves dysfonctionnements dans la gestion du compte de soutien aux hydrocarbures raffinés, ainsi que des fonds d’avance liés aux mines de cuivre. Selon le document, plus de 411 millions d’ouguiyas nouvelles ont été dépensés en dehors des objectifs fixés. La Cour relève que 85 % des dépenses de 2022 ont été consacrées à des primes exceptionnelles, tandis que le reste a servi à financer des frais de fonctionnement, l’entretien de véhicules et l’achat de matériel de bureau, en violation des règles en vigueur.
Les magistrats financiers pointent également une quasi-absence de contrôle : les dépenses ont été engagées sans délégation officielle, ni comptable, ni vérificateur, ce qui constitue une infraction manifeste à la réglementation. S’agissant des fonds d’avance engagés avec la Société mauritanienne des mines de cuivre, près de 40 % des dépenses sont jugées injustifiées. Là encore, des sommes importantes ont été utilisées pour des dépenses secondaires – entretiens de véhicules, mobilier – au détriment des finalités stratégiques prévues.
Même topo dans les infrastructures routières, réforme globale urgente
Le rapport revient également sur les défaillances observées dans la mise en œuvre du projet routier Néma–Bassiknou–Fassala. Les auditeurs dénoncent des retards injustifiés, le paiement de montants pour des travaux non-exécutés et l’absence d’application des pénalités prévues par les clauses contractuelles. Ces manquements, selon la Cour, compromettent la qualité et la durabilité des infrastructures publiques. Face à ces dérives, la Cour des comptes appelle à un resserrement urgent des mécanismes de contrôle et à un recentrage des dépenses sur leurs objectifs légaux, afin d’assurer une gestion transparente et responsable des finances publiques dans un secteur considéré comme vital pour l’économie nationale. Aussi la Cour des comptes invite-t-elle les autorités mauritaniennes à renforcer les mécanismes de contrôle interne, à améliorer la fiabilité des prévisions budgétaires et à garantir une comptabilisation rigoureuse des recettes et dépenses dans les comptes du Trésor. Elle insiste sur la nécessité d’une réforme profonde de la gouvernance financière afin de restaurer la confiance dans la gestion des fonds publics et d’assurer la transparence dans l’utilisation des ressources nationales.
Synthèse KAAW Thierno