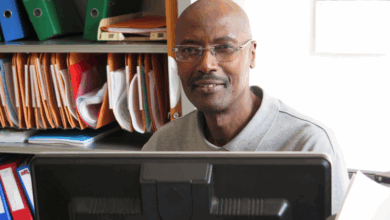Il est des moments où le vacarme des réseaux sociaux s’imagine être l’écho de la conscience. Il confond la rumeur avec la lucidité, la provocation avec la pensée. Pourtant, à bien y regarder, ce tumulte n’est souvent qu’un miroir déformant où les blessures d’hier servent d’alibi aux aveuglements d’aujourd’hui.
Une photo a récemment circulé, brandie comme la preuve d’un mal ancien — l’« armée des uns » contre l’« armée des autres ». Mais la photo n’était pas celle d’une armée. Elle représentait la Douane mauritanienne, ce corps singulier, rattaché non pas à la Défense, mais aux Finances de l’État, où la rigueur du service se mesure non à la couleur de l’uniforme , mais à la probité de celui qui le porte . Avant de juger une image, encore faudrait-il en connaître l’histoire.
La Douane n’est pas née d’un clan : elle fut bâtie par des hommes de toutes les origines , soudés par l’idée que servir l’État est plus grand que servir soi-même. Les noms parlent d’eux-mêmes : À tout seigneur, tout honneur : le premier directeur de l’histoire douanière de notre pays, le père fondateur Ba Babakar Mamadou, a marqué cette institution dès ses origines. Il y servit avec dévouement de 1962 à 1971, succédant au français Maisondieu Étienne, qu’il remplaça avec exemplarité et compétence, feu le colonel Kane, feu le colonel Cissé, feu le colonel M’bayar Fall, feu le colonel Mangane, l’inspecteur Kane Elimane , le colonel Doudou Seck, le colonel Wane, le colonel Habib Fall —….. et la première femme colonel de la douane du pays, negro-mauritanienne , pionnière discrète d’une fonction jadis masculine.
À leur suite, un homme a incarné la constance républicaine : le général de brigade Ndiaga Dieng, douze années durant directeur général de la Douane — un record de fidélité institutionnelle que nul n’a égalé. Et aujourd’hui encore, le système informatique national SYDONIA est administré par le colonel Abdel Kerim Aw , symbole d’une compétence qui n’a ni couleur ni tribu.
Ainsi va cette maison d’État : elle recrute par concours, non par connivence. Elle récompense le mérite, pas la cacophonie.
Mais certains, au lieu de comprendre cette vérité simple, préfèrent la tordre pour nourrir des mythologies commodes. Ils ne dénoncent pas une injustice : ils en vivent. Ils n’analysent pas la société : ils la segmentent, comme on découpe un territoire pour mieux y régner.
Leur verbe se nourrit du ressentiment qu’ils prétendent combattre, et chaque mot qu’ils jettent dans l’espace public n’est qu’une pierre de plus sur le pont fragile de la cohésion nationale.
Il est aisé d’invoquer la mémoire des victimes quand on la brandit comme un étendard, moins aisé de la respecter en refusant qu’elle serve d’instrument politique.
La véritable mémoire ne s’affiche pas : elle se garde, se médite, s’élève.
On entend parfois dire que l’unité nationale ne serait qu’un mirage, une ruse du fort pour rassurer le faible. Mais cette vision cynique trahit moins la société qu’elle ne révèle le regard de celui qui parle.
Car, au fond, ceux qui m’accusent de n’être qu’une « unité du cheval et du cavalier » finissent par confesser leur propre désir de selle.
Ils dénoncent une domination pour mieux la convoiter. L’histoire récente nous enseigne qu’il est plus facile d’exclure les morts que de contredire les vivants.
Lorsque j’ai simplement rappelé une citation publique de Mohamed Yehdhih Ould Breideleil prononcée lors d’une conférence organisée par le Forum pour la pensée et le dialogue démocratique le 9 juin 2007, sous le thème « L’expérience démocratique en Mauritanie» , on m’a aussitôt accusé d’avoir « insulté la mémoire » des disparus. Mais je m’interroge : où était cette mémoire en 2019, lorsque Biram Dah Abeid, leur leader d’hier et d’aujourd’hui, s’est déplacé jusque chez Ould Breideleil, au Ksar, pour y sceller un pacte politique ? Et où était-elle encore lorsque le même Biram rejoignait, sans scrupule apparent, le PRDS, parti du pouvoir d’alors ? Certains, qui hier se taisaient lorsque se nouaient ces alliances, redécouvrent soudain la vertu de l’indignation. Ils brandissent des photos, exhument des visages, distribuent des condamnations tardifs.
Mais la mémoire, la vraie, ne se réécrit pas au gré des vents politiques : elle s’enracine dans la vérité ou elle s’effondre dans l’oubli. Je ne répondrai pas à l’insulte — ni au mot « nihiliste », ni à celui de « négationniste », ni à celui de « mbourou fof ko farine ». Ces mots, utilisés par ceux qui manient les émotions comme d’autres manipulent des allumettes, brûlent plus leurs auteurs que leurs cibles.
J’ai choisi le silence, non par faiblesse, mais parce qu’il est devenu la dernière élégance possible dans un monde où tout s’écrit sans penser, où tout s’exhibe sans comprendre. Je ne m’adresserai plus à ceux qui préfèrent la haine à la complexité. Car il arrive un moment où écrire devient un acte de résistance, mais aussi un geste de renoncement : celui de dire que l’on ne veut plus se battre dans la boue du verbe. Il est des pays où l’on débat pour construire, et d’autres où l’on s’écharpe pour exister. Le nôtre est encore entre les deux. Mais tant qu’il restera des hommes capables de défendre la vérité sans crier, de rappeler les faits sans humilier, et de servir la République sans haine , alors tout ne sera pas perdu.
Mohamed Ould Echriv Echriv
Suggestion Kassataya.com :
MISE AU POINT : QUAND LES MASQUES D’UN MATAMORE TOMBENT !
Les opinions exprimées dans cette rubrique n’engagent que leurs auteurs. Elles ne reflètent en aucune manière la position de www.kassataya.com
Diffusion partielle ou totale interdite sans la mention : Source www.kassataya.com