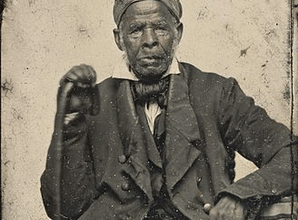– Enquête – Essor des guerres et hausse des troubles mentaux, dévaluation de la parole et perte du rapport à la réalité sont les signes inquiétants du basculement de nos sociétés. Il y a presque un siècle, Freud diagnostiquait un mal-être qui fait écho à celui que nous traversons.
Quelque chose ne tourne pas rond. D’inquiétants signaux donnent l’impression que nos sociétés sont au bord de l’implosion. Il faut dire que chaque jour apporte son quota d’accablement, son flot de sidération, son lot de commotions. L’actualité mortifère n’épargne aucun sujet, ni aucun front. La guerre en Ukraine et l’écrasement de Gaza, les femmes contraintes au mutisme en Afghanistan, le complotisme qui, de Washington à Moscou, gagne les plus hauts sommets de l’Etat. Mais aussi les tueries sans raison, les suicides en série, les réseaux sociaux où déferlent tant de pulsions incontrôlées et de harcèlements ciblés.
Le climat morose ne relève pas d’une confuse sensation. Des données objectives étayent le tableau d’une époque mortifère. Les guerres prolifèrent : selon un rapport de l’Institut de recherche sur la paix d’Oslo, paru le 11 juin, 61 conflits ont été enregistrés dans le monde en 2024, ce qui les porte à leur plus haut niveau depuis 1946. Indicateur de la désorientation psychique, les maladies mentales s’amplifient : une personne sur huit dans le monde souffre d’un trouble mental, les symptômes anxieux et dépressifs étant les plus fréquents, d’après un rapport de l’Organisation mondiale de la santé, publié en 2022. La consommation et le trafic de stupéfiants explosent, l’anomie sociale s’étend, l’addiction numérique relaye obscurantisme, complotisme et haines identitaires.
En 1930, Sigmund Freud (1856-1939) faisait prudemment l’hypothèse que nos sociétés étaient devenues « névrotiques ». L’inventeur de la psychanalyse diagnostiquait que l’Occident était traversé par un Malaise dans la civilisation. Le coût psychique du renoncement aux pulsions exigé pour faire société devenait trop élevé pour les individus et créait d’immenses tensions. Selon Freud, « la question décisive pour le destin de l’espèce humaine » consistait à « savoir si et dans quelle mesure son développement culturel réussira[it] à se rendre maître de la perturbation apportée à la vie en commun par l’humaine pulsion d’agression et d’auto-anéantissement ».
Après la guerre de 1914-1918, Freud avait, en effet, réformé sa conception de l’appareil psychique. A côté du « principe de plaisir » (qui repose sur la recherche de la satisfaction du désir et l’évitement du déplaisir) et du « principe de réalité » (qui s’appuie sur la capacité du sujet d’ajourner la satisfaction pulsionnelle face aux exigences du monde extérieur), le psychanalyste avait forgé, en 1920, la notion de « pulsion de mort », cette propension à détruire et à s’anéantir. Une pulsion d’agressivité particulièrement menaçante au moment où « les hommes ont porté si loin leur domination des forces de la nature qu’avec leur aide, il leur est facile de s’anéantir mutuellement jusqu’au dernier », disait-il.
Crise du langage
Le « plus jamais ça » issu de la Shoah, le droit à l’autodétermination né de la décolonisation et la chute du mur de Berlin semblaient placer l’Europe sur la voie de la pacification. Les massacres de Srebrenica (en juillet 1995), en Bosnie-Herzégovine, et de Boutcha (en mars 2022), en Ukraine, comme la nouvelle guerre des drones, démontrent qu’il n’en est rien. Et la parenthèse se referme sur un continent où, comme le disait Edgar Morin, « la barbarie n’est pas seulement un élément qui accompagne la civilisation, elle en fait partie intégrante ». C’est pourquoi, malgré leur inscription dans un contexte historique singulier, ces réflexions, menées alors que la crise financière de 1929 fut qualifiée de « Grande Dépression » et que les nazis consolidèrent leur position au Reichstag lors des élections de 1930, entrent en résonance avec notre époque désorientée et dépassent largement les frontières de l’Occident.
Le nouveau malaise dans la civilisation se manifeste tout d’abord par une crise du langage. Les mots ne correspondent plus aux réalités qu’ils sont censés désigner. Le signifiant ne s’accorde plus au signifié. « Nous assistons à un détricotage du langage », affirme la philosophe et psychanalyste Hélène L’Heuillet. Les dictatures nous ont habitués à ce retournement sémantique, parfaitement illustré par les slogans du pays imaginaire d’Océania, la patrie totalitaire portraiturée par George Orwell dans 1984 (Gallimard, 1950, en français) : « La guerre, c’est la paix. La liberté, c’est l’esclavage. L’ignorance, c’est la force. »
Selon l’académicienne Barbara Cassin, « le langage est un bon baromètre de ce que nous vivons et sentons ». Depuis Aristote, nous savons que l’homme est un animal politique parce qu’il est un animal parlant, rappelle-t-elle. C’est pourquoi « il faut s’intéresser au langage de ceux qui, pour le meilleur et pour le pire, et en l’occurrence pour le pire, gouvernent notre monde », analyse la philologue, qui a publié La Guerre des mots (Flammarion, 176 pages, 18,90 euros).
Donald Trump et Vladimir Poutine sont tous deux « conscients de la puissance du langage », au point d’« inventer chacun une novlangue adaptée à leurs desseins ». Le président américain parle « comme un ado mal dégrossi, à coups de likes et de vantardises », alors que son homologue russe, lui, « adopte tous les niveaux de langue, y compris le “mat”, l’argot des bas-fonds », développe-t-elle. Le mensonge des deux autocrates est permanent : pour Trump, le dérèglement climatique serait « la plus grosse escroquerie jamais organisée aux dépens du monde » ; selon Poutine, l’invasion de l’Ukraine n’est pas une guerre, mais une « opération spéciale ».
« Pur non-sens »
Le plus déstabilisant, sans doute, précise Barbara Cassin, c’est que « l’un comme l’autre font ce qu’ils disent, à notre étonnement de vieux démocrates blasés ». C’est ce dont témoignent notamment l’intensification des raids antimigrants ou l’application des droits de douane aux Etats-Unis, alors que la parole publique serait devenue « une langue morte » pour les électeurs des vieilles démocraties, comme le disait, en 2014, l’ancien premier ministre Manuel Valls.
« Les exemples pullulent, même dans l’actualité politique la plus immédiate », observe Hélène L’Heuillet, autrice de Tu haïras ton prochain comme toi-même (Albin Michel, 2017). Dire que l’économiste Gabriel Zucman est « un militant d’extrême gauche », comme l’ont déclaré le milliardaire Bernard Arnault et les médias du groupe Bolloré, ou bien affirmer que la condamnation de Nicolas Sarkozy dans l’affaire des financements libyens démontre que « toutes les limites de l’Etat de droit ont été violées », comme l’estime l’intéressé, témoigne de cette « inversion perverse du langage », déclare-t-elle.
Car il ne s’agit pas d’une critique de la taxation des plus fortunés dans un cas, ou de la remise en cause de l’exécution provisoire des peines dans l’autre, mais d’« un pur non-sens » : Gabriel Zucman est certes un progressiste engagé, mais ses propositions ne visent pas à sortir du capitalisme, comme le souhaite au contraire l’extrême gauche politique. Quant à la magistrate qui a condamné Nicolas Sarkozy, le 25 septembre, elle n’a fait qu’appliquer une loi adoptée par le Parlement en 2019.
« La manœuvre idéologique est évidente, mais elle contribue à l’évidement du langage, relève Hélène L’Heuillet. Cette confusion est inquiétante, car le pacte social repose sur une correspondance entre le signifiant et le signifié », sans laquelle il devient impossible de se parler, explique-t-elle. Cette manière de « décrire une situation diamétralement opposée à la réalité » correspond à ce qu’on appelle en rhétorique l’anticatastase, à savoir une tromperie désinhibée « qui n’a plus la décence de se cacher », fait observer le politologue et chroniqueur Clément Viktorovitch dans Logocratie (Seuil, 304 pages, 20,90 euros), essai sur la façon dont les démocraties sont, à leur tour, minées par « la corruption du langage ».
La parole semble dévaluée dans l’espace public mais aussi dans la vie sociale. Conduire son existence au temps des « vérités alternatives » est une expérience troublante : comment vivre ensemble lorsque la vérité n’est plus ce qui est, mais ce que l’on souhaiterait qu’elle soit ? Et les psychanalystes prennent comme un symptôme de la désorientation du moment les manquements quotidiens à la parole donnée : « Les médecins mais aussi les restaurateurs se plaignent des rendez-vous pris et non tenus, remarque Hélène L’Heuillet. Dans un monde où rien ne paraît ni fiable ni solide, l’individu tend à se moquer de ce qu’engage le langage, et la sociabilité s’en trouve affectée. »
Le nouveau malaise dans la civilisation est ainsi marqué par un « effondrement sémantique », abonde la sociologue Eva Illouz, autrice d’Explosive modernité (Gallimard, 448 pages, 24 euros), une réflexion sur le « malaise dans la vie intérieure » qui prend au sérieux « ce qui n’intéressait pas Freud » dans son célèbre ouvrage de 1930, dit-elle : la politique, l’économie et l’idéologie. Cette faillite du langage témoigne d’un immense brouillage des catégories qui nous permettaient jusqu’alors d’appréhender la réalité. Aujourd’hui, par exemple, « le fascisme ne s’oppose pas à la démocratie, mais il se niche en son sein ». Les repères historiques et éthiques vacillent à tel point que « c’est la catégorie de réel qui s’effondre sous nos pieds ».
Diffusion partielle ou totale interdite sans la mention : Source www.kassataya.com