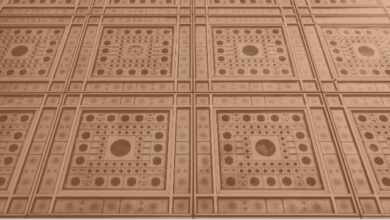Il y a un an, le 4 juin 2009, les trois pôles de la crise institutionnelle, provoquée par le putsch du 6 août 2008 contre le président élu Sidi Ould Cheikh Abdellahi, signaient à Nouakchott le fameux accord de Dakar qui avait officiellement mis fin à la crise et ouvert la voie à l’organisation de l’élection présidentielle du 18 juillet
Il y a un an, le 4 juin 2009, les trois pôles de la crise institutionnelle, provoquée par le putsch du 6 août 2008 contre le président élu Sidi Ould Cheikh Abdellahi, signaient à Nouakchott le fameux accord de Dakar qui avait officiellement mis fin à la crise et ouvert la voie à l’organisation de l’élection présidentielle du 18 juillet
remportée au premier tour par le candidat, Mohamed Ould Abdel Aziz. Depuis, la polémique enfle sans cesse entre le nouveau président et sa désormais opposion. Le premier estimant que l’effet de cet accord ne depasse pas l’organisation du scrutin, alors que les autres soutiennent qu’il va au-delà de ce délai et qu’il comprenait des clauses qui exigent un débat inclusif entre les partenaires.
Retour sur cet accord et sur ses différentes péripéties.
Fortement rejeté au départ au sein de la communauté internationale, le coup d’état du 6 août 2008 en Mauritanie ne manquait pas de soutiens extérieurs qui avaient réussi, à travers une alchimie complexe et un savoir-faire certain dans le domaine, à renverser la position internationale en sa faveur. Dans ce cadre, les réseaux de la Françafrique avaient joué un très grand rôle. D’abord, en convaincant le président Sarkosy d’être de leur côté dans la petite gueguerre avec les ennemis du putsch dans son administration. Et de les laisser faire. Ensuite en mettant à contribution le poids diplomatique de la France pour ‘‘adoucir’’ la position américaine et pour influencer celle de l’Union africaine qui, depuis le début de l’année 2009, était présidée par le bouillant Kadhafi qui, se moquant éperdument des valeurs démocratiques, n’a pas hésité à porter son dévolu sur la junte au pouvoir à Nouakchott. Celle-ci a su habilement l’entrainer dans son entreprise en gelant les relations de la Mauritanie avec l’Etat hébreu. Autre voisin important qui pèse lourd en Afrique, l’Algérie, avait lui également fini par apporter son appui aux putschistes dans les instances de l’Union africaine. Il est vrai qu’au début, le président Bouteflika s’était fortement opposé au putsch, sa position aurait fléchi à cause de l’influence de son armée qui voyait en Aziz, en plus d’être un frère d’armes, un allié fort sur lequel ils peuvent compter dans la lutte contre le terrorisme. Cette tendance s’est confirmée depuis la réunion du groupe consultatif en février 2009 à Paris. Après la visite en Mauritanie, en fin 2008, d’une mission conduite par un conseiller de Sarkozy, le gouvernement français avait fait sa ‘‘religion’’ en la matière et a opté définitivement pour le soutien de Aziz. Le travail de cette mission a permis d’introduire un troisième pôle politique dans l’équation : le RFD du leader de l’opposition démocratique Ahmed Ould Daddah, que certains diplomates croyaient qu’il pouvait être ‘‘utilisé’’ dans un scénario d’élection présidentielle sans le FNDD et son ‘‘encombrant’’ président Sidi que ce front cherchait, à l’époque, à ramener au pouvoir.
Début de la manœuvre
Le processus de légitimation du général Aziz a désormais un soutien de taille : le guide libyen. Le secrétaire général de l’Elysée, Claude Guéant, qui a la haute main sur les affaires africaines et sur bien d’autres dossiers, a toujours gardé avec Kadhafi de bonnes relations qui auraient bien été mises à contribution dans l’entreprise de blocage des sanctions africaines contre le HCE et de préparation du terrain pour ‘‘démocratiser’’ le régime mauritanien. Tout le monde se rappelle encore de la visite du président libyen dans notre pays, de sa ‘‘prière’’ au Stade et ce qui en est suivi : un soutien du guide au calendrier déjà fixé au 6 juin pour le scrutin présidentiel. Le groupe consultatif pour la Mauritanie ne sert plus à grand-chose d’autre que chercher à normaliser la situation du pouvoir de fait à Nouakchott. L’opposition d’Aziz à l’intérieur, qui s’est agrandie pourtant par la suite après l’arrivée du RFD, perdait au même moment le soutien de la communauté internationale influencée par l’effort soutenu de l’ancienne puissance coloniale en faveur des auteurs du putsch. Presque la majorité des diplomates occidentaux accrédités à Nouakchott avait fait savoir leur position à l’opposition et ne cachait plus leur penchant pour Aziz. Mais jusqu’ici, il restait à trouver l’habillage ‘‘démocratique’’ à leur objectif. Dans ce cadre et au moment où les opposants au putsch commençaient réellement à s’interroger sur l’avenir de leur œuvre politique et les moyens nécessaires à mettre en œuvre pour faire échouer le rendez-vous du 6/6, intervint l’initiative sénégalaise. L’un des négociateurs de l’opposition juge qu’elle est venue au très bon moment où l’opposition n’avait devant elle que d’engager la confrontation avec tout ce que cela comporte comme danger pour le pays ou le forfait de la capitulation. Sur les raisons de l’intrusion subite des sénégalais dans le dossier mauritanien, celui-ci l’explique par le besoin, à l’époque, pour le président Wade d’un succès quelconque afin de se laver de la défaite cuisante de son camp dans les élections locales et, certainement, ajoute-t-il, pour aider ses amis de la françafrique à faire passer leur coup dans les formes qu’exige la démocratie. Pourtant, Gadio, le ministre des Affaires étrangères du Sénégal était lors de son premier passage presque boudé par le camp de l’opposition qui reprochait à Wade son soutien déclaré au coup d’état. Voulant à tout prix atteindre son objectif, le ministre essuie les critiques de la position de son pays dans la bonne humeur. La hardiesse le poussa même jusqu’à forcer la porte du domicile de Sidi à Lemden. A tous ses interlocuteurs, il disait que sa démarche était soutenue par la communauté internationale. Son deuxième voyage dans le pays sera plus calme et ses arguments deviennent de plus en plus recevables chez l’opposition. D’autant plus qu’il est revenu accompagné de Ramdane Lamamra, président du Conseil pour la Paix et la Sécurité à l’Union Africaine. Les deux émissaires arrivèrent même à élaborer un draft d’accord entre les parties qui sera rejeté par les représentants de l’opposition qui exigeaient la libération de leurs amis en prison et la renonciation au 6/6 comme préalable à toute entreprise de dialogue. Des points encore irrecevables dans le camp du général. Même si rien n’avait avancé, c’était là les premières démarches qui avaient donné naissance au processus de Dakar.
Processus de Dakar
Sur le terrain est né ce qui est devenu carrément l’iniative du président Wade pour résoudre la crise politique en Mauritanie. Le vieil homme, rompu aux manœuvres et qui n’était pas à sa première médiation, décide d’inviter les protagonistes de la crise à Dakar pour essayer de trouver un scénario de sortie de crise acceptable par tout le monde. Avec eux, il avait invité les membres du groupe de contact international qui travaillait déjà sur le dossier en plus des membres du conseil de sécurité saisi lui aussi de l’affaire. La délegation désignée par Aziz était dirigée par son directeur de campagne, Sid’Ahmed Ould Rayess. Celle du RFD était présidée par l’ancien ministre, Abderrehmane Ould Moïne. Mohamed Ould Mouloud, président de l’UFP, avait en charge la délégation qui représente le FNDD.
Après plusieurs jours de négiciations ponctuées souvent par des revirements dans les positions du camp de Aziz, les trois parties arrivent à s’entendre sur une formule appelée l’accord de Dakar et qui consiste à la formation d’un gouvernement d’Union Nationale dont le décret de nomination sera signé par le président Sidi avant sa démission ‘‘volontaire’’…
Conclu le 2 juin 2009, la mise en place de cet accord sera retardé jusqu’au 4 juin, à cause du problème des prisonniers du FNDD : l’ancien premier ministre de Sidi et quelques autres personnalités. N’étant pas citée très clairement dans les termes de l’accord, Aziz refuse de mettre à exécution cette clause. Les autres refusent d’envisager la signature d’un quelconque accord avant cette libération. Il a fallu l’intervention du patronnat qui avait décidé de payer les cautions exigées pour la libération des détenus. Ce qui permit la signature solennelle de l’accord en présence du président Wade dans une grande cérémonie tenue au palais des Congrès le 4 Juin. On crut alors que tout était fini et qu’il ne restait plus qu’à mettre en place le gouvernement de transition pour commencer la préparation du scrutin. Erreur ! Le président Sidi a tenu à faire savoir qu’il ne signe pas le décret de nomination du gouvernement avant la dissolution du Haut Conseil d’Etat (HCE). Cette clause n’a pas été également écrite dans l’accord mais les facilitateurs avaient pris l’engagement pour la réaliser… S’engage alors une nouvelle bataille qui va durer un peu moins d’un mois et qui connaîtra surtout le changement du négociateur en chef du camp de Aziz –Mohamed Yahya Ould Horma jugé plus polémiste est désigné à la place de Ould Rayess- et le positionnement désormais affiché des ambassadeurs européens pour soutenir les thèses développées par Aziz. Au cours de l’une des réunions du groupe de contact et de suivi à Nouakchott, l’amabassadeur de France étant absent du pays, le conseiller qui le remplace a tenu à transmettre un message du gouvernement français pour dire clairement qu’il reconnaîtra les résultats d’un scrutin présidentiel même s’il est boycotté par certaines parties. Une manière pour dire qu’ils s’enfoutent de la démission de Sidi. Face à ce blocage, Wade décide d’appeler les parties de nouveau à Dakar. C’est ce qu’on appelle communement Dakar II. La France et l’Espagne, contrairement à Dakar I où ils avaient été représentés par leurs ambassadeurs à Dakar, décident de les remplacer par ceux accrédités à Nouakchott, de véritables avocats de la ‘‘rectification’’. Leur mission consistait à apporter leur soutien aux thèses développées par les missionnaires du général. Les sénégalais n’étaient sur la même longueur d’onde qu’eux. Ces derniers tenaient absolument à enregistrer un succès diplomatique et oeuvraient pour la participation de toutes les parties. Wade informa Sidi de l’hostilité des français contre lui et du constat que font leurs représentants à Nouakchott qui font courrir le bruit qu’il est un élément de blocage qui refuse tout compromis. Après de longs débats infructieux, le groupe décide de définir une formule à prendre ou à laisser : la transforamtion du HCE en conseil national de sécurité. Celui-ci s’était réuni pour s’autodissoudre juste quelque temps avant la démission de Sidi lors d’une grande cérémonie organisée au palais des Congrès. La décision de sa dissolution a été apportée à l’ancien président par la représentante du PNUD à Nouakchott.
Que reste-t-il de l’accord de Dakar ?
Rien ou presque. L’opposition accuse le président Aziz élu à l’issue de l’élection du 18 juillet d’avoir triché et de refuser d’appliquer l’accord de Dakar. Surtout de sa partie qui stipule la poursuite du dialogue national sur les autres points qui n’ont pas pu être abordée pendant la période pré électorale. De son côté, Aziz n’a, semble-t-il, jamais supporté cet accord et n’a fait que le saboter depuis sa mise en place. Il avait refusé de libérer les détenus du FNDD, a forcé la date de l’élection, n’a pas respecté la consigne concernant la neutralité des chefs de corps, les démembrements de la CENI, la gestion commune des commissariats des droits de l’homme et de la sécurité alimentaire, le décret de Mbaré convoquant les électeurs…
Pourquoi, si tel était le cas, ses adversaires avaient-ils accepté de s’engager dans la bataille électorale ? Ceux-ci étaient partis sur des bases et des données fausses. Il y a d’bord le fait que leurs violons n’étaient pas très bien accordés. Le RFD, par exemple, refusait toute idée de retour de Sidi, sauf pour présenter sa démission. Contrairement à lui, son allié, le FNDD, faisait de cela son cheval de bataille. Deuxième point sur lequel les deux alliés ne s’entendaient pas : la candidature des militaires. Elle ne dérangeait point le FNDD alors qu’elle était insupportable pour le RFD…
En plus de cela, la lecture que les deux parties faisaient de l’élection et de ses conditions était pour le moins erronée. Ils croyaient en effet dur comme fer que la fraude était impossible. Cette conviction a été appuyée par ce qu’ils constatient tous les jours : les gens qui quittaient en masse le général. Se fondant sur ce qu’ils voyaient, ils estimaient que Aziz n’avait aucune chance de passer. Les plus éveillés parmi eux ont commencé à parler de la fraude, juste à la veille du scrutin. Ils avient commencer à envisager une contestation des résultats. Mais lorsque leurs représentants n’ont rien pu déceller d’anormal dans les bueaux, leur calcul a échoué et leurs troupes carrément démobilisées.
Résultat : Aziz avait passé au premier tour. Son élection a été reconnue par les partenaires étrangers. L’opposition, comme un peu partout en Afrique, rue dans les brancards et crie à la fraude. Personne ne veut l’entendre ou au juste tout le monde refuse de la croire. Donc la crise institutionnelle a été dépassée mais elle s’est vite transformée en crise politique. Jusqu’à quand encore ?
Mohamed Mahmoud Targui
Source : www.rmibiladi.com le 06/06/2010