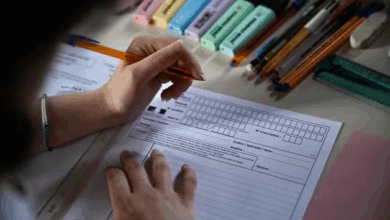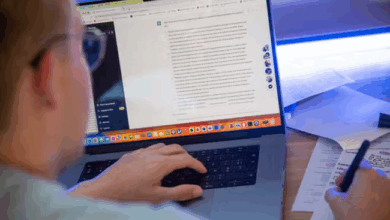– Histoire d’une notion – Pourquoi ne pas avoir parlé plus tôt ? Les victimes entendent souvent cette question. Mais « cette question est un luxe. Elle est l’apanage des privilégiés. De chanceux qui n’ont aucune idée du silence intérieur et gangrenant que génère une agression comme celles qui avaient cours à Bétharram », analyse Alain Esquerre dans Le Silence de Bétharram (éd. Michel Lafon, 256 pages, 18,95 euros). Ce livre de témoignages retrace les violences psychologiques, physiques et sexuelles commises sur des enfants dans l’établissement privé catholique et passées sous silence pendant cinquante ans.
Pourquoi certaines victimes de violences se taisent-elles pendant des années, parfois pendant toute une vie ? Pour Laurence Joseph, psychanalyste et psychologue, « le silence peut être un symptôme » : les violences sont alors refoulées, parfois jusqu’au black-out – un phénomène appelé « amnésie traumatique ».
Pour autant, ces dysfonctionnements mémoriels n’expliquent pas tout, tant s’en faut. « Si les victimes ne parlent pas, poursuit la psychanalyste, c’est aussi, trop souvent, parce qu’on les contraint à se taire : c’est ce qu’on appelle la silenciation, l’action de réduire quelqu’un au silence. » Et de citer Tacita, la déesse latine du silence, dont Jupiter coupa la langue avant qu’elle ne soit violée par Mercure : « Son silence était assuré puisque sa langue était arrachée. »
Dans le monde anglophone, la philosophe britannique Rae Langton serait la première à avoir théorisé la « silenciation » (silencing), dans son article « Speech Acts and Unspeakable Acts » (« actes de langage et actes indicibles »), paru en 1993. Le terme sera ensuite repris par d’autres chercheurs, comme la philosophe britannique Miranda Fricker, en 2009, ou la philosophe américaine Kristie Dotson, en 2011.
Côté francophone, le mot « silenciation » apparaît dans les années 1970, mais il n’est quasiment jamais employé. « Il faut attendre les années 2020, explique Elise Huchet, docteure en philosophie, pour que la notion se répande, portée par la vague MeToo et l’attention nouvelle accordée aux personnes invisibilisées. » Dans le même mouvement, le verbe « silencier » fait son entrée dans le Petit Robert en 2022.
Bâillonner, menacer ou isoler
Si ces termes ont émergé avec le mouvement MeToo, c’est parce que la silenciation est intimement liée aux rapports de pouvoir. « Etre puissant, c’est avoir parfois la capacité de silencier des personnes sans pouvoir », écrit Rae Langton. « Le silence n’est pas neutre, abonde Elise Huchet, autrice d’une thèse sur l’inaudibilité sociale. Il est le fruit de mécanismes sociaux de domination et d’oppression. » Les personnes qui risquent le plus d’être silenciées sont les enfants – le mot « enfant » vient du latin infans, « celui qui ne parle pas » –, mais aussi les femmes, les personnes racisées et, plus largement, toutes les minorités.
Certaines silenciations sont explicites, imposées par la contrainte : il s’agit de bâillonner, de menacer ou d’isoler. Mais la silenciation peut aussi être implicite : elle survient lorsque les conditions d’écoute ne sont pas réunies, ou que les normes sociales rendent des propos tabous. « Il faut enfin souligner que, paradoxalement, la silenciation n’implique pas l’absence de parole, poursuit Elise Huchet. Lorsqu’une personne s’exprime et que sa parole n’est pas suivie d’effets, elle est aussi silenciée. » C’est le cas quand une femme dit non à un rapport sexuel et que l’acte a lieu malgré tout. Ou d’un enfant qui raconte les agressions qu’il subit sans être cru par l’adulte à qui il se confie.
Dans tous les cas, les conséquences de la silenciation sont dévastatrices, au niveau tant individuel que collectif. « Sur le plan clinique, observe Laurence Joseph, une personne silenciée reste prisonnière de son histoire traumatique, qu’elle est condamnée à revivre sans cesse au présent. » Et d’ajouter : « A l’échelle de la société, lorsque des groupes sont silenciés, les rapports de domination perdurent et les lois n’évoluent pas. » Ainsi, il a fallu attendre 1990 pour que la Cour de cassation française reconnaisse le viol conjugal, et une loi de 2016 pour que l’adjectif « incestueux » soit inscrit dans le code pénal.
Si le silence est délétère, la libération de la parole, elle, est cathartique. « Pour une victime, parler est un tournant, analyse Laurence Joseph, autrice de Nos silences. Apprendre à les écouter (Autrement, 192 pages, 19 euros). Au départ, s’exprimer est lourd de conséquences : il y a des reviviscences traumatiques, il faut parfois aller porter plainte, une procédure difficile… Mais, lorsqu’on écoute une victime, lorsqu’on la croit, lorsqu’elle peut enfin nommer les choses, cela lui permet, bien souvent, de supporter son histoire. »
La littérature en particulier peut être un formidable outil pour mettre en mots son vécu. C’est vers elle que s’est tournée Vanessa Springora, qui, dans Le Consentement (Grasset, 2020), revient sur sa relation avec l’écrivain Gabriel Matzneff, qu’elle a rencontré en 1986, alors qu’elle avait 14 ans et lui, 50 ans. Le livre La Familia grande (Seuil, 2021), où Camille Kouchner retrace l’inceste dont a été victime son frère, a même débouché sur la création de la Commission indépendante sur l’inceste et les violences sexuelles faites aux enfants, en 2021.
Source : – (Le 03 septembre 2025)
Diffusion partielle ou totale interdite sans la mention : Source www.kassataya.com