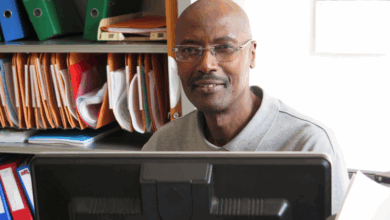Le Quotidien – Chaque fois qu’une affaire de viol défraie la chronique, elle nous ramène brutalement à une réalité glaçante : le système judiciaire montre ses limites et prive la majorité des victimes de recours effectifs. Sur le plan juridique, un acquittement veut dire que la personne est déclarée non coupable, non pas toujours parce qu’elle est reconnue innocente, mais parfois parce que les preuves apportées n’ont pas suffi à établir sa culpabilité au-delà de tout doute raisonnable.
Dans un véritable Etat de Droit, chaque citoyen·ne devrait être traité·e avec la même dignité devant la loi. Les victimes, souvent des femmes, doivent pouvoir compter sur la protection et l’écoute de la Justice, tout comme les personnes accusées ont le droit fondamental à un procès équitable. Passer des années en prison pour être finalement acquitté est une épreuve que personne ne devrait connaître : c’est d’autant plus cruel lorsqu’en réalité on n’a rien fait, et c’est tout aussi injuste quand la libération intervient simplement faute de preuves suffisantes pour établir les faits. C’est une injustice criante qui illustre les dysfonctionnements d’un système où les détentions préventives s’éternisent et où la lourdeur des procédures broie des vies.
Partout dans le monde, de nombreuses victimes se heurtent à l’absence d’éléments matériels et à un manque de moyens techniques. Il est en effet extrêmement difficile de réunir des preuves matérielles dans les affaires de viol, et cette faiblesse probatoire fait que, conformément au principe juridique, le doute profite toujours à l’accusé. Cette réalité traduit une violence institutionnelle qui s’ajoute à la violence subie, car elle réduit la parole des femmes à une simple suspicion. Les statistiques internationales montrent que plus de 80% des plaintes pour viol n’aboutissent pas à une condamnation. Autrement dit, moins d’1% des viols signalés se traduisent par une condamnation pénale aux Etats‑Unis, non pas parce qu’il n’y a pas eu agression, mais parce que le système échoue à documenter et établir la vérité. Cette incapacité à protéger les survivantes révèle un déséquilibre profond.
Loin de moi l’idée de dire que c’est le cas dans cette affaire largement commentée au Sénégal au cours de la semaine passée, mais je ne voudrais pas non plus que l’on se serve de ce dossier comme prétexte pour remettre en cause toutes les accusations ou toutes les condamnations de viol. Il faut rappeler avec force que la parole des femmes est déjà fragile et constamment contestée, et qu’instrumentaliser une affaire pour semer le doute général est une forme de violence supplémentaire. Les recherches internationales montrent que les fausses accusations de viol restent très marginales, entre 2 et 8% seulement des cas selon les études.
Autrement dit, la grande majorité des plaintes sont fondées. Pourtant, elles n’aboutissent pas toujours à des condamnations en raison du manque de preuves matérielles et des failles du système. C’est pourquoi il est extrêmement dangereux de mettre en avant quelques rares cas de fausses accusations pour discréditer l’ensemble des survivantes : cela revient à punir toutes les femmes pour les erreurs de quelques-unes. De plus, on ne voit jamais la même énergie déployée quand il s’agit de dénoncer l’énorme proportion de plaintes classées sans suite ou des dossiers étouffés. Cette banalisation sert à maintenir l’ordre patriarcal : elle détourne l’attention du problème central, qui est la protection des victimes, pour nourrir un discours de suspicion généralisée contre les femmes. C’est une stratégie de dénigrement qui renforce la culture du viol et qui décourage les survivantes de porter plainte.
Quand une société entière décide de se mobiliser pour défendre un accusé, aussi massive que soit cette mobilisation, cela en dit long sur nos réflexes collectifs. Elle envoie un message douloureux à des milliers de femmes, de filles et même de garçons aussi insoupçonnés que cela puisse paraître, victimes de violences sexuelles : celui d’une société plus prompte à protéger l’image des présumés coupables qu’à croire et soutenir celles qui dénoncent. Or, choisir de dénoncer coûte énormément aux victimes : c’est un chemin semé de jugements, de stigmatisations et parfois de menaces. C’est tellement difficile qu’une très grande partie préfère se taire, mais ce silence ne protège pas ; il enferme, il isole et il laisse les agresseurs libres de recommencer. Cette dynamique révèle combien les normes patriarcales continuent de dominer l’espace public : la parole des femmes est systématiquement mise en doute, relativisée, voire ridiculisée.
Le problème au Sénégal n’a jamais été l’existence de la loi criminalisant le viol et la pédophilie en tant que telle, mais bien son application. Alors pourquoi, dans une telle situation, ceux qui se donnent tant de peine à réclamer un retour en arrière sur la loi ne déploient-ils pas la même énergie pour plaider en faveur de son application rigoureuse ? Ce serait pourtant le vrai combat : garantir qu’aucune injustice ne soit commise, ni envers les personnes accusées ni envers les survivantes.
Et que dire de l’attitude des médias et plus largement de l’espace médiatique ? Dans un contexte où la recherche effrénée de clics et de vues dicte les priorités, trop de rédactions sacrifient l’éthique sur l’autel de l’audience. Les plateaux se bousculent pour l’exclusivité, déroulent le tapis rouge aux acquittés et, en même temps, alimentent la stigmatisation des victimes et de leurs familles. En banalisant la gravité des faits, ils ignorent la souffrance des personnes qui ont subi le préjudice et fragilisent la parole de toutes les femmes. Pire encore, beaucoup ont cherché à discréditer les initiatives visant à protéger les survivantes, uniquement pour délégitimer la loi criminalisant le viol. Depuis sa promulgation, cette loi fait couler beaucoup d’encre, mais pourquoi suscite-t-elle tant de peur ? Pourquoi effraie-t-elle ceux qui devraient se réjouir qu’un tel outil existe pour défendre les victimes ?
Le viol est l’un des crimes les plus difficiles à prouver, car il se joue souvent dans l’intimité, sans témoins, et parce que la honte ou la peur de l’opprobre réduisent trop de personnes au silence. Ce n’est pas pour autant qu’il ne faut pas réclamer la justice : l’atrocité du viol détruit souvent une vie entière.
Porter plainte est un acte de courage immense, mais aussi une épreuve qui expose les victimes à l’incompréhension, au jugement et parfois à la culpabilisation. Cela rappelle combien il est vital que la société se dote de moyens efficaces pour accompagner celles et ceux qui dénoncent, et sanctionner fermement les auteurs.
Une société juste ne peut pas choisir entre protéger les innocents et protéger les victimes. Elle doit faire les deux, avec la même fermeté, avec la même humanité.
Fatou Warkha SAMBE
Source : Le Quotidien (Sénégal)
Les opinions exprimées dans cette rubrique n’engagent que leurs auteurs. Elles ne reflètent en aucune manière la position de www.kassataya.com
Diffusion partielle ou totale interdite sans la mention : Source www.kassataya.com