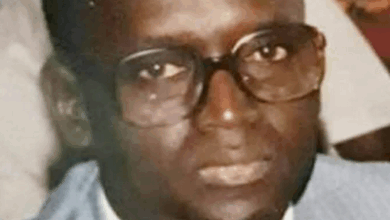The Conversation – L’intelligence artificielle (IA) suscite autant d’espoirs que d’inquiétudes dans le domaine de l’éducation. D’un côté, elle offre des outils puissants pour accompagner l’apprentissage, par exemple, en ajustant des exercices aux performances de chaque élève en maths, comme le font DreamBox ou Adaptiv’Math, ou en adaptant l’apprentissage des langues à l’âge de l’apprenant, comme Duolingo.
Mais elle peut aussi favoriser la paresse intellectuelle : les IA actuelles ne se contentent plus de fournir des pistes ou des chiffres comme les moteurs de recherche ou les calculatrices, mais produisent directement des contenus complets – résumés, essais, emails, codes informatiques – à la place de l’élève. Cette délégation excessive des tâches cognitives ouvre la possibilité d’une réduction de l’engagement dans la formulation des idées, la réflexion et la régulation du processus de production intellectuelle.
Cette tension concerne à la fois les élèves, les enseignants et les institutions, et soulève des questions essentielles : quel est le rôle de l’effort dans l’apprentissage ? Que signifie apprendre dans un monde où l’IA peut rédiger un texte, résoudre un problème ou générer une image en quelques secondes ?
Ni miracle technologique ni menace apocalyptique
Il existe toute une gamme d’usages possibles de l’IA en éducation, depuis des formes très passives et peu critiques, par exemple, lorsqu’un élève demande à une IA de résumer une lecture obligatoire sans lire ou analyser le contenu par lui-même, jusqu’à des intégrations créatives où les élèves collaborent avec une IA pour écrire des histoires, coder un jeu ou simuler une conversation avec un personnage historique, tout en exerçant leur jugement et leur pensée critique.
Il s’agit donc de dépasser les visions polarisées présentant l’IA soit comme une solution miracle, soit comme une menace pour les capacités cognitives humaines. Ces deux positions contiennent chacune une part de vérité, mais elles occultent une dimension essentielle : l’éducation vise avant tout le développement de la personne et de son autonomie.
Historiquement, l’IA a été pensée comme un moyen de simuler l’intelligence humaine. Lors de l’atelier fondateur de Dartmouth en 1956, où le terme « intelligence artificielle » a été proposé pour la première fois par John McCarthy, les chercheurs affirmaient que « chaque aspect de l’apprentissage ou toute autre forme d’intelligence peut être décrit de manière suffisamment précise pour qu’une machine puisse le simuler ».
Aujourd’hui, avec l’essor des modèles génératifs, cette promesse de simulation a laissé place à une dynamique de disruption : l’IA ne se contente plus d’imiter, elle remodèle nos manières d’apprendre. Les modèles génératifs comme ChatGPT ou Gemini produisent des contenus inédits (textes, images, vidéos), modifiant ainsi l’accès, la production, mais aussi la qualité de l’information.
Une école à la traîne face à l’essor de l’IA
Le développement rapide de ces outils dépasse largement la capacité des systèmes éducatifs à les intégrer de manière réfléchie. On observe un décalage entre le potentiel technologique et la capacité pédagogique d’aider les apprenants à en faire un usage approprié selon le contexte et leurs besoins d’apprentissage. L’enjeu n’est pas tant d’interdire ou de généraliser l’IA, mais de garantir que son utilisation soutienne réellement les apprentissages, en préservant l’effort intellectuel et les objectifs pédagogiques.
Les IA dites « génératives » (ou genIA), comme ChatGPT, permettent désormais de résumer, d’expliquer des textes de résoudre des problèmes ou encore de créer des images, des sons ou des vidéos. Leur usage peut être utile dans un cadre éducatif, notamment pour aider les enseignants à répondre aux défis révélés pendant la pandémie de Covid-19 : différenciation pédagogique, soutien à l’apprentissage autonome, accessibilité accrue.
Ainsi, une IA peut générer des explications d’un même concept à différents niveaux de complexité (on peut lui demander par exemple « Explique-moi ce concept comme si j’avais 5 ans »), ce qui permet à chacun d’avancer à son rythme dans une même classe. L’élève qui a des difficultés de compréhension pourra disposer ainsi d’éléments de connaissances préalables tandis qu’un élève avec une bonne progression pourrait obtenir des pistes d’approfondissement.
Mais, comme d’autres technologies auparavant présentées comme révolutionnaires (télévision éducative, tablettes, etc.), leur impact dépendra de l’intention pédagogique et de l’engagement des enseignants, des élèves et de leurs familles.
Professeure des Universités à l’Université Côte d’Azur et professeure associée à l’Universitat Internacional de Catalunya, Université Côte d’Azur
Source : The Conversation – (Le 23 août 2025)
Diffusion partielle ou totale interdite sans la mention : Source www.kassataya.com