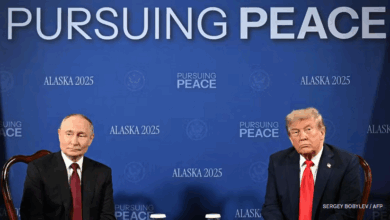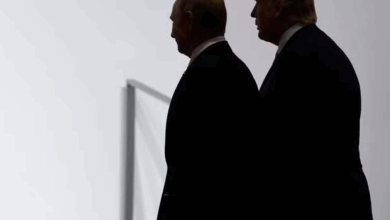Le Soleil – Les relations amoureuses cimentent les liens entre personnes et, au-delà, entre peuples et pays. Les fortes et séculaires relations sénégalo-marocaines n’échappent pas à la règle. Elles révèlent l’existence de liens forgés, dans le prolongement de l’amour, à travers les liens du mariage. Ces relations ne sont pas toujours faciles, eu égard aux différences socioculturelles. L’amour qui les unit semble néanmoins plus fort que tout et tient bon, malgré les bourrasques extérieures.
Unie depuis six ans à un Sénégalais, Sarah, marocaine, explique l’avoir « rencontré par hasard sur les réseaux sociaux ». « Ce fut tout de suite une belle connexion ». Elle éprouvera, au début, de nombreuses difficultés liées aux « différences culturelles, aux préjugés de certains proches et à la distance ».
Des obstacles qu’elle identifiera comme les « plus grands défis » qu’elle est parvenue, avec son mari, à surmonter. « Ce n’était pas évident, mais nos sentiments ont toujours été plus forts que les obstacles », analyse-t-elle avec recul.
Pour le couple de M. Bathily, marié depuis plus d’un demi-siècle, l’amour reste encore le moteur. Comme de nombreux autres, le jeune Sénégalais a rencontré sa dulcinée alors qu’il était étudiant dans le Royaume chérifien.
« Nous nous sommes rencontrés à Rabat. Je me promenais avec mes amis étudiants et j’ai aperçu la dame qui est devenue mon épouse. Nous nous sommes plu au premier regard. Il nous a fallu l’aide de mon grand frère pour obtenir l’accord des parents. Plus tard, nous nous sommes mariés en 1975 et notre couple tient encore aujourd’hui, par la grâce d’Allah », souligne le retraité, qui fait comprendre qu’il n’était pas, à l’époque, très facile pour une Marocaine d’épouser un étranger.
Aux réticences des parents, s’ajoutait l’inconnu, d’autant plus que la mariée devait rejoindre le pays de son mari. « Ce n’était pas évident pour la relation, mais par la grâce divine, tout s’est arrangé et, à la fin, les parents, très croyants, ont voulu faire passer le bonheur de leur unique fille », dit-il dans un éclat de rire.
Pour le troisième couple, déjà vieux de 15 ans, des circonstances ont favorisé la rencontre. « Avec mon mari, nous nous sommes connus par le biais d’une amie que nous avons en commun. Je dirais plutôt que ce sont des différences de valeurs liées à nos carrières professionnelles qui ont pu constituer des obstacles que nous avons dépassés. Le mariage était-il évident ? Je dirais oui et non, dans le sens où, oui, nous étions sûrs de notre amour, et non, parce que nos trains de vie étaient différents », soutient Leïla, qui a fini par rejoindre le Sénégal, s’y installer et y travailler.
Sarah, elle, nuance : « Le choix de venir vivre au Sénégal avec mon mari a été, tout d’abord, motivé par l’amour et des raisons personnelles », plus que par une motivation professionnelle. Le travail et les opportunités ont guidé le choix du pays pour le couple Bathily : le Sénégal. « Mais aussi là où l’on se sentait le mieux ensemble », explique-t-il.
Les différents couples disent avoir tenu, loin d’être indifférents, face aux regards extérieurs. « Notre union était écrite ; c’était une évidence. Le regard des autres ne m’a pas dérangée », affirme Leïla. « Avec le temps, on apprend à ignorer les jugements et à se concentrer sur notre bonheur », ajoute le vieux couple.
Pour la plupart des couples, l’union dépasse les différences puisqu’elle repose, la plupart du temps, sur le respect et l’amour sincère. L’adaptation s’est également faite aux deux cultures et traditions, pour les conjoints, indépendamment du pays dans lequel ils vivent.
Souvent, le « défi culturel » est perçu comme « une richesse à transmettre aux enfants ». Le leitmotiv semble être d’essayer d’équilibrer les deux cultures : langue maternelle de chacun, éducation ouverte et respectueuse pour la majorité des couples mixtes.
« Mes enfants sont nés au Sénégal et ont donc la nationalité sénégalaise. Ils reçoivent une éducation normale, pour ne pas dire trop stricte. Ils parlent arabe et français. En 1988, ils sont allés à Keur Madiabel. Mon épouse s’est bien adaptée aux différentes cultures du Sénégal et parle le wolof », révèle M. Bathily.
Leïla et son mari sont également motivés par l’enrichissement mutuel. « C’est parfois complexe, mais c’est aussi très enrichissant. On apprend beaucoup l’un de l’autre », soutient le mari. Tous les couples interrogés affirment que, si c’était à refaire, ce serait « sans hésitation », tant leur amour est encore fort et vivace.
« Chaque difficulté a renforcé notre lien », se remémore Sarah. « Je le referais sans le moindre regret », affirme Leïla. L’existence de ces couples mixtes contribue à une meilleure compréhension entre les peuples.
« On incarne ce pont entre deux cultures », ose l’un d’eux. « J’admire sa culture, son hospitalité et la richesse de ses traditions. J’apprends chaque jour à l’aimer davantage. Cela fait partie de la diversité culturelle et c’est très important pour la concorde entre les peuples », explique Sarah.
Nationalité accessible des deux côtés
Pour la nationalité marocaine des enfants issus de couples mixtes, il faut noter que, du temps de Hassan II, les enfants nés d’un père étranger n’avaient pas droit à la nationalité marocaine. Mais depuis le règne de Mohammed VI, ils peuvent l’acquérir, même s’ils naissent à l’étranger, explique une Marocaine. « Il suffit que la maman soit marocaine. Si le père est marocain, c’est automatique », souligne-t-elle.
Pour le Sénégal, le problème ne se pose pas puisque le père peut transmettre sa nationalité à ses enfants. Et, depuis quelques années, la mère sénégalaise, conjointe d’un étranger, peut également transmettre sa nationalité à ses enfants nés d’un père étranger.
Par Ibrahima Khaliloullah Ndiaye
- (Les noms sont d’emprunt afin de préserver l’anonymat souhaité par les personnes interrogées.)
Source : Le Soleil (Sénégal) – Le 15 août 2025
Diffusion partielle ou totale interdite sans la mention : Source www.kassataya.com