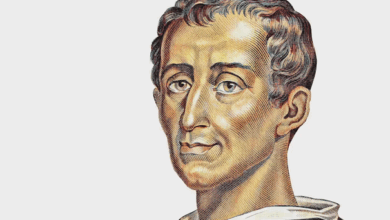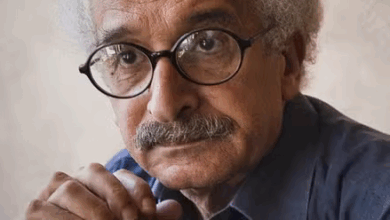– « Poutine a traversé de sacrées épreuves avec moi. » Il y avait une forme de compassion, l’idée d’une aventure commune ou la reconnaissance d’un préjudice subi, dans les propos de Donald Trump devant la presse début mars. La formule donnait un écho particulier aux accusations de connivence entre le milliardaire américain et le Kremlin, intenses depuis son entrée en politique il y a dix ans. Elle renforçait cette présomption de proximité aux ressorts mystérieux, alors que les deux hommes doivent se retrouver en Alaska, vendredi 15 août, pour négocier le sort de l’Ukraine dans le dos de la victime de l’agression militaire russe, selon la crainte des Européens.
Le goût de Donald Trump pour les dirigeants à poigne, tendance autoritaire, est connu, ainsi que son rejet du prosélytisme démocratique et libéral. Dans le cas de Vladimir Poutine, leur relation est à la fois ancienne et distancielle, dépourvue de l’alchimie humaine qui réunissait Ronald Reagan et Mikhaïl Gorbatchev à la fin des années 1980. Opaque aussi. On ne connaît même pas le nombre d’entretiens téléphoniques entre les deux hommes depuis l’élection américaine de novembre 2024.
En 2013, Donald Trump est une vedette de télévision et un milliardaire jouant de son image de playboy à succès. Il se rend à Moscou dans le cadre du concours Miss Univers, dont il détient les droits avec la chaîne NBC. Il rêve alors de rencontrer Vladimir Poutine, de le voir apparaître lors de l’émission. Depuis longtemps, il cultive un projet immobilier de grande envergure : l’édification d’une Trump Tower dans la capitale russe. Ce projet l’animait déjà lors de sa première visite en Union soviétique, en 1987.
En 1986, le jeune magnat participait à un dîner mondain à New York, assis aux côtés de l’ambassadeur soviétique aux Etats-Unis, Youri Doubinine. « Une chose conduisant à une autre, me voilà en train de parler de la construction d’un grand hôtel de luxe en face du Kremlin en partenariat avec le gouvernement soviétique », expliqua plus tard Donald Trump dans son livre référence, The Art of the Deal (« L’art de la négociation », Random House, 1987).
Deux mois après sa visite en URSS, en septembre 1987, l’entrepreneur de 41 ans achète une pleine page dans plusieurs journaux, dont le New York Times, pour exposer sa vision d’une Amérique abusée, qu’on retrouve au cœur de sa politique actuelle. « Le monde se moque des politiciens américains alors qu’on protège des navires qu’on ne possède pas, transportant un pétrole dont nous n’avons pas besoin, destiné à des alliés qui ne veulent pas aider », écrit-il.
« Deviendra-t-il mon meilleur ami ? »
Selon un ancien cadre de l’appareil sécuritaire du Kazakhstan, Alnur Moussaïev, qui travaillait à l’époque dans les services soviétiques, le KGB aurait alors recruté Donald Trump sous le pseudonyme de Krasnov. Aucune preuve matérielle n’étaye cette accusation. Simple contact parmi tant d’autres, informateur à son insu ? Ou pure invention diffamatoire, des décennies plus tard ? Impossible à dire. Le sujet est un puits à fantasmes, d’autant que les vulnérabilités de Trump sont établies : les femmes, l’argent, la vanité.
En revanche, deux choses sont claires. Dans les années 2000, des fonds privés russes massifs ont irrigué les affaires et les propriétés de Donald Trump, comme le reconnaissait l’un de ses fils, Don Jr, en 2008. En outre, la relation de fascination déséquilibrée avec Vladimir Poutine est documentée par les propos du magnat. La première fois que Donald Trump le complimente publiquement remonte à 2007 sur CNN. Il estime que le président russe « fait de l’excellent boulot pour reconstruire l’image de la Russie ». Puis, en 2013, à l’approche du concours de beauté en maillot de bain, qu’il pilote et incarne, Donald Trump est enthousiaste. « Est-ce que vous pensez que Poutine se rendra au concours de Miss Univers à Moscou en novembre, et si oui, deviendra-t-il mon meilleur ami ? », s’interroge-t-il sur Twitter. A la suite de ce séjour en Russie, Donald Trump ne va cesser de louer l’accueil qui lui a été réservé.
En 2014, la mobilisation populaire sur la place de l’Indépendance, à Kiev, oblige le président ukrainien Viktor Ianoukovitch à fuir. La Russie, furieuse, va saisir la Crimée, puis déstabiliser l’est de l’Ukraine. Donald Trump exprime une forme d’admiration envers Vladimir Poutine. En juin 2014, il approuve la vision du président russe. L’exceptionnalisme américain serait une expression « très dangereuse ». Il est aujourd’hui glaçant de constater, en ce début de second mandat, que Donald Trump détricote tous les outils de ce soft power américain – l’agence Usaid ou les médias Radio Free Europe et Voice of America – qui ont eu une importance cruciale dans l’espace soviétique.
En juillet 2015, quinze mois avant l’élection présidentielle qui provoquera un premier coup de tonnerre dans la vie politique américaine, Donald Trump se trouve à Las Vegas, dans le Nevada. Interrogé sur les sanctions frappant la Russie, après l’annexion de la Crimée, le magnat de l’immobilier répète qu’il saurait se faire respecter de Vladimir Poutine, contrairement à Barack Obama. « Je pense qu’on s’entendrait très, très bien. » La personne qui l’interroge, dans l’assistance, est Maria Butina, une ressortissante russe qui sera inculpée pour espionnage trois ans plus tard. En septembre, il explique qu’« en termes de leadership » Vladimir Poutine mérite un « A ». Face à ces compliments, difficile de rester de marbre. En décembre de la même année, au cours de l’une de ses interminables conférences de presse, le président russe qualifie le candidat de « très brillant » et « talentueux ».
Ingérences confirmées
Pendant toute la campagne présidentielle, Donald Trump se rengorge de cette marque d’estime venue de Moscou. Il se dit certain de pouvoir nouer une relation fructueuse avec le dirigeant russe, tout en niant avoir des intérêts financiers dans ce pays.
A l’approche du scrutin, le ministère de la justice et la police fédérale (FBI) enquêtent sur les ingérences russes dans la campagne. La question d’une conspiration impliquant Donald Trump et son entourage proche continue à ce jour à être débattue. L’enquête du procureur spécial, Robert Mueller, publiée en 2019, n’est pas parvenue à y répondre de façon concluante malgré les ingérences confirmées, les obstructions de Donald Trump, les contacts entre son équipe et des officiels russes. Dans son propre rapport, publié en 2020, la commission du renseignement du Sénat a estimé que Vladimir Poutine « a décidé l’effort russe de piratage des réseaux et des comptes informatiques affiliés au Parti démocrate et de faire fuiter les informations dommageables à Hillary Clinton et à sa campagne présidentielle ». Objectif : faciliter la victoire de Donald Trump.
Le premier mandat du magnat a eu lieu à l’ombre de ces soupçons. En mai 2017, au lendemain du renvoi du directeur du FBI, James Comey, Donald Trump reçoit dans le bureau Ovale deux officiels russes : le ministre des affaires étrangères, Sergueï Lavrov, et l’ambassadeur à Washington, Sergueï Kisliak. Avec une légèreté inouïe, le président américain leur dévoile des éléments opérationnels classifiés sur la menace terroriste en Syrie. Les journalistes russes, accompagnant leur ministre, ont documenté la rencontre. Leurs collègues américains, eux, n’étaient pas autorisés à entrer dans la pièce.
La première rencontre entre Donald Trump et Vladimir Poutine se tient à Hambourg (Allemagne), en marge du sommet du G20, en juillet 2017. Elle se passe de façon plutôt sobre, en comparaison avec le sommet de Helsinki, un an plus tard. Prenant le parti de Moscou contre les propres services de son pays, Donald Trump ne voit alors « aucune raison de croire » que la Russie serait responsable d’ingérences électorales. Le président américain tentera de corriger par la suite ses propos désastreux.
Sur le plan des relations bilatérales, l’administration Trump a en réalité adopté des positions très tièdes vis-à-vis de Moscou, renforçant à plusieurs reprises les sanctions contre des individus et des entités. Elle était poussée en ce sens, de façon bipartisane, par le Congrès, à une époque où le Parti républicain conservait une hostilité traditionnelle envers la Russie. Ces sanctions étaient liées aux ingérences électorales, mais aussi à la tentative d’assassinat contre l’ex-agent Sergueï Skripal au Royaume-Uni (2018) et à la construction du gazoduc Nord Stream 2. La Maison Blanche approuve aussi la livraison de missiles antichars Javelin à l’Ukraine, un fait que Donald Trump n’a pas manqué de rappeler depuis janvier, lorsqu’il est accusé de relayer les intérêts de la Russie.
Au lendemain de l’invasion russe en Ukraine, en février 2022, le magnat salue, à la radio, l’audace de la manœuvre : « C’est du génie. » Dans cet entretien, l’ex-président estime que Vladimir Poutine « aime son pays ». Pendant cette période suivant son départ de la Maison Blanche, le milliardaire traverse une forme de désert politique. Pourtant, selon le célèbre journaliste Bob Woodward, Donald Trump et Vladimir Poutine auraient eu au moins sept conversations privées. L’enquêteur a aussi révélé qu’en 2020, en pleine crise du Covid-19, le président américain avait accepté de transférer à son homologue des appareils de dépistage du virus, alors rares.
Les accusations de collusion retournées contre les démocrates
Dès juillet 2023, Donald Trump veut conditionner l’aide américaine à l’Ukraine. Il souhaite que le Congrès retienne toute nouvelle enveloppe tant que l’administration démocrate ne coopère pas avec les enquêtes sur les « affaires de corruption de la famille criminelle Biden ». Dans le monde MAGA (« Make America Great Again »), l’hostilité à l’Ukraine et la fascination pour la figure de Vladimir Poutine, dirigeant autoritaire incarnant des valeurs masculinistes, ne cessent de grandir. Donald Trump, lui, construit son retour au sommet sur l’idée d’un complot fomenté par l’« Etat profond », qu’illustreraient ses inculpations dans quatre dossiers distincts.
Une conspiration qu’il fait remonter à l’arnaque « Russia Russia Russia », selon son expression fétiche, soit les soupçons de collusion avec Moscou pendant sa première campagne. Avec son aplomb bien connu et son souci de la répétition, Donald Trump parvint à imposer un récit alternatif, à faire oublier les faits. Mais les médias américains et les démocrates ont aussi contribué à nourrir cette idée de conspiration, en prétendant longtemps que l’affaire de l’ordinateur portable au contenu sulfureux de Hunter Biden, le fils de l’ex-président, était une nouvelle tentative de manipulation russe. Une cinquantaine d’anciens responsables des services américains signèrent à l’époque une lettre en ce sens, tout en reconnaissant ne pas disposer de preuves.
Aujourd’hui, Donald Trump retourne les anciennes accusations de collusion avec les Russes contre les démocrates, en menaçant Barack Obama et Hillary Clinton, entre autres, de poursuites. Sur le plan diplomatique, ces derniers mois, il prétendait être irrité contre Vladimir Poutine, devant l’intransigeance du président russe à négocier une paix. « Vladimir, ARRETE ! », semblait implorer Donald Trump sur son réseau Truth Social, le 24 avril, après un nouveau bombardement meurtrier de l’armée russe sur Kiev. Sans conséquence.
Ce semblant d’irritation a été accompagné de doutes publics sur l’efficacité de nouvelles sanctions contre Moscou, comme si le milliardaire ne croyait pas à ses propres menaces. Vladimir Poutine, lui, excelle dans les fausses pistes. Il mise sur un abandon de l’Ukraine par Washington, pense que Kiev n’a pas les réserves pour maintenir son effort militaire. « Poutine est intrigué par Trump car il le voit comme un ticket pour sortir du grand froid diplomatique, pour s’asseoir à nouveau à la table des puissants et faire tomber les sanctions contre la Russie », souligne Charles Kupchan, expert au cercle de réflexion Council on Foreign Relations. On ne sait si Donald Trump a investi un jour en Russie. On ne sait pas non plus si l’inverse est vrai. Mais Moscou peut se réjouir d’avoir un tel interlocuteur à Washington.
Source :
Diffusion partielle ou totale interdite sans la mention : Source www.kassataya.com