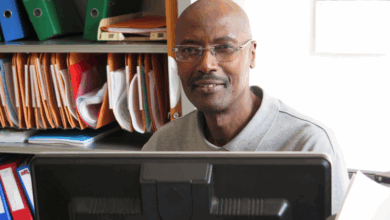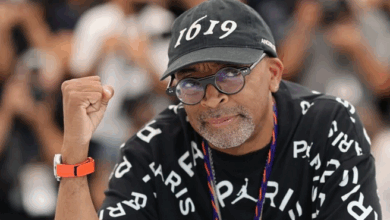Le Quotidien – Nous sommes nombreuses et nombreux à être cette personne : sœur, frère, ami·e, partenaire d’amour, cousin·e que l’on appelle quand il y a un souci. Pas pour discuter, pas pour rire, pas pour se retrouver, mais pour «gérer». Porter les peines, résoudre les urgences, répondre aux sollicitations. C’est ainsi que, peu à peu, nos relations s’étiolent, rongées par la charge affective unilatérale. Derrière chaque sourire fatigué se cache cette lassitude d’être toujours disponible, sans qu’on se demande, une seule fois : et toi, comment vas-tu ?
Dans une époque marquée par une intensification des logiques de rentabilité, de compétitivité et d’individualisme, où les inégalités se creusent et où la performance prime sur l’humanité, nos relations elles-mêmes semblent contaminées. Ce climat rend presque impossible la gratuité des relations : on se protège, on anticipe, on soupèse. L’élan sincère devient rare, suspect même. Les mots simples comme «je pense à toi» ou «je voulais juste entendre ta voix» se font timides, étouffés par les préoccupations du quotidien, par la peur de décevoir ou de ne pas pouvoir répondre à une attente implicite.
Que deviennent alors nos relations d’amitié, nos complicités fraternelles, nos liens familiaux ? Que reste-t-il de ces liens quand la sollicitation remplace la conversation, quand l’intérêt supplante la tendresse ? Il y a tellement d’appels que l’on ignore, de vocaux que l’on n’écoute pas. Non pas par indifférence, mais par fatigue ou par peur de ne pas être en mesure de répondre à la demande qui s’y cache. Car bien souvent, ces coups de fil ne sont plus de simples gestes d’attention, mais des appels à l’aide, des demandes pressantes. Et c’est douloureux, car si ce n’était pas cette attente sous-jacente, on aurait décroché sans hésiter. Parce qu’au fond, même si nous n’avons pas les mêmes problèmes, nous avons toutes et tous besoin d’aide, d’écoute, de présence, à un moment ou un autre. Et cela devrait suffire pour garder les liens vivants. Juste pour entendre la voix d’un proche, pour échanger quelques mots simples, pour se reconnecter. Mais ces voix, on ne les entend presque plus que dans l’urgence. La surprise d’un appel sans demande devient rare, presque émouvante.
Aujourd’hui, la peur de ne pas pouvoir aider prend le pas sur la joie de se parler. Et ça fait mal, parce que cela transforme la chaleur d’un lien en fardeau redouté. Mais plus personne ne prend le temps de se dire bonjour, de se regarder vraiment, d’être présent pour écouter sans attente. Nous ne sommes plus dans des échanges sincères, où l’écoute et le réconfort se partagent librement. Les conversations sont devenues transactionnelles, les silences pesants, et la disponibilité émotionnelle, un luxe rare.
Et parfois, une question s’impose à voix basse, presque honteusement : atteindra-t-on un jour le point où il faudra louer des ami·es, comme cela existe déjà dans certains pays occidentaux ? Des applications où l’on paie pour partager un moment, pour être écouté·e, pour simuler un lien. Cette idée paraît folle, absurde, irréelle. Et pourtant, elle est déjà là, tapie sous la surface, nourrie par l’érosion lente de nos solidarités naturelles.
Cela éclaire en partie l’emprise grandissante des réseaux sociaux sur nos vies. Pourquoi passons-nous tant de temps sur ces plateformes ? Parce qu’elles offrent, en apparence, ce que la société réelle ne nous garantit plus : un espace d’écoute sans jugement, une disponibilité constante, une attention simulée mais accessible.
Ce besoin de refuge numérique s’explique aussi par la perte de confiance généralisée. A force de voir des histoires intimes jetées en pâture pour quelques likes ou quelques billets, on apprend à se taire. On se méfie, même de ses proches. On filtre ses mots, on étouffe ses douleurs. Car aujourd’hui, une confidence peut être trahie, vendue, transformée en contenu viral. La parole devient un risque, l’aveu une menace. Et l’oreille bienveillante, humaine, se fait rare, remplacée par des algorithmes qui exploitent ce besoin d’écoute comme une marchandise.
C’est dans ce vide, ce manque d’humanité ressenti, que naît la nostalgie d’un temps où les liens étaient plus légers, plus disponibles, plus présents, et l’envie urgente de les retrouver, autrement.
Je pense à ces moments dans mon village d’origine, où les femmes d’un côté, et les hommes de l’autre, se retrouvaient dans des cercles non mixtes, chacun selon sa génération ou son rôle social. Les femmes se réunissaient souvent dans la véranda ou sous l’arbre d’une maison généreuse, la plus grande du quartier «Keur gou Mak». En général, entre 14h et 19h, quand elles avaient toutes fini de préparer le repas, que les enfants faisaient la sieste et que les maris étaient au travail ou hors de la maison, c’était leur moment à elles pour recharger les batteries. Un moment suspendu, dédié à la parole, à l’écoute et au partage. Certaines faisaient du henné, d’autres préparaient le thé, pendant que quelques-unes lançaient les cauris ou s’adonnaient au tatouage des gencives. Autour du thé, d’arachides à décortiquer, d’histoires à raconter ou de silences respectés, se tissait une ambiance faite de bienveillance, de présence sincère et de chaleur humaine. Il n’y avait ni téléphones, ni notifications, juste des rires qui fusaient, des confidences qui coulaient et parfois des larmes, accueillies sans jugement. C’était un autre rythme, un autre monde, où l’attention ne se fragmentait pas, où l’on était là, tout entière, pour l’autre.
Dans ces grands groupes de femmes, on autorisait celles qui avaient plus d’affinités à se choisir, à former un duo complice, solidaire, indéfectible : on appelait cela «Ndeye dikké» ou «yama nex». Elles devenaient des alliées, des amies intimes, des soutiens émotionnels et affectifs. C’était une décision volontaire, presque sacrée, d’être là l’une pour l’autre : se soutenir dans les épreuves, partager les joies, s’offrir des cadeaux, rire, pleurer, parler sans détour. Une relation fondée sur l’engagement mutuel, la tendresse sans intérêt, la réciprocité sincère. Dans un tel environnement, tissé de confiance et de présence, il était presque impossible de se sentir seule.
Avec le temps, ces groupements de femmes se sont réinventés en devenant ce qu’on appelle aujourd’hui les tontines ou les «mbotaay». Des formes de regroupement où l’on garde encore l’aspect non mixte et solidaire, mais où désormais l’argent occupe une place centrale. Pour en faire partie, il ne suffit plus d’habiter la même localité ou d’être une femme : il faut pouvoir cotiser. Cette exigence d’argent exclut celles qui n’en ont pas les moyens et engendre souvent des plaintes, voire des conflits, notamment en cas de défaut de gestion. La cotisation rend aussi la présence physique optionnelle : il suffit d’envoyer sa contribution pour éviter une amende. Ainsi, on s’éloigne peu à peu de l’essence de ces cercles, pensés à l’origine comme des espaces de soutien affectif et de présence. Transposées aujourd’hui sur WhatsApp, certaines de ces tontines sont devenues une source de tensions, de suspicions, parfois même de ruptures. Ce n’est plus tant la solidarité qui prime, mais l’obligation financière. Et dans cette transformation, on perd un peu de ce qui faisait la beauté des liens d’antan.
Et cette perte, nous la ressentons tellement qu’elle a donné naissance à une nouvelle vague de nostalgie. C’est ce manque, ce vide, qui a ressurgi à travers le challenge sur TikTok autour des «années 60», où, dans plusieurs localités du pays, les femmes se réunissent à nouveau sous forme de cérémonies appelées «Tour», pour chanter, danser et revivre l’ambiance d’autrefois. Elles se parent comme on s’habillait entre les années 60 et 90, elles rient, elles chantent, elles dansent… et ce succès-là, c’est celui du souvenir d’une époque où, malgré les difficultés, la vie semblait moins rude, les liens plus solides, la société moins féroce. Car aujourd’hui, les promesses politiques ne tiennent plus, la vie au Sénégal devient de plus en plus inaccessible. Les violences s’intensifient dans les foyers, dans les rues, sur les réseaux. Un climat social morose et un avenir incertain. Cette pression constante, cette fragilité de tous les repères, nourrissent le sentiment d’abandon et d’insécurité émotionnelle que nous ressentons collectivement. Nos relations sont souvent pleines de trahisons et d’attentes intéressées. Cette nostalgie n’est donc pas anodine : elle témoigne d’un besoin profond de retrouver ce qui rendait la vie supportable malgré tout. De retrouver un peu de ce nous, de ce collectif, de cette chaleur humaine perdue dans la froideur d’un monde toujours plus individualiste.
Mais aujourd’hui, quelque chose s’est fissuré. Les liens se sont appauvris. La sollicitation a pris le pas sur la complicité. Nous vivons dans une société marquée par des inégalités croissantes, où la dureté des conditions de vie pousse chacun·e à survivre plutôt qu’à vivre ensemble. Les relations, autrefois fondées sur la tendresse et la disponibilité, sont désormais filtrées par des logiques d’intérêt. Ce n’est plus la personne qu’on voit, mais ce qu’elle peut nous apporter : un contact, un appui, une solution. Dans ce climat rude, la bienveillance est perçue comme une faiblesse, et l’empathie comme un luxe que l’on ne peut plus s’offrir. Celles et ceux qui semblent s’en sortir deviennent des guichets émotionnels et financiers, sommés de répondre, d’écouter, de donner. Mais qui les soutient, elles et eux ?
Et pourtant, l’humain reste un être profondément social. Même s’il tente de s’en défendre, il ne peut pas s’épanouir dans la solitude ou la méfiance.
Biologiquement, psychologiquement, culturellement, nous sommes faits pour les liens. Pour se sentir vivant·e, pour traverser les épreuves, pour se construire, nous avons besoin des autres. C’est dans la solidarité réelle que notre équilibre se tisse. Croire que l’on peut tout gérer seul·e est une illusion douloureuse. Une société qui pousse ses membres à la méfiance permanente, à la solitude volontaire, à l’armure affective, s’éloigne de ce qu’il y a de plus humain en nous : la capacité à nous reconnaître mutuellement, à prendre soin les un·es des autres, au-delà de l’intérêt immédiat.
Par Fatou Warkha SAMBE
Source : Le Quotidien (Sénégal)
Les opinions exprimées dans cette rubrique n’engagent que leurs auteurs. Elles ne reflètent en aucune manière la position de www.kassataya.com
Diffusion partielle ou totale interdite sans la mention : Source www.kassataya.com