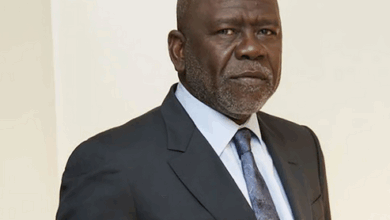Slate – Depuis deux décennies, l’expression «du coup» connaît une explosion d’usage documentée par les linguistes. Lotfi Abouda est l’un d’entre eux. En 2022, il a publié une étude basée sur l’exploration d’un corpus oral d’environ 1,3 million de mots. Il constate une transformation quantitative spectaculaire. Alors que seulement cinq occurrences du connecteur «du coup» apparaissent entre 1968 et 1971, on en dénombre 141 dans les données collectées depuis 2010.
Cette spécificité hexagonale est si marquée que d’autres communautés francophones l’utilisent comme détecteur d’origine géographique: au Québec, elle permet d’identifier immédiatement un locuteur français (tout comme l’expression «une fois» trahit instantanément un Belge). Par ailleurs, dans un corpus de 120 heures d’enregistrements analysés, sur 614 occurrences identifiées, 67% sont produites par des locuteurs appartenant à la tranche d’âge des 15-25 ans. Le phénomène semble donc générationnel.
Mécanismes et fonctions du tic langagier
En linguistique, le terme «tic de langage» est considéré comme péjoratif par les spécialistes qui préfèrent parler de «marqueurs de discours». Julie Neveux, maîtresse de conférences à la Sorbonne, explique que ces expressions fonctionnent comme des «mots béquilles» qui «remplissent un vide» et sur lesquels «on s’appuie quand on cherche quelque chose à dire». L’expression «du coup» connaît un processus de «pragmaticalisation»: d’expression consécutive, elle devient un marqueur métadiscursif, servant à relier des segments de discours de façon plus ou moins motivée. Dans 82% des cas, elle apparaît en position frontale dans l’énoncé, agissant davantage comme amorce de parole que comme véritable lien logique.
Le linguiste russo-tchéco-américain Roman Jakobson a théorisé cette fonction sous le terme de «fonction phatique». Ces mots ne servent pas à communiquer un message informatif, mais à maintenir le contact entre locuteur et destinataire, comme le «allô» au téléphone. «Du coup» remplit cette fonction de maintien du lien conversationnel, permettant de structurer la pensée, d’attirer l’attention et de meubler les silences potentiellement embarrassants.
Utiliser les marqueurs de son époque
Le sociologue américano-canadien Erving Goffman a développé une analyse des interactions comme «cérémonies en miniature». Dans son concept de face-work (travail de figuration), il montre comment nos relations intersubjectives constituent un processus d’élaboration conjoint de la face, cette «valeur sociale positive qu’une personne revendique effectivement».
La génération qui emploie massivement «du coup» souligne inconsciemment son inscription dans l’époque contemporaine.
L’expression «du coup» s’inscrit dans ce qu’Erving Goffman appelle «l’idiome rituel»: ce vocabulaire du comportement qui transmet une image de soi conforme aux attentes sociales. En utilisant les marqueurs de son époque, le locuteur signale son appartenance au groupe social et évite les «fausses notes» qui pourraient compromettre l’interaction. «Du coup» permet de sauver la face, d’éviter le silence, de montrer qu’on maîtrise les codes implicites du dialogue. Il est un marqueur de coprésence, de continuité de l’échange.
Les «tics de langage» fonctionnent d’ailleurs souvent comme des marqueurs d’appartenance à un groupe sociologique ou générationnel. La génération qui emploie massivement «du coup» souligne inconsciemment son inscription dans l’époque contemporaine.
Diffusion partielle ou totale interdite sans la mention : Source www.kassataya.com