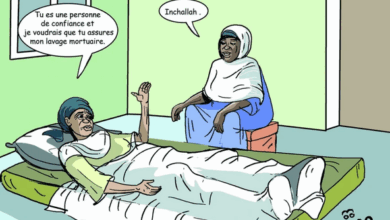M Campus – Récit – Née en 1925 du mouvement pacifiste de l’entre-deux-guerres, la cité-jardin du sud de la capitale a accueilli depuis 450 000 étudiants ou chercheurs, parfois illustres. D’anciens résidents ayant vécu de près ou de loin des soubresauts de l’histoire livrent au « Monde » leurs souvenirs.
A l’automne 1955, un étudiant encore anonyme franchit le porche à colonnes ioniques du parc ouest de la Cité universitaire, dans le 14e arrondissement de Paris. Très vite, le jeune Konstantinos Gavras demande son transfert du pavillon hellénique à la Maison des provinces de France pour apprivoiser la langue de son pays d’accueil. « Ma première grande surprise fut de trouver dans le salon tous les journaux, de droite et de gauche. Je venais d’un pays où c’était absolument impossible de voir ça », se souvient Costa-Gavras. Le réalisateur étudiait alors sur les bancs de la Sorbonne avant d’entrer à l’Institut des hautes études cinématographiques (actuelle Fémis).
Plus qu’un choc culturel, le paria exclu du système universitaire grec en raison des positions antiroyalistes de son père reçoit un « coup de matraque sur la tête », allant de surprise en surprise. Un hiver, il attrape une bronchite carabinée, mais le jeune homme « sans le sou » n’ose pas consulter un docteur. On lui conseille de se rendre à l’hôpital de la Cité universitaire (disparu depuis). Il est hospitalisé sur-le-champ. « J’étais terrifié, je me disais que je ne pourrais jamais payer la facture et, à la sortie, on ne m’a rien demandé. C’était ma découverte de la France, un enchantement, se délecte encore l’homme de 92 ans. Je suis entré dans un monde totalement différent de celui que j’avais connu. On faisait partie d’une sorte d’aristocratie d’étudiants, c’était une vie, sans exagérer, “paradisiaque”. » Quand ses rendez-vous l’amènent dans le voisinage, la nostalgie affleure et il lui arrive d’y déambuler discrètement, « en pèlerinage ».
En un siècle, près de 450 000 étudiants et chercheurs – parfois illustres – sont passés entre les murs de la Cité internationale universitaire de Paris (CIUP), imaginée au lendemain de la première guerre mondiale. Le conflit terminé, il faut gagner la paix. Une poignée de politiques, de responsables publics et de philanthropes font un pari : bâtir une cité pouvant accueillir 2 000 ou 3 000 jeunes gens venus de tous les pays du monde, amenés « à se comprendre, à nourrir moins de préjugés les uns envers les autres, à élargir le cadre de leurs horizons et à s’entendre », selon les mots d’André Honnorat (1868-1950), ministre de l’instruction publique en 1920. L’idéal pacifiste se double d’un enjeu social, à l’heure où la crise du logement étudiant sévit déjà.


Dès 1925, des pavillons à bow-windows et fenêtres à meneaux sortent de terre entre les portes d’Orléans et de Gentilly, le long du chemin de fer desservant le Quartier latin. Le beffroi veille fidèlement sur ce premier ensemble en briques claires portant le nom de ses deux mécènes, Emile et Louise Deutsch de la Meurthe… rebaptisé depuis par des esprits moldus « maison Harry Potter ».
Dans son sillage, des nations du monde entier inaugurent leur pavillon au sein de ce petit paradis de verdure réservé alors à une élite d’étudiants destinés à devenir les dirigeants de demain : Canada, Belgique et Luxembourg, Japon, Suisse, Suède, Argentine, Cuba, Danemark, Pays-Bas, Espagne, Etats-Unis d’Amérique…
Laïcité, mixité et brassage
A l’heure de célébrer son centenaire, 47 maisons composent ce « village » où séjournent chaque année 12 000 étudiants à partir du niveau master, chercheurs ou artistes – dont plus des deux tiers internationaux, issus de 150 nationalités. Toutes doivent se plier aux principes édictés par la fondation nationale, responsable de la gestion du site, en premier lieu la laïcité, la mixité et le brassage, qui veut qu’une maison de pays accueille au moins 30 % de résidents d’une autre nationalité. La politique y est exclue.
Ce qui n’a pas empêché la Cité de servir de caisse de résonance aux soubresauts de l’histoire, dans le contexte notamment des décolonisations, des indépendances ou de la guerre froide. « Les maisons deviennent des lieux de tribunes, de revendications voire parfois de contestations des régimes politiques, qui se cristallisent dans les années 1960 jusqu’au début des années 1970 », résume Guillaume Tronchet, chercheur associé à l’Institut d’histoire moderne et contemporaine, coauteur du Campus-monde. La Cité internationale universitaire de Paris de 1945 aux années 2000 (Presses universitaires de Rennes, 2022).
Le 21 avril 1967, Yannis Polizos loge depuis un an et demi à la Fondation hellénique quand survient le coup d’Etat des colonels à Athènes, sa ville natale. « On a reçu la nouvelle comme un coup de tonnerre, à l’époque tout le monde évoquait la possibilité d’une dictature, mais personne n’y croyait », se remémore cet homme sémillant de 79 ans. Tous les soirs à la Cité, lui et ses compatriotes s’enfièvrent lors de « discussions à l’infini » : pourront-ils rentrer en Grèce à l’été ? La dictature va-t-elle chuter ?
Douze mois plus tard, cet embryon de politisation va prendre brutalement forme, à l’occasion des événements de Mai 68. La Maison internationale, navire amiral de la Cité inspiré du château de Fontainebleau, devient le centre névralgique des débats et des revendications de ses résidents : liberté de visite réciproque entre filles et garçons, participation aux instances de gestion, etc. A l’Ecole spéciale d’architecture, non loin de là, boulevard Raspail, Yannis Polizos est mis à contribution pour fabriquer des sérigraphies caricaturant le général de Gaulle « avec son képi et son grand nez », destinées à tapisser les murs de Paris.
Source : M Campus – (Le 29 juin 2025)
Diffusion partielle ou totale interdite sans la mention : Source www.kassataya.com