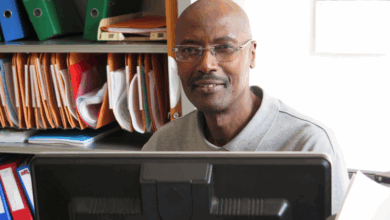L’agression physique qui a opposé deux diplomates mauritaniens en poste à Tokyo ne relève pas simplement du registre de l’indiscipline administrative ou de la faute individuelle. Elle signe, plus profondément, une crise du sens diplomatique, une déliquescence des fondements mêmes de ce que doit incarner une représentation d’État à l’étranger : la civilité, la maîtrise de soi, le service du bien public, et la sublimation des différends dans la forme.
Qu’un diplomate — c’est-à-dire un agent assermenté, investi d’une mission de représentation de la République — en vienne à fracturer le visage de son collègue au sein même d’une chancellerie, n’est pas une simple altercation. C’est une blessure symbolique portée à l’image de la Mauritanie, dans ce qu’elle a de plus essentiel : sa capacité à parler au monde avec autorité, dignité et sérénité.
Mais plus que le choc de l’agression, ce sont les antécédents ignorés, et les précédents mal gérés qui interrogent.
La diplomatie, dans son essence, est un exercice de contention. Elle suppose de contenir l’ego, de refouler la pulsion, de préférer le mot juste à la colère brutale. Quand cette discipline s’effondre, ce n’est pas simplement une scène de violence qui se produit, c’est la diplomatie elle-même qui abdique sa prétention à incarner la rationalité étatique.
Il ne s’agit donc pas seulement de sanctionner l’agresseur. Car la vérité, ici, est plus complexe : la victime elle-même, selon des publications archivées, aurait proféré dans un passé récent des menaces publiques à l’encontre d’un autre collègue en poste à Washington. En des termes tout aussi agressifs. Rien n’a été fait. Pas même un rappel administratif. Ce laxisme, cette impunité larvée, a nourri une culture du conflit toléré, au sein de laquelle la frontière entre le désaccord professionnel et la vendetta privée s’est dangereusement estompée.
Ce qui s’est passé à Tokyo n’est pas une anomalie. Il s’inscrit dans une lignée d’épisodes non réglés, comme celui du consulat général à Las Palmas, où l’agresseur avait été sanctionné tandis que la victime, elle, fut transférée à Khartoum — comme si elle portait en elle, par sa simple présence, la gêne d’une faute qu’elle n’avait pas commise.
Cette asymétrie dans les réponses, cette gestion subjective et opaque des crises diplomatiques, finit par éroder ce qui fait la légitimité de toute autorité : la transparence, la cohérence, et l’exemplarité. Une institution qui sanctionne selon l’intensité du scandale public ou l’identité des protagonistes perd le monopole du sens.
Ce moment de disgrâce devrait être saisi comme un tournant fondateur : celui de la refondation des normes de comportement au sein du service diplomatique. Il faut d’urgence une enquête neutre, indépendante, administrative et éthique, qui ne se contente pas de désigner un coupable visible, mais analyse les racines profondes de la défaillance collective. Qui a promu, protégé, ou laissé s’envenimer une situation connue de longue date ? Quels sont les mécanismes d’alerte ou de médiation disponibles dans les ambassades ? Qui rend des comptes lorsqu’un agent dérape en toute impunité ?
Il s’agit là de réhabiliter la diplomatie dans sa dimension morale. Car elle n’est pas seulement une technique d’influence, elle est d’abord une incarnation de l’État dans ses vertus essentielles : la réserve, la maîtrise, la mesure, et le respect de l’autre.
Le diplomate n’est pas un simple fonctionnaire. Il est, où qu’il soit, le visage de la République dans sa version la plus noble. Il porte en lui la décence collective d’un peuple, la hauteur de son histoire, la finesse de sa voix dans les cercles du monde.
Qu’un tel représentant bascule dans la brutalité, c’est non seulement l’échec d’un homme, mais l’échec d’un système. Ce système doit être réformé, non par des discours, mais par des actes. Et cela commence ici : par la vérité, toute la vérité — sur les responsabilités partagées, les failles tolérées, et les silences complices.
Car ce n’est qu’en exigeant le meilleur de ses diplomates que l’État peut prétendre au respect de ses partenaires. Et ce respect-là, au Japon comme ailleurs, ne se conquiert ni par la force, ni par la peur, mais par la tenue.
Mohamed Ould Echriv Echriv
Les opinions exprimées dans cette rubrique n’engagent que leurs auteurs. Elles ne reflètent en aucune manière la position de www.kassataya.com
Diffusion partielle ou totale interdite sans la mention : Source www.kassataya.com