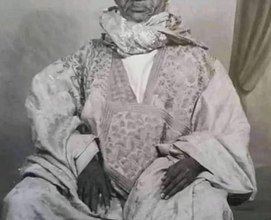The Conversation – Le 8 mai 1945, le jour même où la France célèbre la victoire sur la barbarie nazie, elle perpètre en Algérie des massacres sanglants. À Sétif, le drapeau algérien brandi par un jeune scout musulman déclenche une répression d’une violence inouïe qui s’étend à Guelma, à l’est, et à Kherrata, à l’ouest, jusque fin juin. Bilan : de 10 000 à 30 000 Algériens massacrés, et 102 « Européens » tués. Si la guerre d’indépendance n’éclate qu’en 1954, c’est surtout parce qu’en 1945 l’armée française a étouffé les revendications nationalistes.
Au moment de la commémoration du 80e anniversaire de ces tueries de masse, Paul Max Morin, politiste et spécialiste des études mémorielles (Université de Stirling, Royaume-Uni) revient sur cet épisode sanglant de l’histoire coloniale française.
En Europe, le 8 mai 1945 évoque la victoire contre le nazisme. Mais en Algérie cette date est avant tout celle d’un autre événement tragique. Pouvez-vous nous rappeler le contexte dans lequel ces violences ont éclaté ? Est-ce qu’il y avait des signaux avant-coureurs qui auraient pu annoncer les manifestations et leur répression sanglante ?
Paul Max Morin : Il est important de replacer le 8 mai 1945 en Algérie dans une histoire longue. Il y a dans la colonisation une habitude à la violence de masse pour d’abord conquérir le territoire, asseoir la domination et maintenir l’ordre. Il ne s’agit pas seulement des colonies françaises. Le XIXe siècle, c’est aussi l’époque où les populations natives américaines vont en partie disparaître, où il va y avoir des massacres en Afrique, notamment au Congo et en Afrique australe. La violence fait partie du monde colonial. Les massacres du 8 mai 1945 sont à inscrire dans cette histoire.
Dès la conquête française de l’Algérie en 1830, la violence et notamment dans sa dimension collective, massive est utiliser pour réprimer tout acte de résistance. Avec, par exemple, l’écrasement des mouvements de 1871. La colonisation correspond à une forme de brutalisation de la société, de la manière de gérer les populations, de maintenir l’ordre, ce qui va évidemment affecter les colonisés, mais aussi les colons et les métropoles qui se brutalisent. La métropole va déployer des méthodes de tueries et d’encadrement des populations qui vont fortement influencer le XXe siècle, et notamment le nazisme.
À Sétif, lorsque ces mobilisations nationalistes émergent, la répression est une mécanique bien rodée. Les massacres ne se déroulent pas sur un jour. Ils débutent à Sétif, s’étendent à Guelma et à Kherrata, et ce, durant plusieurs semaines, du 8 mai au 26 juin 1945. L’armée et la police s’associent à des civils, des milices d’Européens qui étaient déjà en place dans la colonie dans une logique d’autodéfense contre « les masses indigènes ». Cette mécanique où s’allient l’État et les Ultras, le public et le privé, la répression étatique et le lynchage est typiquement coloniale.
Le 8 mai 1945, partout en France, on célèbre la victoire sur le nazisme. À ce moment-là, l’Algérie est française et, rappelons-le, elle a fortement contribué à la libération de la France. À partir de 1942, la capitale de la France libre, c’est Alger. Aux côtés des Alliés, l’armée française se recompose en Algérie : il y a énormément de Français d’Algérie et d’Algériens, dont les tirailleurs algériens, qui vont être sur le front, qui vont libérer Marseille, qui vont aller jusqu’à Berlin.
Pour mobiliser les troupes coloniales, le général de Gaulle avait promis des réformes politiques pour donner de l’autonomie ou élever la condition politique et sociale des Français musulmans d’Algérie au même rang que les Français non musulmans (notamment en accordant la citoyenneté française à des dizaines de milliers de musulmans). Dans les mouvements indépendantistes algériens de l’époque, le slogan « À bas le nazisme, à bas le colonialisme ! » soulignait bien le parallèle entre les deux idéologies et les deux formes d’occupation.
Et concrètement, qu’est-ce qui s’est passé le 8 mai 1945 ?
P. M. M. : Alors que les populations civiles, soit près de 10 000 personnes, marchaient dans les rues de Sétif pour célébrer la capitalulation de l’Allemagne et la victoire sur le nazisme, Bouzid Saâl, un jeune scout musulman, a brandi un drapeau algérien. Or, ce drapeau était interdit, puisqu’il était associé à la demande d’indépendance structurée dans les années 1930 par Messali Hadj, un ouvrier algérien qui vivait à Paris, emprisonné depuis 1941 et transféré à Brazzaville (Congo) en 1945.
Au départ proche du Parti communiste français (PCF), Messali Hadj avait développé un mouvement indépendantiste, L’Étoile nord-africaine, qui deviendra plus tard le Parti populaire algérien (PPA) puis le Mouvement national algérien (MNA) après des dissolutions et une prise de distance avec les communistes. Son objectif : étendre les revendications nationalistes au-delà des cercles intellectuels et militants socialistes et communistes, et développer une conception populaire du mouvement national. Le MNA, c’est l’ADN du nationalisme algérien : il fallait un peuple, une langue, une religion et les diffuser aux masses algériennes et dans l’immigration en France.
Dans la colonie, le drapeau était interdit, urticant, car il renvoyait directement au fait que l’Algérie n’était pas aussi française qu’on voulait le croire.
Le jeune porteur du drapeau algérien est donc tué d’une balle dans la tête par un officier de police français, et une émeute éclate. Cent deux Européens, principalement des civils, sont assassinés par les manifestants. Et pour la France, c’est un crime impardonnable. Le colonisé ne peut pas tuer un colon, il ne peut pas s’attaquer à un Européen.
Propos recueillis par Yasmine Khiat.
Source : The Conversation
Diffusion partielle ou totale interdite sans la mention : Source www.kassataya.com