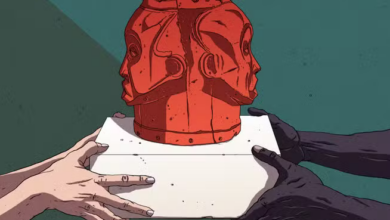Vanity Fair – Il y a sept ans, 16 actrices témoignaient dans l’essai coup de poing Noire n’est pas mon métier du racisme dont elles étaient victimes dans l’exercice de leur profession. Le début d’une prise de conscience ? Selon une enquête réalisée par Sarah Lécossais, maîtresse de conférences en sciences de l’info et de la com à l’Université Sorbonne Paris Nord, et Maxime Cervulle, professeur en sciences de l’information et de la communication à l’université Paris-VIII, les interprètes racisés continuent d’être confrontés à un grand nombre de discriminations, des auditions aux plateaux de tournage, et relégués au second plan. Derrière quelques success-stories, des violences toujours systémiques. Analyse.
Vanity Fair. Pourquoi cet intérêt pour la question des discriminations dans le cinéma français ?
Sarah Lécossais. En 2022, nous avions mené l’enquête Cinégalités avec Maxime Cervulle, en collaboration avec le collectif 50-50, sur le genre, l’origine ou encore la catégorie socioprofessionnelle des personnages de 115 films français. L’idée de cette nouvelle étude « La couleur des rôles » est de comprendre les mécanismes derrière les inégalités de représentation à l’écran et ce qui se joue dans les pratiques des professionnels. Cela nous a amenés à porter notre regard sur les méthodes de recrutement des comédiens, notamment ceux qui sont perçus comme non blancs. Que ressentent-ils d’être toujours confrontés à l’usage des catégories ethno-raciales ? Quels rôles leur propose-t-on et quels sont ceux qui leur sont proscrits ? Comment ces manières de composer une distribution impactent la faible diversité à l’écran, ainsi que sur les assignations narratives qu’on avait pu observer dans le cinéma français ?
Comment avez-vous constitué l’échantillon de l’enquête ?
Il s’agit vraiment d’une enquête dite qualitative. Nous avons rencontré 51 comédiens aux expériences professionnelles assez différentes. En tout, nous avons interviewé 100 personnes, car il y avait aussi des directeurs de casting ou des chargés de figuration. Donc c’était vraiment un panel très large. Dans le cas des acteurs, nous sommes passés par des listes professionnelles avec une annonce qui portait sur le thème « casting et diversité », puis nous avons procédé de proche en proche. Au final, la population d’enquête est paritaire, composée de gens qui ont entre 20 et 59 ans, avec des parcours très divers : certains viennent des grandes écoles et ont joué avec de grands metteurs en scène. D’autres débutent ou ont eu des carrières plus confidentielles.
Avez-vous senti de leur part une peur de s’exprimer et d’être blacklisté ?
Comme cette enquête a été menée sous l’égide du ministère de la Culture, elle a suscité beaucoup d’attentes et d’espoir de la part de ces comédiens qui n’ont pas hésité à nous répondre. La peur d’être blacklisté s’exprime plutôt dans le quotidien du métier. Ces interprètes subissent vraiment des formes de racisme ordinaire sur les plateaux. Les castings sont aussi souvent vécus comme dégradants, voire déshumanisants. Par exemple, quand on leur demande de fabriquer un accent. Pour un interprète, il est essentiel d’avoir une bonne réputation, mais aussi d’être d’un commerce agréable, parce qu’il va partir en tournage pour plusieurs semaines. Dans ce contexte, il est très difficile de dénoncer les violences racistes. La crainte d’être grillé dans le milieu va conduire au silence de ceux qui s’estiment victimes. D’autant qu’il leur manque des procédures spécifiques à activer pour faire respecter leurs droits.
Qu’est-ce qui vous a le plus interpellé dans ces témoignages ?
Beaucoup de ces comédiens racontent ne pas pouvoir incarner la France à l’écran. Ils se retrouvent à jouer des personnages de migrants ou ne s’exprimant pas bien français. Ils ont du mal à être recrutés pour jouer « monsieur et madame tout le monde ». Comme l’expliquait bien Eye Haïdara dans le livre Noire, n’est pas mon métier, il est compliqué d’être banal à l’écran, dans le sens d’être une personne comme les autres. Paradoxalement, quand ils passent des castings pour des productions étrangères tournées en France, là, ils sont recrutés parce qu’ils sont français.
Quelles sont les raisons invoquées par les directeurs de casting interviewés pour justifier ces pratiques ?
Les professionnels du casting doivent composer avec les demandes qu’on leur fait. Au cinéma et dans l’audiovisuel, la distribution va s’organiser autour de l’affiche, avec l’idée que, pour attirer le public et dans des logiques économiques, il faut des interprètes célèbres. Ces derniers figurent dans, ce qu’on appelle dans le milieu, « la liste A » qui réunirait des acteurs ayant suffisamment de notoriété pour aider au financement du film. Des acteurs bankables, en somme. Dans cette liste aux contours très flous, très peu de personnes perçues comme non blanches. Il y a une forme de division raciale du travail acteurial qui les empêche d’avoir des premiers rôles. Ils sont beaucoup plus représentés dans les rôles secondaires ou les rôles fonctions.