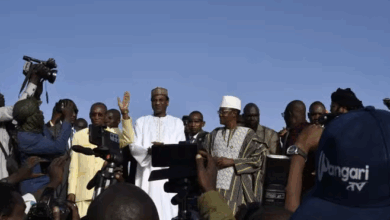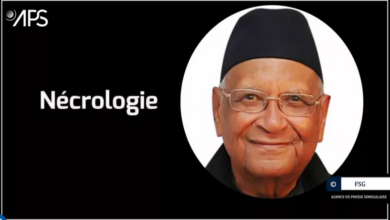– Le yoyo entre la France et l’Algérie n’en finit plus, au risque de l’étourdissement. L’accalmie succède à la tempête avant un nouvel orage, lequel se soldera par une énième éclaircie. Un dérèglement diplomatique à la mesure de la complexité croissante d’une relation franco-algérienne en proie à des forces contraires – centrifuges comme centripètes – démunies de tout cadre solide pour les canaliser. Une semaine à peine après l’embellie ouverte par la visite à Alger le 6 avril de Jean-Noël Barrot, apaisant une virulente crise longue de huit mois, voilà le tonnerre qui gronde à nouveau entre les deux capitales.
Alger a en effet décidé dimanche 13 avril d’expulser une douzaine d’agents de l’ambassade de France en représailles au placement en détention provisoire par un juge français la veille d’un agent du consulat algérien de Créteil (Val-de-Marne). Ce dernier figure parmi les trois personnes mises en examen dans le cadre de l’enquête sur l’enlèvement et la séquestration – durant vingt-sept heures – d’un influenceur opposant, Amir Boukhors, faits survenus les 29 et 30 avril 2024 entre le Val-de-Marne et la Seine-et-Marne. L’opération aurait été montée, selon M. Boukhors, dans le but de l’intimider et le dissuader de poursuivre ses révélations sur les turpitudes de certains clans du régime algérien.
Ainsi l’escalade de la tension entre les deux capitales est-elle désormais relancée par les suites judiciaires de cette ténébreuse affaire de séquestration. Paris a d’ores et déjà annoncé, par la voix de M. Barrot, « une réponse immédiate » aux expulsions des douze agents français – tous affiliés au ministère de l’intérieur – qui devraient devenir effectives dans la journée de mardi à l’expiration d’un délai de 48 heures. Elle devrait être de la même échelle : douze agents algériens en poste en France seront à leur tour expulsés.
Dans ces conditions, on voit mal comment la détente permise par la visite du 6 avril de M. Barrot à Alger pourrait se prolonger. Est-ce le retour à la case départ, celle de la crise déclenchée l’été 2024 par le geste d’Emannuel Macron reconnaissant la « souveraineté marocaine » sur le Sahara occidental ?
Oscillations permanentes
Ce revirement diplomatique promarocain de Paris avait ouvert une fracture entre les deux pays qu’avait ensuite aggravée une cascade d’incidents enflammant les passions : arrestation à la mi-novembre à Alger de l’écrivain franco-algérien Boualem Sansal pour ses propos sur la frontière entre l’Algérie et le Maroc ; refus du gouvernement algérien de récupérer certains de ses ressortissants expulsés du territoire français, etc. Un tel degré d’animosité avait rarement été atteint depuis l’indépendance de l’Algérie en 1962. Une « période de tension inédite », avait dû lui-même reconnaître M. Barrot lors de sa visite d’« apaisement » à Alger.
Pourquoi donc ces oscillations permanentes entre les deux capitales ? Pourquoi cette incapacité à stabiliser la relation, à inscrire les séquences de réchauffement dans la durée ? Un premier élément de réponse tient dans la nature multiforme de ce lien franco-algérien qui le rend comparable à nul autre. Fruit d’une imbrication entre mémoire coloniale, héritages migratoires, passerelles économiques, intérêts stratégiques et convulsions identitaires de chaque côté, la connexion entre la France et l’Algérie est par essence compliquée à réguler.
La difficulté n’est pas, en elle-même, insurmontable. Le véritable défi tient plutôt dans l’impossible alignement des différents canaux qui irriguent la relation bilatérale. Ou plus précisément dans l’absence de synchronie entre les différents agendas politiques, stratégiques et judiciaires. Quand la France est prête au dialogue, l’Algérie est absorbée par d’autres impératifs, et réciproquement. Et quand bien même les diplomates sont au diapason, les logiques partisanes de chaque pays poussent en sens contraire. Sans compter les incidents sécuritaires ou les vicissitudes judiciaires qui précipitent les embardées.
C’est un peu la malédiction du contretemps. Depuis le début de l’ère Macron, la simultanéité n’a jamais été au rendez-vous des bonnes volontés. Le président français nourrit-il son projet de réconciliation au lendemain de son élection de 2017 ? Il peine à trouver un interlocuteur à Alger alors qu’Abdelaziz Bouteflika, son homologue d’alors, est au crépuscule de son règne. En trouve-t-il un enfin avec l’élection fin 2019 d’Abdelmadjid Tebboune ?
Source :
Diffusion partielle ou totale interdite sans la mention : Source www.kassataya.com