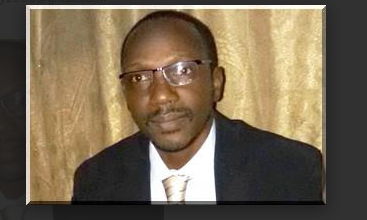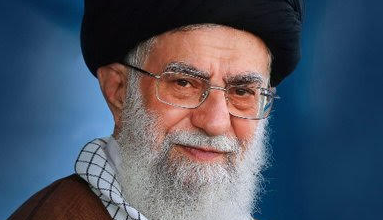Financial Afrik – En Mauritanie, la lutte contre l’esclavage s’est installée dans le débat public. Et c’est une bonne chose. Mais à y regarder de plus près, elle semble suivre une ligne étrangement sélective : on dénonce sans relâche les injustices liées à la communauté Bidhan (arabo-berbère), mais on reste silencieux — trop silencieux — sur les formes d’oppression qui persistent au sein même des communautés noires.
Deux interprétations possibles. Soit on considère que les Pulaar, les Wolof ou les Soninké ne sont pas concernés par cette histoire, ce qui serait une absurdité historique doublée d’une négation de leur citoyenneté. Soit on admet qu’il y a une volonté politique — plus ou moins assumée — de concentrer les accusations sur une seule composante de la société : les Bidhan.
Ce choix est lourd de conséquences. En évitant de pointer du doigt les systèmes de castes, de féodalité et de servitude qui traversent aussi les sociétés noires de Mauritanie, on ouvre un boulevard aux critiques. Beaucoup finissent par voir dans l’IRA (Initiative pour la Résurgence du Mouvement Abolitionniste), principale figure du combat abolitionniste, non pas un mouvement universaliste, mais un outil de règlement de comptes. Ce soupçon, même s’il est injuste, prospère à cause d’un angle mort que l’IRA elle-même entretient. Car si sa prise de parole a été salutaire, ayant permis de poser un nom sur une réalité que beaucoup préféraient ignorer, à trop concentrer les dénonciations sur une seule composante de la société, cette lutte risque aujourd’hui de perdre en légitimité.
La réalité, pourtant, est bien connue des chercheurs et des militants. Chez les Pulaar, les élites guerrières ou religieuses continuent d’exercer une domination sociale sur les Maabuɓe(tisserands), les Wayluɓe (forgerons), les Sakkeeɓe(cordonniers) ou encore les musiciens. Chez les Soninké, les Kommo (anciens esclaves), les Naxamalo (forgerons et griots) et autres castes dites « inférieures » restent marginalisés. Et chez les Wolof, le système des castes, avec ses artisans et ses esclaves (les jaam), structure encore largement les rapports sociaux. Tout cela est documenté.
Ces réalités sont connues. Elles sont documentées par les anthropologues, les chercheurs, les historiens – mais rarement dénoncées dans le débat public. Et surtout, elles ne sont presque jamais évoquées par les figures de la lutte abolitionniste. Pourquoi ?
L’IRA appelle les partis politiques Bidhan à inscrire la fin de l’esclavage dans leurs programmes. Mais pose-t-elle la même exigence aux responsables politiques noirs ? Interroge-t-elle Sarr Ibrahima, Kane Mamadou et d’autres sur l’absence de ce sujet dans leurs discours ? Rien n’est moins sûr. Ce silence laisse la porte ouverte à une accusation de plus en plus répétée : celle d’un antiesclavagisme à sens unique.
Il ne s’agit pas ici de défendre les Bidhan, ni de nier les souffrances vécues par les Haratin. Mais de rappeler une vérité simple : l’injustice, qu’elle vienne d’un Bidhan ou d’un Soninké, reste une injustice. Et l’esclavage, quel que soit celui qui le pratique, demeure une atteinte à la dignité humaine.
L’histoire de la traite en Mauritanie est complexe. Les rois du Fouta ou les princes du Walo ou encore certaines élites africaines impliquées dans le commerce atlantique ont eux aussi participé à l’économie esclavagiste, souvent en collaboration avec les commerçants européens ou les chefs Bidhan. L’ignorer, c’est raconter l’histoire à moitié.
Pour être crédible, la lutte contre l’esclavage doit être inclusive. Elle doit dénoncer toutes les formes d’oppression, quel que soit le groupe qui en est responsable. Sinon, elle se transforme en arme politique. Et les injustices qu’elle prétend combattre continueront, sous d’autres formes, de prospérer.
L’IRA a une mission historique. Elle doit l’assumer pleinement. Cela implique de défendre tous les opprimés, sans distinction. D’avoir le courage de dénoncer les injustices là où elles existent, y compris quand elles dérangent. Et surtout, de sortir de la logique identitaire pour retrouver une force politique et morale.
L’IRA porte une cause juste. Mais pour qu’elle devienne un véritable projet de société, elle doit élargir son champ de vision. Défendre les opprimés, tous les opprimés, est le seul moyen de construire une Mauritanie réellement égalitaire.
Parce qu’en Mauritanie, on ne gagnera pas la bataille contre l’esclavage avec des œillères.
Ahmed Fall Ould Sidi Mila
Source : Financial Afrik – (Le 04 avril 2025)
Les opinions exprimées dans cette rubrique n’engagent que leurs auteurs. Elles ne reflètent en aucune manière la position de www.kassataya.com
Diffusion partielle ou totale interdite sans la mention : Source www.kassataya.com