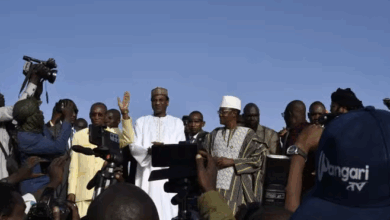– Des centaines de milliers de décès supplémentaires d’enfants, des flambées de nouvelles épidémies, des ONG fermant par dizaines… La baisse de l’aide au développement aux Etats-Unis comme en Europe aura, partout dans le monde, des conséquences humaines dramatiques, alertent de concert l’Organisation mondiale de la santé (OMS), l’Unicef et d’autres organisations internationales. Symbole du grand repli sur soi à l’œuvre, le Royaume-Uni a annoncé, fin février, qu’il va diminuer son budget d’aide publique au développement (APD) de 0,5 % du revenu national brut à 0,3 % d’ici à 2027, son plus bas niveau depuis 1999, pour augmenter ses dépenses militaires.
Une décision qui a aussitôt entraîné la démission de la ministre britannique du développement. Ces coupes « vont priver de nourriture et de soins médicaux des personnes en situation de détresse tout en nuisant profondément à la réputation du Royaume-Uni », a expliqué Anneliese Dodds. Tout en regrettant que cette décision intervienne à un moment où « la Chine est en train de réécrire les règles de la gouvernance mondiale et où la crise du climat est la pire menace sur la sécurité ».
Quelques semaines plus tard, les Etats-Unis ont mis à exécution leurs menaces en annonçant, le 10 mars, qu’ils allaient cesser de financer 83 % des programmes de l’Usaid, plus gros bailleur humanitaire de la planète, avec un budget de 42,8 milliards de dollars (environ 40 milliards d’euros) en 2024. « L’Usaid est une organisation criminelle. Il est temps qu’elle meure », avait prévenu Elon Musk sur son compte X, le 2 février.
La situation s’est encore détériorée depuis avec, ailleurs dans le monde, d’importantes réductions budgétaires. En France, le budget de l’aide au développement connaîtra une baisse de 37 % en 2025, soit 2,1 milliards d’euros de moins qu’en 2024. En Belgique, des coupes de 318 millions d’euros, représentant 32 % du budget, sont également prévues, et les Pays-Bas ont annoncé, début février, qu’ils réduiraient de 2,4 milliards d’euros leurs dépenses annuelles à partir de 2027, pour redéployer leurs efforts vers la défense des « intérêts néerlandais dans les domaines du commerce et de l’économie, de la sécurité et de la stabilité, ainsi que de la migration ».
« Véritable crise mondiale »
Le décrochage est d’autant plus brutal que les budgets n’avaient cessé d’augmenter ces dernières décennies, passant de 80 milliards de dollars en 2000 au montant record de 223,3 milliards de dollars en 2023, selon les derniers chiffres de l’OCDE.
Derrière ces chiffres, ce sont des millions de vies qui sont menacées. Dans la lutte contre l’épidémie de sida, l’assèchement des financements américains « pourrait annuler vingt années de progrès, entraînant plus de 10 millions de cas supplémentaires et 3 millions de décès liés au VIH, soit trois fois plus que [2024] » a prévenu, fin mars, Tedros Adhanom Ghebreyesus, le patron de l’OMS. « Ces nouvelles coupes budgétaires sont en train de provoquer une véritable crise mondiale qui mettra en danger la vie de millions d’enfants à travers le monde », a alerté l’Unicef, début mars, qui craint une baisse des vaccinations contre des maladies mortelles telles que la rougeole et la polio.
Selon le décret présidentiel signé par Donald Trump le 20 janvier pour geler les crédits, « l’administration qui gère l’aide étrangère des Etats-Unis et tout son écosystème n’est pas alignée sur les intérêts américains et est dans de nombreux cas opposés aux valeurs américaines ». Des ONG bénéficiaires de l’aide américaine ont reçu un questionnaire leur demandant de confirmer qu’elles ne soutenaient pas la « justice environnementale » ou l’« idéologie de genre » et si elles contribuaient d’une manière ou d’une autre à la lutte contre l’immigration illégale aux Etats-Unis et le trafic de drogue.
« Aux Etats-Unis, la baisse des crédits est guidée par l’idéologie de “l’Amérique d’abord”, l’idée que le pays n’a pas d’obligations vis-à-vis du reste du monde, explique Minouche Shafik, chargée d’une mission d’évaluation de la politique d’aide au développement britannique. Chez les Européens le sentiment de solidarité internationale existe encore, mais il est relégué au second rang par les nouveaux impératifs liés à la sécurité. »
De nombreuses missions
L’ancienne directrice de l’université américaine Columbia ajoute que, partout en Occident, « l’aide au développement est devenue moins populaire à cause des contraintes budgétaires qui pèsent sur les systèmes de retraite ou de santé, mais aussi à cause de la désinformation sur son inefficacité ». Fin janvier, la porte-parole de la Maison Blanche a ainsi affirmé, à tort, que les Etats-Unis avaient payé 50 millions de dollars de préservatifs pour Gaza. « Nous sommes passés d’un monde où l’on pensait que le partage de la prospérité profiterait à tous, à un autre où l’on considère qu’il n’y a que des perdants et des gagnants », résume Minouche Shafik.
Les attaques de ces derniers mois ont au moins mis en lumière les nombreuses missions de l’aide au développement, de la protection de la biodiversité à la santé en passant par le financement de médias, notamment en Ukraine. « Le problème, c’est qu’elle est devenue illisible pour les Français », déplore Hervé Berville, député (Renaissance) des Côtes-d’Armor et auteur d’un rapport sur la modernisation de l’APD, soumis au Parlement en 2018.
Sert-elle à sauver des vies, à contribuer au développement des pays plus pauvres ou à servir les intérêts diplomatiques et économiques des pays donateurs ? Doit-elle financer la lutte contre le réchauffement climatique, faire reculer la pauvreté, défendre les droits des femmes ? « De nombreux députés ne sont même pas capables de la définir », témoigne Mathieu Paris, chargé de plaidoyer à l’ONG CCFD-Terre solidaire.
Ces dernières années, elle s’est surtout résumée à un chiffre ou, plutôt, à un objectif : celui d’atteindre un budget de 0,7 % de la richesse nationale. Un engagement pris par les pays riches en 2005 et qu’ils n’ont jamais atteint, à l’exception de la Norvège, de l’Allemagne et du Luxembourg. « En ces temps difficiles, il faut, au contraire, réaffirmer nos valeurs, celle d’une humanité partagée, plaide Esther Duflo, Prix Nobel d’économie en 2019. Une vie humaine ne compte pas pour rien parce qu’elle est au-delà de nos frontières. » L’économiste rappelle que le principe de l’aide « est d’investir dans des projets ayant le plus grand impact sur la qualité de vie des personnes pauvres à travers le monde ».
Lorsqu’elle voit le jour, au lendemain de la seconde guerre mondiale, l’aide au développement a une vocation politique. En mars 1961, le président américain John F. Kennedy plaide devant le Congrès pour la création d’un programme « d’aide étrangère » avec trois obligations : « Nos obligations morales en tant que leader avisé et bon voisin dans la communauté interdépendante des nations libres ; nos obligations économiques en tant que peuple le plus riche dans un monde largement composé de pauvres (…) ; et nos obligations politiques en tant que principal contrepoids aux adversaires de la liberté. »
nstrument d’influence
De l’autre côté de l’Atlantique, le général de Gaulle défend aussi, la même année, lors d’une conférence de presse, une aide au service de l’intérêt français, en n’y allant pas par quatre chemins : « Tous les pays sous-développés qui, hier, dépendaient de nous et qui, aujourd’hui, sont nos amis préférés, demandent notre aide et notre concours. Mais cette aide et ce concours, pourquoi les donnerions-nous si cela n’en eût pas valu la peine ? »
Source :
Diffusion partielle ou totale interdite sans la mention : Source www.kassataya.com