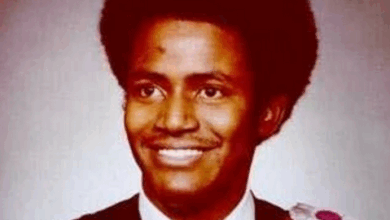Jacques Delors, mort mercredi 27 décembre à 98 ans, était un authentique socialiste, révolté par les injustices, désireux de changer le cours des choses. L’Histoire retiendra cependant qu’il fut l’un de ces grands chrétiens démocrates qui ont fait l’Europe. C’est tout son paradoxe. Nommé en 1985 à la tête de la Commission des communautés européennes, l’autodidacte boulimique, passé par le syndicalisme chrétien, a incarné l’âge d’or de la Commission en construisant, aux côtés de François Mitterrand et d’Helmut Kohl, le chemin vers l’euro.
Mais en France, il est l’homme de la rigueur, le « Jérémie plaintif » que moquait Raymond Barre, l’indécis qui laissa le désir monter pour finalement renoncer à se présenter à l’élection présidentielle de 1995. Ce rendez-vous manqué avec les Français l’a torturé. « Soit je mentais au pays, soit je mentais aux socialistes », expliquait-il sans relâche, en pointant le fossé entre son projet très deuxième gauche et le discours quasi révolutionnaire du premier secrétaire socialiste de l’époque, Henri Emmanuelli. Mais à la fin de sa vie, il confiait au Monde : « Parfois, oui, je regrette de ne pas avoir osé, j’ai peut-être eu tort. »
Des combats perdus et des occasions manquées
La confession s’était déroulée en juin 2013, rue de Milan à Paris, dans les locaux de Notre Europe, l’association que le chancelier allemand et le chef du gouvernement espagnol Felipe Gonzalez l’avaient incité à créer à son départ de Bruxelles, en janvier 1995, « alors que Jospin n’avait pas fait un geste pour m’aider ». Delors tel qu’en lui-même : heureux et malheureux, la voix un peu chevrotante, la démarche rendue difficile par plusieurs attaques de sciatique, mais les yeux d’un bleu lumineux qui éclairaient tout le visage.
Quelques jours plus tôt, chemise rose et cravate rouge, le militant de la cause européenne était allé « pousser un coup de colère » à la Mutualité, devant le forum des progressistes européens où il avait goûté les applaudissements. Il avait exhorté l’UE à accélérer la mise en œuvre du pacte de croissance négocié en 2012 par François Hollande. « Les 120 milliards d’euros du plan de relance européen, qui s’en occupe ? », avait-il grondé, avant de s’adoucir : « N’ayez pas peur, nous y arriverons ! »
L’histoire qu’il racontait était remplie d’espoir mais jalonnée de combats perdus et d’occasions manquées, sans cependant une once de méchanceté, car si l’homme était sans complaisance, c’était d’abord vis-à-vis de lui-même. Ni le succès ni la gloire n’avaient réussi à guérir l’ancien stagiaire de la Banque de France d’une timidité maladive, du sentiment d’être « un vieux con » au milieu des grands fauves politiques qu’il avait côtoyés. L’angoisse de mal faire l’avait accompagné toute sa vie, qu’il noyait dans une boulimie de travail. « Il me manque, disait-il, une qualité capitale pour un homme politique : croire en moi. »
Il était pourtant fils unique, choyé par ses parents. Né sept ans après la fin de la Grande Guerre, il avait grandi heureux, sur la pente de Ménilmontant, à Paris, tapant le ballon dès qu’il le pouvait avec ses camarades. Elève sensible et doué, passionné de musique et de sport, il voulait être journaliste, cinéaste ou pourquoi pas grand couturier, comme l’écrit son biographe Gabriel Milesi (Jacques Delors, Belfond, 1985). Mais lorsqu’il obtient le bac, son père, Louis, garçon de recettes à la Banque de France, ne lui laisse pas le choix : « La Banque de France, il n’y a rien de mieux », tranche-t-il.
A cette époque, dans ce milieu-là, on ne fait pas d’études supérieures. L’adolescent ne se révolte pas mais se démultiplie : le soir, après le travail, il potasse les concours internes, pratique assidûment le basket, monte un ciné-club, milite à la CFTC et vit sa vie de jeune marié. A la banque, il a rencontré Marie, Basque au grand cœur, chrétienne à la foi aussi vive que la sienne. « L’événement le plus important de ma vie », dira-t-il. Deux enfants naissent : Martine, en 1950, Jean-Paul, trois ans plus tard.
Engagement religieux
Politiquement, son cœur penche à gauche. Il admire Pierre Mendès France mais déteste le jeu politicien. Un an après y avoir adhéré, il a claqué la porte du Mouvement républicain populaire (MRP). Ce qui se passe à la CFTC en revanche le passionne. Trois fois par semaine, il prête main-forte à ceux qui, autour de Paul Vignaux, secrétaire général du Syndicat général de l’éducation nationale (SGEN), ont entrepris de déconfessionnaliser le syndicat. Il monte des groupes de travail, attire des experts vers la revue Reconstruction où il signe lui-même sous le pseudonyme de Roger Jacques.
Parallèlement, il approfondit son engagement religieux en s’impliquant avec sa femme dans La Vie nouvelle, un mouvement d’éducation populaire issu du scoutisme catholique. L’inspiration est proche du personnalisme communautaire d’Emmanuel Mounier. Lorsque le mouvement lance les cahiers Citoyen 60, pour développer la formation politique, économique et sociale des moins favorisés, il en devient tout naturellement le rédacteur en chef.
Le syndicalisme offre à ce bûcheur engagé le tremplin qui lui manquait. En 1959, la CFTC l’envoie siéger au Conseil économique et social (CES). Trois ans plus tard, Pierre Massé, attiré par la qualité de ses travaux, l’appelle au Commissariat général du Plan. Tournant décisif : à 37 ans, l’autodidacte devient haut fonctionnaire et réalise enfin son rêve, « servir l’Etat ». Le Plan, sous la houlette de l’ingénieux Pierre Massé, est à son apogée. Jacques Delors y voit le moyen d’expérimenter pour la première fois tout ce qu’il a mûri. Son utopie ? Une société plus humaine. Sa méthode ? Un pragmatisme réaliste et raisonné. Ses outils : la politique contractuelle, autrement dit le compromis négocié entre groupes sociaux éclairés.
En 1963, le conflit des mineurs prend mauvaise tournure. On le nomme rapporteur de la commission de conciliation. Pour faire baisser la tension, il invite les syndicalistes à dîner chez lui. Marie fait la popote pendant que lui dépiaute avec eux les données qu’il s’est procurées. Son rapport diagnostique un retard de salaire de 10 %, la grève s’arrête. Pour arriver à ce chiffre, il a fallu convaincre l’administration et les syndicats de jouer cartes sur table. La transparence deviendra son combat. Comme la lutte contre l’inflation, dont il vient de mesurer les méfaits : elle entraîne des périodes de surchauffe, suivies de plans de refroidissement dont pâtissent les plus faibles. Pour la maîtriser, il suggère qu’on fixe la hausse des salaires à l’avance, en fonction des résultats de l’entreprise et des performances de l’économie au lieu de l’indexer sur les prix. L’idée n’est pas reprise, mais qu’importe ! Il a semé.
Six ans plus tard, il la reprend au vol. Cette fois, il est à Matignon, installé dans l’immense bureau du rez-de-chaussée où défileront bientôt les représentants du patronat et des syndicats. Il vient d’être nommé conseiller social du nouveau premier ministre, Jacques Chaban-Delmas (1915-2000). « Un homme de droite ! », s’indigne la gauche. « Un homme qui avait la volonté de changer les choses », riposte Jacques Delors. Ils se sont connus au début des années 1960, lorsque l’ambitieux président de l’Assemblée nationale réunissait autour de lui des experts de tous horizons. Mai-68 les convainc que la société, « déstabilisée, est mûre pour les réformes ». Lorsque Chaban l’appelle, il n’hésite pas longtemps. Marie lui a donné l’imprimatur.

L’eau et le feu
Le discours sur « la nouvelle société » prononcé à l’Assemblée nationale, le 16 septembre 1969, fait date. Il reprend le constat du sociologue Michel Crozier d’une « société bloquée » et propose comme remède le credo de Jacques Delors : la politique contractuelle. Les réalisations ne sont cependant pas à la hauteur des promesses. A l’Elysée, Georges Pompidou a tout de suite pris ombrage de l’audace de son premier ministre. Le conseiller social parvient à faire signer un premier « contrat de progrès » à EDF sans que l’Etat y mette son nez. D’autres suivront mais, à l’été 1972, tout s’arrête. Pompidou, lassé, a remercié son premier ministre. Jacques Delors est marginalisé. Trop à gauche pour la droite, trop à droite pour la gauche, il est boudé.
Il prend du champ, crée un club, Echange et projets, publie un livre, Changer (Stock, 1975), enseigne à Dauphine après l’avoir fait à l’ENA. Mais il n’a que 47 ans et a pris goût au service de l’Etat. Comment revenir dans le jeu ? Soudain, tout s’accélère : Pompidou meurt le 2 avril 1974. Chaban se déclare aussitôt candidat. Jacques Delors l’aide, en vain : le maire de Bordeaux est marginalisé, François Mitterrand frôle de très près la victoire. C’est vers lui désormais qu’il va marcher.

Delors et Mitterrand, l’eau et le feu. Ils se sont rencontrés pour la première fois au début des années 1960 dans le bureau de Jean-Jacques Servan-Schreiber à L’Express. « J’ai besoin d’un garçon comme vous », lui a lancé Mitterrand, séducteur. Delors n’a pas donné suite. Il ne réprouve pas la stratégie d’union de la gauche du futur président mais redoute son charisme, craint de perdre son indépendance et déteste le jeu des courtisans. En 1965, il a refusé de faire partie de son contre-gouvernement. Première fâcherie, suivie de beaucoup d’autres : Mitterrand ne comprend pas les états d’âme de cet écorché vif et ne fait rien pour ménager sa susceptibilité. Lorsque, en novembre 1974, le fondateur d’Echange et projets se décide enfin à adhérer au Parti socialiste, il se fait chambrer à la fois par le Ceres, l’aile gauche du PS, et par les supporteurs de Michel Rocard.
Source :
Diffusion partielle ou totale interdite sans la mention : Source www.kassataya.com