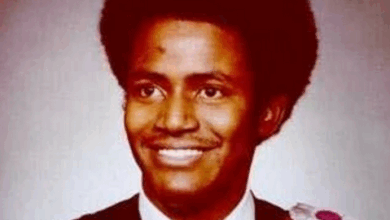– Enquête – Au carrefour de l’anthropologie, de la philosophie politique et de l’archéologie, plusieurs travaux récents remontent aux origines historiques et conceptuelles de l’institution étatique, dans le but de dépasser l’hégémonie de cet objet aujourd’hui considéré comme la forme immuable du pouvoir.
Un anarchiste qui se passionne pour les royautés sacrées. Il y a quelques années, l’essai Sur les rois (La Tempête, 620 pages, 35 euros) aurait peut-être stupéfié. Plus maintenant, et David Graeber (1961-2020), coauteur de l’étude avec Marshall Sahlins (1930-2021), compte sûrement pour beaucoup dans ce nouvel air du temps. Avec James Scott, aujourd’hui âgé de 86 ans, il est à l’origine de l’anthropologie anarchiste, dont l’objet est la critique radicale des formes du pouvoir dans nos sociétés actuelles. Et en particulier de son incarnation : l’Etat. De la bureaucratie à la dette, des embryons étatiques surgis au néolithique à l’archéologie de la souveraineté, ces deux figures de la discipline ont participé au renouvellement de ce concept central de nos systèmes politiques. Au-delà de ce courant, tout un pan des sciences sociales, à la croisée de l’anthropologie, de l’archéologie, de l’histoire et de la philosophie politique, se penche sur le sujet. « Nous vivons un moment de questionnement sur l’Etat, dans un contexte d’hégémonie du néolibéralisme », observe le sociologue Christian Laval, coauteur en 2020 de Dominer. Enquête sur la souveraineté de l’Etat en Occident (La Découverte) avec le philosophe Pierre Dardot. « L’Etat apparaît aujourd’hui comme une institution incapable de répondre aux problèmes : les aspirations démocratiques, le terrorisme, les inégalités et, avant tout, la crise écologique », tranche le philosophe Edouard Jourdain. Les sciences sociales cogitent donc pour sortir de l’impasse politique. Mais aussi académique, signale l’anthropologue Philippe Descola : « L’Etat est devenu un horizon intellectuel indépassable. La réflexion contemporaine est très pauvre, car elle s’inscrit dans la double filiation du libéralisme et du socialisme, qui ont en commun de séparer radicalement les humains et le reste du monde. » Cette cécité destructrice, James Scott la retrace dans L’Œil de l’Etat (La Découverte), ouvrage publié en 1998 mais seulement traduit en 2021. Le professeur émérite de science politique et d’anthropologie à l’université Yale y explore l’obsession des Etats modernes à rationaliser et à contrôler le territoire et les individus dont il a la charge. De l’état civil aux standards métriques, de l’imposition de cadastres à celle des langues, James Scott appréhende l’action de l’Etat comme une simplification du réel par la force « afin de lui donner une forme plus lisible et plus commode à administrer ». L’anthropologue se penche en particulier sur les expériences de modernisations brutales au XXe siècle, comme la collectivisation soviétique, les réformes agraires dans les pays du Sud et la villagisation forcée en Tanzanie. Ces expériences portent toutes, à ses yeux, la trace d’une idéologie « haut-moderniste », qui a pour effet d’anéantir un tissu de savoirs vernaculaires constitué à travers les siècles. « Des génocides à la colonisation, l’Etat moderne, malgré certains progrès, a un bilan politique et humain accablant », juge Jean-François Bayart, qui a publié en 2022 L’Energie de l’Etat. Pour une sociologie historique et comparée du politique (La Découverte), aboutissement de cinquante ans de recherche sur le sujet. Le politiste, spécialiste de l’Etat en Afrique, y formule une « critique politique de la formation de l’Etat » en l’analysant comme le produit d’une opération historique : il dénonce, à l’instar de James Scott, l’abstraction comme vecteur de sa domination. L’émergence de la « raison d’Etat », qui autorise la violence physique, marque à ses yeux le premier maillon d’une chaîne d’abstractions : le peuple, dont on postule qu’il forme une nation ; le territoire, découpé par des délimitations imaginaires ; et le marché, dont le professeur à l’Institut de hautes études internationales et du développement de Genève fait le « fruit de la territorialisation de l’Etat ». Cette série d’abstractions a permis de « produire un style de domination » composite, des formes les plus douces (les normes culturelles et juridiques) à la violence physique. « La violence fait l’Etat », affirme-t-il. A la lumière de ce prisme, le politiste analyse trois grands processus contemporains que sont l’universalisation de l’Etat-nation, la montée de l’identitarisme et des nationalismes, et les globalisations, économique, mais aussi technologique et culturelle. Pour Jean-François Bayart, ces dynamiques mêlant mondialisation et repli ne sont contradictoires qu’en apparence : cette « tension triangulaire » cristalliserait en réalité des logiques intrinsèques à la dynamique historique de l’Etat. Celui-ci serait perpétuellement en tension entre ces trois pôles, façonnant une instable « globalisation national-libérale » dont des dirigeants comme l’Américain Donald Trump, le Turc Recep Tayyip Erdogan et l’Indien Narendra Modi ne constituent pas à ses yeux des anomalies, mais des synthèses.Libérer l’imaginaire
Alors que les questions sociale et écologique sont brûlantes, l’Etat moderne serait donc voué à amplifier des problèmes qu’il demeure impuissant à résoudre : si cette galaxie de pensées critiques recoupe des courants pluriels, elle se retrouve sur ce dénominateur commun. « L’enjeu actuel est le dépassement de l’Etat comme achèvement de la raison et finalité de toutes les formes politiques », estime Christian Laval. « L’interprétation téléologique de l’Etat-nation comme espace de domination naturel » est aussi récusée par Jean-François Bayart : « Si l’Etat a fini par absorber l’idée même de politique, la sociologie historique montre qu’il n’a rien d’un horizon indépassable. » L’enjeu est donc intellectuel et, au-delà, symbolique : l’objectif de libérer un imaginaire verrouillé par l’hégémonie intellectuelle de l’Etat.
Cette personnalité juridique souveraine est pourtant devenue l’autorité toute-puissante que l’on connaît il y a une poignée de siècles à peine. On attribue la conceptualisation originelle de la souveraineté de l’Etat au philosophe et magistrat français Jean Bodin (1530-1596), qui la définit comme « puissance absolue et perpétuelle d’une République » dans Les Six Livres de la République (1576). C’est d’ailleurs à cette période que s’impose le curieux terme « Etat » : « L’étymologie du mot “Etat” découle du latin stare (ce qui tient debout) et renvoie à la notion de stabilité, de permanence. Il faut attendre la période charnière, entre la fin du XVe siècle et le XVIe siècle, où l’on bascule de la féodalité à la Renaissance, pour que l’“Etat” (orthographié avec une majuscule) prenne son acception moderne », relève le professeur de droit Béligh Nabli, dans L’Etat. Droit et politique (Armand Colin, 2017).
De l’Eglise à la République
L’Etat n’a donc initialement rien d’universel, de permanent ou d’indépassable, rappellent ces penseurs critiques, qui entreprennent une déconstruction à trois niveaux. Sa dimension évolutionniste, d’abord, qui en fait le stade final de toute société – dont le corollaire est de renvoyer les sociétés dépourvues d’Etat à un prétendu archaïsme. Sa nécessité, ensuite, pensée par les philosophes du contrat social Thomas Hobbes (1588-1679) et John Locke (1632-1704), qui en font le rempart face à la guerre de tous contre tous, ainsi que par Jean-Jacques Rousseau (1712-1778).
Sa toute-puissance, enfin, qui repose sur une quête de maîtrise totale d’un territoire et de sa population. Cette trajectoire est retracée par Pierre Dardot et Christian Laval dans la vaste « généalogie de la souveraineté de l’Etat » que forment les 700 pages de Dominer. S’ils partent en quête de ses fondements intellectuels et historiques, c’est que « la souveraineté de l’Etat n’est pas la solution », mais « fait partie du problème ».
Contre les courants de gauche y voyant un rempart face au capitalisme, ces auteurs soutiennent que cette « idéologie souverainiste (…) empêche de dépasser le moment néolibéral de la politique mondiale », car elle alimente le nationalisme et se méprend sur l’hybridation déjà opérée entre néolibéralisme, identitarisme et protectionnisme de Recep Tayyip Erdogan, Narendra Modi et Donald Trump.
Penser « une organisation politique du monde au-delà de la souveraineté de l’Etat » réclame d’en faire l’archéologie. Dominer s’y attaque en revenant au néolithique, période s’étalant d’environ – 9500 à – 2300 avant J.-C. ayant vu l’apparition de l’agriculture et des premières civilisations, dans laquelle ils perçoivent l’émergence d’une première « souveraineté non étatique, sans pouvoir exécutif centralisé ». Dans cette trajectoire plurimillénaire, Pierre Dardot et Christian Laval identifient un tournant majeur en Occident : la souveraineté y aurait émergé au milieu du Moyen Age comme « une invention tardive de l’Eglise », sous l’effet d’un processus qualifié de « révolution papale ».
Source : – (Le 24 novembre 2023)
Diffusion partielle ou totale interdite sans la mention : Source www.kassataya.com