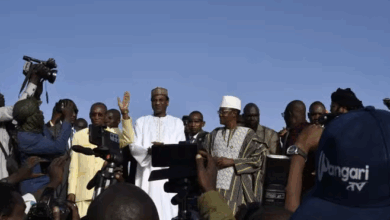Le Quotidien – Des centaines de milliers d’objets culturels africains, spoliés durant la période coloniale, garnissent les musées en France. Ces objets peinent toujours à retrouver la terre de leurs concepteurs. Il y a eu la restitution du sabre et de son fourreau qui ont eu appartenu à El Hadj Omar Tall, chef religieux et de guerre en Afrique de l’Ouest durant le XIXe siècle. Mais, il est détenu par le Musée de l’Armée à Paris. Il y a eu le retour au Bénin de 26 pièces du «Trésor de Béhanzin» pillées au Palais d’Abomey, capitale historique du royaume du Dahomey, en 1892. Si la France s’est engagée à poursuivre le processus, le rythme est toujours lent.
Ils se comptent par centaines de milliers, les objets et biens culturels soustraits d’Afrique par la France durant l’époque coloniale et meublant encore aujourd’hui des institutions muséales et collections privées dans ce pays. Au-delà de l’occupation des territoires et de l’accaparement de leurs ressources premières, le colonialisme français s’est dédoublé d’une vaste opération de spoliation des œuvres historiques et culturelles à la signification particulière chez les autochtones. «90 mille objets que nous avons comptés, au moins, pour l’Afrique subsaharienne, sont dans les musées français», a noté l’économiste sénégalais Felwine Sarr, co-auteur du rapport sur la restitution du patrimoine culturel africain (publié en 2018) commandité par l’Etat français. Felwine Sarr, qui s’était exprimé en marge de la remise symbolique de l’épée de El Hadj Oumar Foutiyou à l’Etat du Sénégal, a indiqué qu’autour de 80 à 85% du patrimoine culturel matériel africain se trouvent en Europe occidentale.
Objets spoliés par la force du canon et par la ruse
A la faveur de conquêtes militaires, les Français ont sapé toute volonté de résistance à leur œuvre d’accaparement. Au Sénégal par exemple, les résistants Lat Dior Diop, Alboury Ndiaye, Mamadou Lamine Dramé ou encore El Hadj Oumar Foutiyou Tall ont fait face et sont tombés face à l’Armée française. Samory Touré et Kissi Kaba Keïta en Guinée… Partout ailleurs où ils sont passés, il en était de même pour les autochtones, balayés par la force des armes. L’historien Mbaye Guèye, qui évoque une «expropriation éhontée par la force du fusil», n’a pas manqué de dénoncer la brutalité exercée par la puissance coloniale pour s’accaparer de biens culturels.
Il ajoute : «La colonisation n’était pas que militaire et économique, il fallait aussi déposséder les Africains de leur culture matérielle.» «Pour marquer sa victoire après des confrontations avec des armées de résistance sous-équipées, l’armée coloniale française s’est offert un butin de guerre, fruit de pillage et d’expropriation forcés d’éléments fonctionnels des cultures locales dont le sens dépassait le cadre esthétique», a-t-il indiqué, affirmant que bijoux, décorations de palais, statues et autres artefacts ont ainsi été envoyés en France.
«Lors de la victoire sur les troupes de Ahmadou à Ségou, ils ont emporté des sabres, des objets royaux, 143 manuscrits, en plus du fils du résistant âgé d’une dizaine d’années», a relevé Guèye, en illustration de l’ampleur de l’œuvre destructrice de la colonisation, qui n’a épargné aucun secteur.
«Les missionnaires ont joué un rôle important dans cette opération, en demandant aux autochtones de jeter leurs objets d’adoration.
Leur objectif supposé de «civiliser» les Africains leur a permis de soustraire les pièces pour les convoyer ensuite en France», a encore relevé Guèye, sans omettre les missions ethnographiques qui leur ont aussi permis de mettre la main sur des objets culturels.
Des échanges épistolaires de Louis Faidherbe, ancien Gouverneur de l’Afrique occidentale française (Aof), témoignent de la cruauté des méthodes utilisées par l’armée coloniale française dans l’entreprise d’aliénation.
«En dix jours, nous avons brûlé plusieurs villages de la Taouey (Nord du Sénégal), pris 2000 bœufs, 30 chevaux, 50 ânes et un important nombre de moutons, fait 150 prisonniers, tué 100 hommes et inspiré une salutaire terreur à ces populations», revendiquait dans une lettre, le Français Louis Faidherbe, gouverneur du Sénégal entre 1863 et 1865. «J’ai détruit de fond en comble un charmant village de 200 maisons et tous les jardins. Cela a terrifié la tribu, qui est venue se rendre aujourd’hui», a-t-il encore évoqué en 1851 dans une lettre à sa mère, parlant de ses faits d’armes en Algérie.
Les pillages et destructions allant avec ont toutefois épargné les créations artistiques et cultuelles que les conquérants ont transférées dans leur pays comme butin de guerre. C’est ainsi que se sont retrouvés dans les musées français, des restes humains et objets culturels en provenance d’Afrique. Aucun des terroirs conquis n’a été épargné dans cette œuvre d’expropriation à grande échelle ayant vidé des sociétés entières de leur essence.
Une restitution à pas de tortue
La France s’était engagée, par la voix du Président Emmanuel Macron, à une opération d’envergure de restitution des biens culturels subtilisés d’Afrique pendant la période coloniale. «Je veux que d’ici 5 ans, les conditions soient réunies pour des restitutions temporaires ou définitives du patrimoine africain en Afrique», avait lancé le Président Macron, lors d’une visite à Ouagadougou (Burkina Faso) en 2017.
Source : Le Quotidien (Sénégal) – Le 22 juillet 2023
Diffusion partielle ou totale interdite sans la mention : Source www.kassataya.com