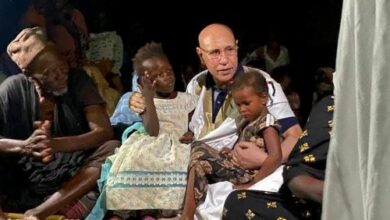Afrique XXI – Tribune (1/3) · Comment Achille Mbembe, qui clamait en 2017 que les Africains n’avaient « rien à attendre de la France », a-t-il pu devenir, quatre ans plus tard, l’ambassadeur de la politique africaine d’Emmanuel Macron ? Dans une tribune déclinée en trois parties, Roger Esso-Evina propose de décrypter les faux-semblants de cette collaboration inattendue.
En 2010, alors que la célébration du cinquantenaire des « indépendances chacha » bat son plein sur le continent, Achille Mbembe, qui vient de publier aux éditions La Découverte Sortir de la grande nuit, essai sur l’Afrique décolonisée, tient ce langage : « L’Europe n’est plus notre obsession, oublier la France peut être un point de départ pour imaginer quelque chose de différent. Pourquoi restons-nous enfermés dans cette impasse ? »1 En novembre 2017, quelques heures avant le fameux « discours de Ouagadougou » du président Emmanuel Macron, il persiste et signe avec Felwine Sarr une tribune au vitriol dont le titre retentissant résonne encore aujourd’hui comme un mot d’ordre : « Africains, il n’y a rien à attendre de la France que nous ne puissions nous offrir à nous-mêmes. »2 C’est donc fort logiquement que l’on a été sidéré de découvrir plus tard dans une chronique de sa plume qui fera polémique au Cameroun3, le « nouveau réalisme » qu’il prêche dorénavant et qui consiste, « pour la France comme pour ses alliés occidentaux », « …[à] organiser une nouvelle “grande transition” », « à l’exemple du général de Gaulle en 1944 ».
Comment comprendre ce retournement spectaculaire du discours de l’un des penseurs les plus brillants et les plus féconds de notre temps ? Comment comprendre qu’une pensée de l’émancipation puisse déboucher sur l’apologie de la domination ? Comment comprendre que l’ambition visant à libérer les esprits de l’emprise de la « Bête » se solde par la décision de servir « la République et sa Bête »4 ?
L’heure des propositions
Achille Mbembe s’en est expliqué à plusieurs reprises et de plusieurs manières à travers la médiasphère. Une des raisons qu’il a avancées est la suivante : « Pour accompagner ce processus, […] le président voulait quelqu’un […] capable de dresser des constats nouveaux parce qu’il en faut, mais aussi de passer de la critique à des propositions, car c’est de cela que nous avons le plus besoin en ce moment »5. La critique ne serait donc plus à l’ordre du jour ; l’heure, désormais, est aux propositions.
Des treize propositions que contient le rapport au titre programmatique : Les nouvelles relations Afrique-France : relever ensemble les défis de demain (désormais NRAF), qu’il a remis au président Macron en réponse à la lettre de mission que ce dernier lui avait adressée le 8 février 2021, la plus forte et la plus emblématique est sans doute la toute première, qui porte sur la création d’un « Fonds d’innovation pour la démocratie »6. Un an après l’annonce de sa création, à Montpellier, le « Fonds », qui s’est mué entre-temps en « Fondation de l’innovation pour la démocratie », a été lancé le 6 octobre 2022 à Johannesburg (Afrique du Sud) ; lancement aussitôt suivi par un cycle de forums organisés successivement à Johannesburg, à Yaoundé (Cameroun) et récemment à Alger (Algérie), autour du projet « Notre Futur – Dialogues Afrique-Europe ».
Le moment nous paraît donc opportun de revenir, à l’effet de la réévaluer, sur cette offre particulièrement clivante. L’arraisonnement auquel nous la soumettons ici vise, autant que faire se peut, à mieux cerner le repositionnement d’Achille Mbembe dans son rapport à l’ancienne puissance coloniale.
Confusion des genres
La « démocratie », en Afrique, est un véritable serpent de mer ; ou, si l’on veut, une sorte d’arlésienne qui, au moins depuis le simulacre des « indépendances », n’a pas fini de troubler le sommeil de ces « hommes forts » qui trônent ad vitam aeternam à la tête des « États fragiles ». Signe, d’une part, d’une réelle « demande de démocratie », et, d’autre part, d’une forte résistance de l’autocratie. Cette situation paradoxale a conduit des responsables politiques et militaires, des diplomates et des observateurs à penser qu’il y aurait chez les Africains comme une sorte d’addiction à un autoritarisme atavique qui rendrait impossible la « greffe » de la démocratie en Afrique. L’échec répété des expériences qui, à travers le continent, s’essaient à importer le modèle de la démocratie libérale occidentale a achevé d’assigner les Africains dans le camp des peuples voués à la « servitude volontaire », incapables de se gouverner par et pour eux-mêmes.
Source : Afrique XXI
Diffusion partielle ou totale interdite sans la mention : Source www.kassataya.com
Les opinions exprimées dans cette rubrique n’engagent que leurs auteurs. Elles ne reflètent en aucune manière la position de www.kassataya.com