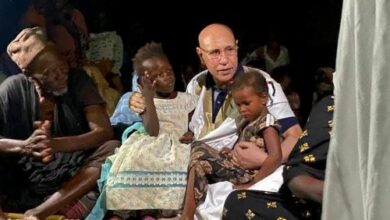Il relève désormais de l’antienne de souligner qu’il n’est jamais évident de se projeter dans le futur notamment lorsqu’il s’agit d’évoquer la vie politique d’un pays, fût-il la Mauritanie. Cela est encore plus vrai pour les personnes extérieures à la vie parlementaire.
Il est en effet difficile de rendre compte de cette dernière lorsque l’on n’est ni parlementaire, ni fonctionnaire de l’Assemblé nationale. Toutefois, le juriste – publiciste – a pour lui, la connaissance des règles du droit parlementaire dont la plupart sont constitutionnalisées ou encadrées par le règlement de l’Assemblée nationale. Il n’est dès lors pas incongru d’analyser les conséquences du scrutin des 13 et 27 mai 2023.
Chacun sait qu’en Mauritanie les cultures juridique et politique ne sont pas les choses les mieux partagées par le « personnel politique ». A cet égard, bien qu’il ne soit jamais aisé de déconstruire les apparences, il nous semble utile d’apporter un éclairage au fonctionnement futur de l’Assemblée nationale, sans pour autant confondre notre représentation propre du réel avec le réel lui-même.
Le 22 juin 2019, Mohamed ould Cheikh El Mohamed Ghazouani a été officiellement élu président de la République avec 52,01% des voix. A quelques mois du terme de son mandat, il est désormais soutenu par une majorité parlementaire hégémonique.
En effet, le scrutin des 13 et 27 mai 2023 a permis au parti du chef de l’Etat (El Insaf) d’obtenir 107 des 176 sièges de l’Assemblée nationale. A ces derniers, il convient d’ajouter les 42 sièges obtenues par les partis satellites qui gravitent autour du parti de la majorité présidentielle. Ainsi, plus des ¾ des sièges du Parlement sont occupés par la majorité présidentielle.
Seuls, 28 sièges reviennent à l’opposition ou plutôt aux oppositions, dès lors que l’on sait les différents partis d’opposition partagent peu de choses notamment l’essentiel. Il suffit pour s’en convaincre de se remémorer la faible mobilisation des électeurs lors du second tour des législatives pour la zone Europe.
De facto, le résultat des législatives amplifie le score réalisé par le Chef de l’Etat lors de l’élection présidentielle de 2019. Partant, le parlementarisme s’évanoui voire s’atrophie et logiquement le présidentialisme est exalté et poussé à son paroxysme. En effet, si le poids de l’Exécutif se mesure à l’aune du soutien de la majorité parlementaire, « le gouvernement responsable devant le Parlement » conformément à l’article 43 de la Constitution est plus que jamais est hors de portée de toute atteinte. Censé être contrôlé par le Parlement – Assemblée nationale – c’est cette dernière qui se retrouve sous le contrôle de l’Exécutif. Le Président, disposant de l’essentiel du pouvoir, se retrouve sans interlocuteurs institutionnels et, pis encre, sans contre-pouvoirs à la mesure de sa puissance. Face à lui se dresse une opposition émiettée dont le parti Tawassoul est la première force avec 10 députés – suffisant pour constituer un groupe parlementaire, suivi par le parti FRUD (7 députés).
Nous abandonnerons volontiers aux sociologues et autres politistes le soin d’examiner les raisons de l’attrait pour un parti contesté dans la vie de tous les jours mais qui continue néanmoins à attirer à la fois les candidats et les électeurs.
Derrière le résultat des élections, c’est surtout le fonctionnement de l’Assemblée nationale qui se trouve impacté. Avec une majorité présidentielle plus que jamais renforcée (1) et des oppositions plus que jamais émiettées et réduites à faire de la figuration, il est peu probable que le Parlement sorte grandi de cette phase de notre vie parlementaire (2).
1. Une majorité présidentielle hégémonique
Le régime politique mauritanien est calqué sur le régime de la Cinquième république, qui on le sait était destiné à garantir la stabilité du régime en l’absence de majorité au Parlement grâce à l’introduction de ce qu’il est désormais convenu d’appeler le parlementarisme rationalisé. Or, la configuration actuelle du Parlement mauritanien conjugué à la faible maturité politique de la classe politique laisse entrevoir un président aussi lymphatique soit-il exercer ses pouvoirs sans limites.
En effet, les mécanismes du parlementarisme rationalisé visent davantage la majorité que l’opposition qui par définition est minoritaire. Avec plus des ¾ des députés – dociles et soumis – le chef de l’Etat n’est point tenu de faire de la politique au sens noble du terme, c’est-à-dire convaincre de la juste de la justesse de ses orientations quitte à faire des compromis ça et là.
Plus la majorité parlementaire au soutien du Président de la République est solide, plus elle renforce celui-ci et son gouvernement, plus elle s’affaiblit elle-même. Elle devient l’instrument de l’Exécutif, confinée à distance du pouvoir gouvernant. Il est en effet difficile d’imaginer que ceux qui soutiennent l’Exécutif appliquent dans toute sa vigueur l’article 72 de la Constitution qui prévoit que « Le Gouvernement est tenu de fournir au Parlement, dans les formes prévues par la loi, toutes explications qui lui auront été demandées sur sa gestion et sur ses actes ». Le contrôle parlementaire sera nécessairement lâche. Les députés de la majorité parlementaire invisibilisés à leurs corps défendant deviendront les obligés du président de la République.
Il n’est pas nécessaire de démontrer que la position d’un député n’est pas nécessairement identique à celle de son groupe parlementaire notamment dans un pays où les faits ethniques et tribaux priment sur le sentiment d’appartenance à la nation.
Il suffit de rappeler à cet égard quelques absurdités contenues dans la Loi n° 2022-023 /P.R/ portant loi d’Orientation du Système Educatif National. L’article 65 de cette dernière que nous nous permettons de citer in extenso prévoit de manière absurde que « Pour offrir l’accès le plus facile, le plus efficace et le plus équitable ou savoir, chaque enfant mauritanien sera enseigné dans sa langue maternelle, tout en tenant compte du contexte local et des impératifs de préservation de la cohésion sociale.
L’enseignement est dispensé en langue arabe à tous les niveaux d’éducation et de formation, aussi bien dons les établissements publics que dons les établissements privés.
Les langues nationales Poular, Soninké et Wolof sont introduites, promues et développées à tous les niveaux d’éducation, aussi bien dans les établissements publics que dans les établissements privés d’éducation et de formation, à la fois comme langues de communication et comme langues d’enseignement ; selon la langue maternelle et la demande exprimée pour chacune de ces langues.
Au niveau du primaire, chaque enfant mauritanien effectue l’apprentissage des disciplines scientifiques dons sa langue maternelle, tout en tenant compte du contexte local et des impératifs de préservation de la cohésion sociale.
Tout enfant de langue maternelle arabe doit apprendre ou moins l’une des trois langues nationales (Poular, Soninké et wolof). Le choix de cette langue est guidé par le contexte sociodémographique régional.
L’arabe est enseignée à tous les enfants dont elle n’est pas la longue maternelle comme longue de communication et comme longue d’enseignement.
Les modalités d’application de cet article seront fixées par voie réglementaire, dons le cadre d’une politique linguistique nationale ».
Nul besoin d’être juriste pour comprendre les objectifs de cette disposition et les réserves qu’elle a pu susciter chez nombre de députés. Ces dernières ont été tues. Elles le seront encore sous la nouvelle législature.
Par ailleurs, si aux termes de l’article 61 de la Constitution, « L’initiative des lois appartient concurremment au Gouvernement et aux membres du Parlement », le premier soumettant des projets de loi, le second des propositions de loi, seules les dernières se heurtent à des obstacles juridiques et politiques quasi-insurmontables. La Constitution mauritanienne confère pour ainsi dire « le pouvoir normatif de droit commun » au Gouvernement. Il suffit pour s’en convaincre de rappeler que le Gouvernement qui a la mainmise sur l’ordre du jour conformément à l’article 69 de la Constitution peut également soulever les exceptions d’irrecevabilité financière et législative prévues à l’article 62 de la Constitution pour s’opposer à tout amendement parlementaire.
Toutefois, il est fort probable que le Gouvernement ait besoin de recours à ces instruments constitutionnels. Face à cet exécutif soutenu par sa majorité pléthorique, les oppositions seront condamnées à faire de la figuration.
2. Une opposition réduite à la figuration
Il est acquis que la compétition ultime n’oppose désormais plus l’exécutif au législatif comme pourrait le laisser penser la théorie de la séparation des pouvoirs mais la majorité parlementaire à l’opposition parlementaire. Dans le cas mauritanien, il faut dire que le résultat de l’élection des 13 et 27 mai condamne les oppositions à faire de la figuration.
Aux termes de l’article 23, alinéa 1 du Règlement de l’Assemblée nationale « Tout groupe d’au moins sept (7) députés partageant des opinions politiques similaires peut constituer un groupe parlementaire ». L’alinéa second de ce dernier prévoit que « Les députés n’appartenant à aucun groupe parlementaire siègent à titre de non-inscrits ». Il va sans dire que seuls, les parti Tawassoul (10 députés) et FRUD (7 députés) sont à même de constituer à eux seuls des groupes parlementaires.
La possession d’un groupe parlementaire n’est pas sans conséquences dans la mesure où ces derniers sont les relais des partis politiques. Elle permet aux oppositions d’exister dans l’hémicycle étant donné que les temps de parole sont établis par groupe. Par exemple, seuls les présidents de groupe sont consultés conformément à l’article 35 du Règlement de l’Assemblée nationale dans le cadre de la constitution des commissions permanentes. Il en va de même dans le cadre de la participation des conférence des présidents conformément à l’article 51 du Règlement de l’Assemblée nationale.
Ainsi, pour avoir voix au chapitre, il convient d’appartenir à un groupe parlementaire ce qui limite fortement les occasions pour les parlementaires non-inscrits d’exister. Ces derniers sont condamnés au rôle de figurant dans pour ne pas dire à être des « députés-fantômes ». Il ne serait dès lors pas absurde pour les oppositions de s’entendre afin de créer des groupes parlementaires de circonstances.
En définitive, on peine à imaginer que les parlementaires puissent véritablement exister dans une telle configuration où la majorité présidentielle pléthorique sera un soutien inconditionnel de l’Exécutif, dévoué à celui-ci et où les oppositions émiettées ne pourront exister. Les premiers seront invisibilisés dans la masse. Les seconds dépourvus des moyens d’action. Leur moyen d’exister consistera à être en lien constant avec leur circonscription.
Pour ce qui est du président de la République, la composition nouvelle de l’Assemblée nationale sied parfaitement à son tempérament taciturne.
Hamedi Sebo CAMARA
Les opinions exprimées dans cette rubrique n’engagent que leurs auteurs. Elles ne reflètent en aucune manière la position de www.kassataya.com
Diffusion partielle ou totale interdite sans la mention : Source www.kassataya.com