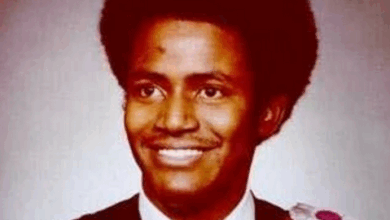– Les avocats de la victime se sont dits « satisfaits » du verdict et la société marocaine s’est sentie entendue. Vendredi 14 avril, la cour d’appel de Rabat a fortement alourdi les peines des trois hommes accusés d’avoir violé à répétition la jeune Sanaa, 11 ans, dans un village près de Tiflet, et aujourd’hui mère d’un enfant né de ces violences. L’un des accusés a été condamné à vingt ans de prison ferme, les deux autres à dix ans. En première instance, le 20 mars, ils avaient écopé de deux ans de prison.
Au Maroc, ce verdict avait soulevé un tollé, entraînant dans son sillage une intense vague d’indignation. Citoyens, militants, intellectuels s’étaient tour à tour mobilisés contre une sentence jugée outrageusement clémente, contre le laxisme dont tendent à bénéficier les agresseurs dans les affaires de violences sexuelles contre les mineurs et les femmes. Et pour exiger un changement des lois de ce pays.
Car l’histoire tragique de Sanaa, loin d’être isolée, fait écho à bien d’autres affaires. Certaines ont secoué la société marocaine, comme celle de Khadija Souidi, une adolescente de 17 ans qui s’était suicidée en 2016 après la remise en liberté de ses violeurs. Ou encore celle d’Amina Filali, 15 ans, qui avait mis fin à ses jours en 2012 après avoir été forcée d’épouser son violeur. Mais beaucoup de cas similaires passent sous les radars.
Or, « si on regarde les décisions rendues par les tribunaux, on se rend compte qu’il y a chaque jour des dizaines de Sanaa à qui justice n’est pas rendue et autant d’agresseurs qui échappent à la loi », souligne l’avocate Laila Slassi, cofondatrice de « Masaktach » (« je ne me tais pas »), un collectif qui dénonce les violences contre les femmes et la « légitimation de la culture du viol » au Maroc.
En 2020, le collectif avait réalisé une étude sur le traitement judiciaire des affaires de violences sexuelles. Il en ressortait, sur la base de 1 169 procès, que 80 % des prévenus condamnés pour viol avaient écopé de peines inférieures à celles prévues par la loi, soit la réclusion de cinq à dix ans, de dix à vingt ans lorsque la victime est mineure (jusqu’à trente ans en cas de « défloration »). « La durée moyenne des peines pour viol, y compris dans les affaires de pédocriminalité, ne dépasse pas trois ans et un mois, poursuit Laila Slassi. La légèreté des peines est systématique. »
Recours aux circonstances atténuantes
L’affaire de Sanaa cristallise « toutes les aberrations du système judiciaire en matière de violence sexuelle », analyse Amina Bouayach, présidente du Conseil national des droits de l’homme (CNDH). A commencer par les chefs d’accusation retenus : le « détournement de mineur » et « l’attentat à la pudeur », plutôt que le « viol ».
En outre, les juges, en première instance, ont accordé des circonstances atténuantes aux accusés, en les justifiant par leurs « conditions sociales », l’« absence d’antécédents judiciaires » et le fait que « la peine prévue légalement est sévère au regard des faits incriminés ». Une « erreur judiciaire », dénonce Mme Bouayach, alors que « les faits décrivent des viols collectifs organisés et répétés avec usage de la violence sur une enfant de 11 ans. Il s’agit d’un viol aggravé ».
Ce recours aux circonstances atténuantes, laissé à l’entière appréciation des juges, « est utilisé de façon assez systématique dans les affaires de violences sexuelles pour promouvoir l’impunité des violeurs », rapporte Stephanie Willman Bordat, avocate et cofondatrice de Mobilising for Rights Associates (MRA), une ONG basée à Rabat. « Cela donne toute latitude aux juges pour laisser libre cours à leurs stéréotypes sexistes et trouver des excuses aux coupables », précise-t-elle.
Source :
Diffusion partielle ou totale interdite sans la mention : Source www.kassataya.com