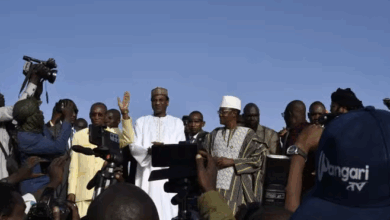Lefaso.net – Le Burkina Faso est en guerre contre les groupes terroristes qui revendiquent son territoire et chassent sa population dans différentes provinces du pays. Alors que les forces de défense et de sécurité sont à l ’offensive pour la reconquête du territoire avec l’acquisition de moyens aériens, ces derniers temps, certains ont créé un nouveau front qui fait des journalistes et des médias, les nouveaux ennemis à abattre.
Les menaces anonymes sont récurrentes et l’instance de régulation des médias observe « Le Conseil supérieur de la communication constate avec regret la récurrence de menaces proférées à l’endroit d’organes de presse et d’acteurs des médias dans l’exercice de leur profession » Pourquoi au lieu de travailler à l’unisson, certains s’en prennent-ils aux médias ? Que reproche-t-on aux médias ? De ne pas s’adapter au temps de guerre et de travailler comme si le pays était en paix ? De ne pas aimer le pays, vraiment ?
Que peut l’information ? Fait-elle gagner la guerre ou la perdre ? Qui sont les vrais ennemis ? Il y a une anecdote que l’on raconte sur la deuxième guerre mondiale entre le président russe Joseph Staline et un ministre français des affaires étrangères. Ce dernier aurait proposé d’adjoindre le Vatican aux pays alliés contre l’Allemagne nazi. Et Staline aurait répondu, le Vatican combien de divisions ? Le Vatican est une puissance morale, mais n’a pas d’armée. Pour le locataire du Kremlin de l’époque, la victoire se gagnera par les armes militaires et non les armes spirituelles. La presse est une arme spirituelle peu déterminante si on revient en 2023 et à notre pays.
Le journaliste est le producteur apparent de l’information
Au Burkina Faso avec cette guerre, tous les médias et les journalistes sont clean. D’abord, notre presse n’a pas les moyens de s’offrir des correspondants de guerre, indépendants qui vont sur le terrain, observer, analyser et rapporter ce qu’ils ont vu de la guerre. Tout ce que nous disons de la guerre, tous les faits proviennent des communiqués de l’état-major. L’autorité, l’Etat et les gouvernants sont les principaux acteurs de la production de l’information en temps de guerre. Si l’état-major cesse de produire ses bulletins d’information sur les batailles, comme ces derniers temps, vous n’avez rien dans les médias. Nous ne faisons que nous en tenir à ces faits communiqués avec parfois des articles d’analyse et de commentaire.
Il y a de nouveaux acteurs de la production d’informations que sont les organisations de la société civile dans les zones à hauts défis sécuritaires ainsi que les regroupements des ressortissants des localités attaquées par les groupes terroristes qui saisissent de plus en plus la presse pour informer la communauté nationale de ce qui se passe dans les zones attaquées. Le fait de rendre compte de ses tristes réalités est- elle opposable aux médias et aux journalistes ? Personne ne peut accuser les médias burkinabè de faire l’apologie des groupes terroristes aujourd’hui ou qu’ils leur transmettent des informations.
Dans les deux cas, la justice peut être saisie. L’observateur avisé sait que les journalistes burkinabè aujourd’hui plus qu’hier font de l’autocensure. Ils écartent leurs préjugés personnels en se régulant. C’est leur sens des responsabilités qui les obligent à analyser, peser, voir si ce qu’ils vont dire est positif, exact, nécessaire, sage, enrichissant, avant de le faire. En temps de paix ou de guerre, la production de l’information ne change pas. Ce sont les mêmes contraintes de sélection des menus en conférences de rédaction, de discussion et d’échanges entre journalistes sur la nécessité ou pas de traiter le sujet, de vérification des faits, de prendre des points de vue contraires, d’écouter toutes les parties, etc. Certains commentateurs professent le contraire, mais n’arrivent pas à nous dire ce qui doit changer.
Le métier de journaliste ne change pas, parce que nous sommes en guerre tout comme celui de l’ouvrier sur les chaînes de Sosuco ou de Citec. C’est un travail intellectuel collectif qui est dans une chaîne de production allant des directeurs, de journaux, des rédactions, de desk, au journaliste. Le journaliste est à un poste défini, et il accomplit ce que le poste de travail demande.
Sana Guy
Lefaso.net
Source : Lefaso.net (Burkina)
Diffusion partielle ou totale interdite sans la mention : Source www.kassataya.com