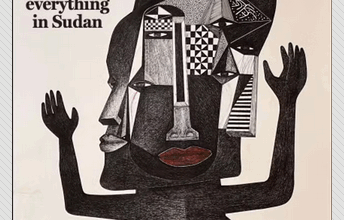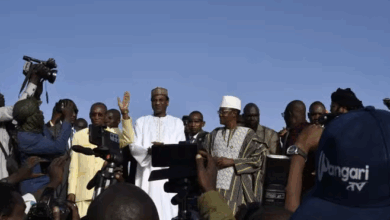Afriquexxi.info – Durant deux ans, le journaliste Michael Pauron (coanimateur de la rédaction d’Afrique XXI) a enquêté sur le comportement des diplomates français en Afrique. Dans un chapitre de son livre Les Ambassades de la Françafrique, il rappelle que les bâtiments aussi jouent un rôle dans la stratégie postcoloniale de la France.
Membre du comité éditorial et coanimateur de la rédaction d’Afrique XXI, le journaliste Michael Pauron a publié le 22 septembre 2022 chez Lux une enquête sur les diplomates français en Afrique : Les Ambassades de la Françafrique. L’Héritage colonial de la diplomatie française. Afrique XXI publie ci-dessous un extrait tiré du chapitre 5, intitulé « Au palais des colonies » et consacré à un aspect méconnu de la diplomatie française dans ses anciennes possessions : la place de l’architecture.
Des bâtiments « à la hauteur de l’art européen »
« Les ambassades de France dans les anciennes colonies, en plus d’occuper des places de choix dans la géographie urbaine, demeurent parmi les plus beaux bâtiments du continent. « Le parc de la résidence de France est à l’heure actuelle la plus belle oasis de verdure de Libreville », écrivait encore dans les années 1980 l’ambassadeur au Gabon, Maurice Delauney1. Il en était fier : c’est lui qui avait fait ériger, au lendemain de l’indépendance gabonaise, cette luxueuse chancellerie posée sur un parc de cinq hectares en bord de mer avec, bien sûr, sa piscine et son court de tennis, son sport favori. Pour Jacques Cabanieu, ancien sous-directeur du service constructeur des Affaires étrangères, « l’architecture est un ambassadeur de la France »2.
Lors d’une intervention devant la Society of Arts en 1873, l’architecte anglais Thomas Roger Smith décrivait une administration coloniale européenne qui « fait preuve de justice, d’ordre, de droit et d’honneur » et, à ce titre, défendait l’idée que « nos bâtiments doivent être à la hauteur de l’art européen. Ils doivent être européens, à la fois comme un point de ralliement pour nous-mêmes et comme un signe distinctif de l’Europe et de notre présence, qui doit être considérée avec respect et même admiration par les Indigènes du pays »3. L’architecte français Joseph Marrast jugeait quant à lui qu’il fallait incorporer dans la conception des bâtiments certains éléments de l’esthétique locale, non pas pour préserver la culture des peuples colonisés ou échanger avec eux, mais bien pour faciliter l’acceptation du colon, « apaiser la résistance locale », conquérir « le cœur des Indigènes » et gagner « leur affection, comme il est de notre devoir de colonisateur ». De grands architectes nationaux, comme Le Corbusier, ont participé à cette entreprise de domination culturelle.
« Cette question du prestige français transparaît clairement dans de nombreux discours, émanant aussi bien des analystes que des acteurs eux-mêmes », explique Marie-Alice Lincoln, autrice d’un mémoire sur le sujet4. Ainsi, pour l’ancien ambassadeur Yvon Roé d’Albert, le patrimoine diplomatique est délibérément associé au fait qu’il « contribue à l’affirmation de notre présence » et « à la défense de notre culture »5. Les architectes eux-mêmes relaient ce discours sur le caractère « français » des édifices, comme Pierre Dufau, architecte français au Cambodge : « Si nous faisons un centre culturel à Phnom Penh, c’est pour permettre la diffusion de la culture française et l’architecture fait partie de cette culture. Si le bâtiment est d’une médiocrité excessive, cela deviendra de la contre-propagande.6 » Mais quel est le prix d’une telle politique ?
Baisse des budgets et sponsoring
À Dakar, Abidjan, Yaoundé ou encore Libreville, les résidences luxueuses des ambassadeurs français entretiennent chèrement l’image surannée de cet « empire qui ne veut pas mourir »7. Des « trésors » coûteux érigés dans des pays où les revenus par habitant sont parmi les plus faibles du monde […].
Mais si l’on souhaite connaître avec précision les dépenses de fonctionnement des représentations françaises en Afrique, il faut se lever tôt : aucune donnée n’est disponible poste par poste. On doit donc se contenter de chiffres globaux – les dépenses à Washington n’ont pourtant rien à voir avec celles de Libreville. Même chose pour la valeur du patrimoine français à l’étranger.
Selon le dernier rapport de la Commission des finances de l’Assemblée nationale sur l’action extérieure de l’État, celle-ci est aujourd’hui estimée à 4,17 milliards d’euros pour l’ensemble du parc à l’étranger. En 2022, le total des dépenses de fonctionnement et d’investissement atteint 410,3 millions d’euros, soit une hausse de 10,2 millions (+ 2,6 %) par rapport à 2021 (environ 14 % du budget global du ministère des Affaires étrangères, qui s’élève à 2,9 milliards d’euros). Sur ce montant, 77 millions d’euros sont consacrés à « la remise à niveau » de ce patrimoine (en plus des 9,2 millions d’euros dépensés pour l’entretien « courant »). Pour le rapporteur, ces dépenses contribuent « à façonner l’image de la France à l’étranger »8.
Côté représentation, « le budget a considérablement été réduit ces dernières années », explique l’intendant d’une ambassade en Afrique. « Le nombre d’invités n’a, lui, pas diminué », ajoute-t-il. Afin de combler cette baisse de moyens, le sponsoring est devenu monnaie courante. Il n’est pas rare de voir des stands de marques, avec hôtesses, au sein des réceptions.
Ces chiffres ne nous éclairent pas vraiment sur le coût d’une représentation française en Afrique. Une source diplomatique requérant l’anonymat a cependant accepté de lever un coin du voile pour l’ambassade de France en Côte d’Ivoire. Abidjan est l’une des chancelleries les plus vastes du réseau français dans ses anciennes colonies d’Afrique subsaharienne. […]
Quelque 150 personnes, dont la moitié sont des agents de droit local, font tourner la boutique. Selon notre source, le budget de l’année 2020 s’élevait à 1,5 million d’euros. Avec les ressources liées à la coopération militaire et l’aide au développement, le budget de la France en Côte d’Ivoire s’élève à près de 3,7 millions d’euros par an. En raison de l’épidémie de Covid-19, des économies réalisées sur les frais de représentation ont permis de réaliser des travaux à hauteur de 250 000 euros.
Un tunnel avec la résidence présidentielle
Une partie du personnel diplomatique est logée au sein d’une résidence fermée et sous bonne garde, Les Palmes, située sur le boulevard François-Mitterrand, face à l’École de gendarmerie et l’École nationale de police. Accolé à son parc, on trouve aussi le siège de l’Agence française du développement, le bras financier de la coopération française. La résidence de France se trouve à trois kilomètres de là, plus au sud, nichée dans un gigantesque parc au bord de la lagune Ébrié. Le locataire des lieux, Jean-Christophe Belliard, m’ouvre ses portes. Une démarche assez exceptionnelle, faut-il le préciser.
La villa, située dans un quartier où sont installées d’autres emprises diplomatiques (dont celle de l’Iran et de la Suisse), n’est pas visible de la route, cachée par de hauts murs blancs équipés de caméras. Le voisin immédiat n’est autre que l’ancienne résidence présidentielle ivoirienne, en partie détruite par des bombardements français lors de la crise postélectorale de 2010-2011. L’ancien président, Laurent Gbagbo, avait trouvé refuge dans son bunker, d’où il a été délogé avec l’aide des troupes françaises. Un tunnel, imaginé par Félix Houphouët-Boigny, relie les deux villas : aujourd’hui bouché, Henri Konan Bédié l’avait emprunté lors du putsch de 1999 pour se réfugier à la résidence de France.
Après avoir passé deux sas de sécurité, il faut traverser le parc qui accueille d’autres résidences, dont celle de l’attaché de défense, qui possède sa propre piscine. L’ensemble boisé est si vaste qu’il est difficile d’en apercevoir le bout, comme c’est souvent le cas des résidences françaises en Afrique. En haut d’un grand escalier, l’ambassadeur patiente, un garde français à ses côtés. Pour le rejoindre, il faut passer sous un bâtiment en béton et en forme de U construit sur pilotis. Il crée un périmètre supplémentaire de sécurité : là sont logés les militaires français chargés de la sécurité des lieux. L’un d’eux est en plein footing.
L’ambassadeur ne cache pas le caractère un peu suranné de son logement, dont la plaque inauguratrice dorée à l’entrée indique « 1963 ». À gauche de l’entrée s’étire une longue salle de réception. En face, après être passé sous deux immenses défenses d’éléphant fixées sur leurs socles et formant presque une arche – « ça ne fait pas très bon genre de nos jours », ironise le diplomate – s’ouvre un grand salon. Au fond, une large baie vitrée donne accès à une vaste terrasse en surplomb du parc, avec vue sur la lagune. Au loin, le ponton d’où s’est échappé l’ex-président Henri Konan Bédié. L’ambassadeur partage son envie de « changer les canapés ». Ils ont perdu leur couleur d’origine, aujourd’hui difficile à déterminer. Au mur, des tableaux retirés ont laissé des marques. « Notre logement personnel se trouve à l’étage, précise-t-il. En bas, il y a les cuisines, la réserve… » Et le fameux tunnel. […]
Une « oasis de verdure » en chantier
À Abidjan, Paris n’a pas lésiné sur les mètres carrés de ses bâtiments ni sur les hectares de ses parcs pour maintenir visuellement sa présence. Or, comme nous l’avons déjà montré, cet héritage a un coût que l’État a de plus en plus de mal à assumer. Après une période faste dans les années 1960-1980, les projets de construction d’ambassades françaises en Afrique se sont raréfiés. Depuis une dizaine d’années cependant, le vieillissement des bâtiments, les nouvelles contraintes sécuritaires et la nécessité de faire des économies en regroupant les services dans des « campus diplomatiques » ont conduit le Quai d’Orsay à lancer de nouveaux chantiers. Une manne pour les architectes français – et les entreprises tricolores.
Journaliste passé par l’hebdomadaire Jeune Afrique,, il a collaboré à divers journaux, dont Mediapart
Source : Afriquexxi.info (Le 29 décembre 2022)
Diffusion partielle ou totale interdite sans la mention : Source www.kassataya.com