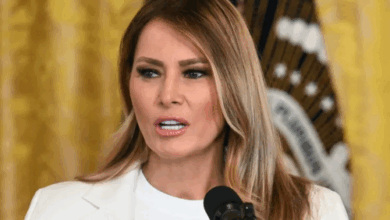Le Monde – « Les rêves comptent ! A toute personne dans le monde : n’arrêtez jamais de rêver. » C’est le message que Majda John Peter, mannequin sud-soudanaise de 17 ans, a écrit sur Instagram après avoir remporté la 39e édition du concours Elite Model Look of the Year, dont la finale s’est déroulée le 31 août à Prague.
Première Sud-Soudanaise à gagner la très prestigieuse compétition, la native de Bentiu, une région du nord du Soudan du Sud ravagée par la guerre civile, fait ainsi une entrée fulgurante dans le milieu de la mode avec, dans la foulée de sa victoire, des premiers défilés à la fashion week de Paris, fin septembre, et une première couverture de magazine, celle du Vogue Czechoslovakia.
Son succès vient confirmer une tendance : l’attrait exercé ces dernières années par la beauté des mannequins sud-soudanaises, au sein d’une industrie longtemps dominée par des critères esthétiques européens. Peau noire et lisse, silhouette effilée, cheveux afro tressés révélant l’élégance de sa nuque et de son port de tête : la beauté de Majda John Peter est celle de beaucoup de femmes du Soudan du Sud.
Alek Wek, top model anglaise originaire de Wau, au Soudan du Sud, avait su la faire éclater au grand jour au milieu des années 1990. « Célèbre mannequin, elle était noire comme la nuit, elle était sur tous les podiums et dans tous les magazines et tout le monde parlait de sa beauté », confiait l’actrice kényane Lupita Nyong’o en 2014, pour dire combien ce succès l’avait aidée, adolescente, à sortir de la « haine de soi ».
« Futures stars »
Depuis, le type de beauté qu’incarnent les Sud-Soudanaises est devenu très prisé des créateurs de mode et des marques de vêtements. Le nombre de mannequins sud-soudanaises ou d’origine sud-soudanaise a explosé. Sur les cinquante modèles répertoriés comme « futures stars » par le site Models.com, six sont d’origine sud-soudanaise. Simple tendance passagère ou bien changement profond au sein d’une industrie critiquée pour son manque de diversité ?
En 2020, la créatrice Stella McCartney affirmait voir en la mannequin Achenrin Madit « le visage du futur de la mode », discernant à travers elle « une génération montante qui prône l’inclusivité, la diversité et la durabilité dans la mode. Ce ne sont pas des tendances, mais des moyens significatifs de réparer une industrie en panne, nous reconnectant les uns aux autres et à la Terre mère ».
Duckie Thot, Anok Yai, Ajok Madel, Akon Changkou… Autant de stars dont l’image peuple les magazines, campagnes publicitaires et réseaux sociaux depuis quelques années. Sans oublier la « bombe » Adut Akech, 22 ans, consacrée « Model of the Year » en 2018 et 2019 par le British Council of Fashion. Celle qui a passé ses premières années dans le camp de réfugiés de Kakuma, au Kenya, avant de partir pour l’Australie collectionne les couvertures de prestigieux magazines de mode. Il y a un an, elle faisait l’acquisition d’une villa à Los Angeles pour 2,8 millions de dollars.
« Il faut mesurer 1,80 mètre et avoir la peau très foncée »
Mais ces images de gloire et de luxe masquent les réalités parfois douloureuses d’un milieu pouvant se révéler cruel. « On est très seule quand on est au sommet », dénonçait en larmes la mannequin Ajak Deng en mai 2019, accusant son agence de la maltraiter psychologiquement et évoquant même son envie de se suicider. Une industrie où, malgré une ouverture affichée à la diversité, les stéréotypes persistent.
« Il faut mesurer 1,80 mètre et avoir la peau très foncée », dénonce Asara Bullen Panchol, Miss Earth South Sudan 2019, rencontrée dans ses bureaux de Juba. Or toutes les Sud-Soudanaises ne rentrent pas dans ces clous. La dernière gagnante du concours Miss Earth South Sudan, Melang Kuol, originaire de la région d’Abyei (nord), a la peau plus claire que la majorité des mannequins connues du pays. Alors qu’elle s’apprête à partir aux Philippines pour la grande finale mondiale du concours, en novembre, « des internautes l’ont accusée de se blanchir la peau ! », se désole Asara Bullen Panchol.
La couverture de Vogue UK de février illustre parfaitement l’ambiguïté du moment. En publiant une image rassemblant neuf mannequins africaines (cinq d’entre elles sont sud-soudanaises), il s’agissait pour le magazine de « célébrer la montée en puissance du mannequin africain – une révolution permanente ».
Sauf que les moyens visuels employés ont eu pour une partie du public l’effet inverse : « Il semble que les tons de peau des modèles aient été modifiés pour paraître plus sombres, entre autres libertés artistiques controversées qui ont été prises », notait ainsi le magazine culturel Complex. Le comédien sud-soudanais Akau Jambo déclarait sur Twitter : « Je suis sud-soudanais. (…) Je peux vous assurer qu’il n’y a personne qui ressemble à ça ici. En tant qu’artiste, je peux aussi vous assurer que ce n’est pas de l’art. C’est du porno de peau noire. Du fétiche noir. Du blanchiment inversé. »
« Il y a plein d’histoires qui circulent »
Ancienne mannequin et directrice de la South Sudan Fashion Week, fondée en 2013 mais interrompue jusqu’en 2019 par la guerre civile, Trisha Nyachak s’est donné pour ambition de développer l’industrie de la mode au Soudan du Sud. Car si les défilés organisés à Juba ont permis à des mannequins de commencer leur carrière, la faiblesse de l’industrie locale les pousse à partir à l’étranger, parfois à leurs risques et périls.
« On les forme et on les coache, puis elles disparaissent et réapparaissent tout à coup à Londres ou à Paris ! », lâche Trisha Nyachak, un brin agacée. « Il faut que nous établissions un cadre légal pour réguler les choses. Nous voulons pouvoir les protéger », explique-t-elle, « et savoir si elles gagnent bien leur vie ». Une activité potentiellement très lucrative pour les agents, puisque, selon elle, « le niveau d’intérêt est massif. Tous les regards sont tournés vers le Soudan du Sud. Tout le monde veut venir ici ».
Source : Le Monde
Diffusion partielle ou totale interdite sans la mention : Source www.kassataya.com