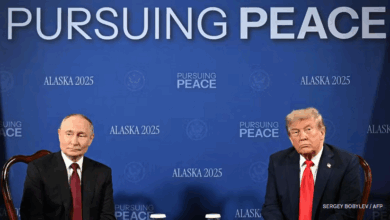Le Devoir – À trois semaines du 18e sommet de l’Organisation internationale de la Francophonie (OIF), qui se tiendra les 19 et 20 novembre à Tunis, des voix divergentes s’expriment sur l’action de cette organisation destinée à promouvoir le français dans le monde. Plusieurs acteurs de terrain, en Afrique notamment, s’inquiètent de la diminution de l’action de l’OIF en éducation — qui devrait être le coeur de sa mission — depuis que l’ancienne ministre des Affaires étrangères du Rwanda Louise Mushikiwabo en a pris la direction en 2018.
« Depuis que Mme Mushikiwabo la dirige, l’OIF est devenue invisible sur le terrain. L’éducation ne semble plus une priorité et l’Organisation ne remplit plus sa fonction », nous confie Fridolin Mve Messa, secrétaire général du principal syndicat d’enseignants du Gabon. Joint à Libreville, le syndicaliste estime plus généralement que l’OIF « ne s’implique plus dans la défense de la langue française. Si l’éducation n’est plus une priorité, qu’on nous le dise » !
La frustration qu’exprime Fridolin Mve Messa n’est pas isolée. Elle s’exprime tout particulièrement au sein du Comité syndical francophone et de la formation (CSFEF), qui regroupe les syndicats d’enseignants des pays francophones. La semaine dernière, comme elle le fait depuis 35 ans à chaque sommet, l’organisation s’est réunie en Tunisie, où se tiendra bientôt le Sommet de la Francophonie. Quelle ne fut pas la surprise des organisateurs de découvrir que, contrairement à ce qui se pratiquait auparavant, aucun représentant de l’OIF ne serait présent. Branche francophone de l’Internationale de l’éducation, la CSFEF a été créée en 1987 à l’initiative de syndicats français, québécois et sénégalais. À titre d’organisation internationale non gouvernementale, elle est accréditée à l’OIF.
« Déliquescence » ?
« Lors de nos congrès précédents, nous avons toujours obtenu un financement pour tenir nos activités, nous avons toujours eu un représentant de l’OIF à la cérémonie d’ouverture. Cette année, rien de tout cela. L’OIF nous répond que la ligne budgétaire pour les organisations de la société civile a été supprimée », dit le secrétaire général du CSFEF, le Québécois Luc Allaire.
Pour celui qui est aussi responsable des relations internationales de la Centrale des syndicats du Québec (CSQ), ce retrait de l’OIF n’est qu’une manifestation de « [son] état de déliquescence » actuel. Selon lui, jamais l’OIF n’a été aussi peu présente dans la défense du français dans le monde depuis qu’elle est dirigée par la Rwandaise Louise Mushikiwabo.
En 2018, le mandat de l’ancienne gouverneure générale du Canada Michaëlle Jean n’avait pas été renouvelé après que la presse québécoise eut révélé des dépenses somptuaires de l’ordre de 500 000 dollars pour son appartement parisien. Soucieux de réconcilier la France avec le Rwanda, le président français, Emmanuel Macron, avait alors soutenu la candidature de l’ancienne ministre des Affaires étrangères de ce pays. Une nomination qui a ensuite ouvert la voie à une réconciliation entre les deux nations et à une visite officielle du président au Rwanda.
« L’OIF a-t-elle cessé de promouvoir la langue française ? » demande Augustin Tumba Nzuji, qui dirige la Fédération nationale des enseignants et éducateurs sociaux (FENECO/UNTC) de la République démocratique du Congo (RDC). « Depuis que Mme Mushikiwabo est en place, l’action de la Francophonie n’a cessé de régresser, dit-il. Pourtant, on ne cesse de nous répéter que l’éducation est censée être la priorité de l’OIF et que l’avenir de la langue française est en Afrique. »
La RDC compte 400 dialectes et quatre langues nationales, mais le français y demeure la seule langue parlée dans tout le pays. Les réductions budgétaires, dit Augustin Tumba Nzuji, ne pourront manquer d’avoir un effet sur l’action de l’Organisation en direction de l’Afrique, où se trouvent aujourd’hui l’immense majorité des locuteurs francophones.
Avenue Bosquet à Paris, au siège de l’OIF, on se défend de tout relâchement de l’action de la Francophonie dans le domaine de l’éducation. Si les subventions du CSFEF ont été supprimées, c’est parce que « la programmation de l’OIF a été recentrée sur de grands enjeux, recherchant l’impact sur les populations et l’attractivité pour les bailleurs de fonds », dit Oria Kije Vande Weghe, directrice des communications de l’OIF. L’Organisation ne finance plus que 25 projets phares, dont plusieurs en éducation, comme les Centres régionaux pour l’enseignement (CRE), couvrant une vingtaine de pays sur trois continents, et l’Initiative francophone pour la formation des maîtres (IFADEM), présente dans 15 pays d’Afrique.
La tentation du Commonwealth
À Ottawa, la responsable de la Direction de la Francophonie, Chrystiane Roy, a refusé de nous parler. Mais Le Devoir a appris qu’Ottawa est bien au fait de ce malaise. Certains fonctionnaires se demandent notamment si la réduction des budgets de l’OIF n’est pas allée trop loin. On s’inquiète aussi de la propension de la secrétaire générale à écarter les organisations de la société civile. Ce que nie formellement Oria Kije Vande Weghe. En 2022, 130 organisations non gouvernementales nationales et internationales ont été accréditées auprès de la Francophonie.
Cet « effacement » de l’OIF ne concernerait pas que l’éducation. En février dernier, il avait fallu un mois, et les pressions du Canada et du Québec, pour que l’OIF prenne position sur la guerre en Ukraine, un pays qui est pourtant membre observateur de l’Organisation depuis 2006. Sur les grandes questions des droits de la personne, l’ancien directeur des communications de l’Organisation Bertin Leblanc déplorait en mai dernier, sur les ondes de Radio France internationale, que l’OIF soit devenue très « discrète ».
Christian Rioux
à Paris Correspondant
Source : Le Devoir (Québec)
Diffusion partielle ou totale interdite sans la mention : Source www.kassataya.com