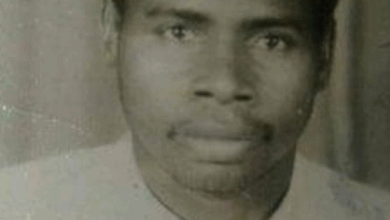France Culture – La racialisation se construit en mélangeant des dynamiques politiques, économiques, sociales… Que pouvons-nous dire du mot “race” ? Faut-il et comment en parler ? Que faisons-nous lorsque nous parlons de la race ? Et comment en parler sans être raciste ?
- Magali Bessone professeure de philosophie politique à l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne
- Nadia Yala Kisukidi maîtresse de conférences en philosophie à l’Université Paris 8
La race : construction politique et sociale
« Une des caractéristiques de la construction de la race, c’est à dire de la racialisation, soit ces ensemble de processus politiques, économiques, administratifs, de pratiques et de discours, est qu’ils ont construits des groupes sociaux comme des groupes raciaux, c’est-à-dire à les construire comme des groupes que l’on va pouvoir repérer dans l’espace social, comme s’ils se donnaient à voir alors que cette visibilité n’est pas donnée mais produite. La vision est construite pour servir un projet politique. » explique Magali Bessone.
« Une des premières grandes caractéristiques que Maurice Olender donne de l’idée que la race se construit sur une tension entre visible et invisible. A une caractéristique visible va correspondre une donnée invisible. Au début de Race sans histoire, il parle de l’âme raciale c’est-à-dire qu’à chaque corps va être attribué un ensemble d’aptitudes, de faculté cognitives qui vont composés une identité raciale. Au physique on accole toujours une dimension métaphysique donc nécessaire sans histoire. Cette tension entre visible et invisible est une construction politique qui va permettre de juger un ensemble de groupes sur critères raciaux et de justifier, dans le cas du racisme, une distribution inégalitaire des droits dans le monde politique et social » analyse Nadia Yala Kisukidi.
Nécessité de déshistoriciser
« En historicisant, on désessentialise et on lutte contre le racisme » souligne Magali Bessone. « Comment penser la race sans racisme ? » interroge Magali Bessone. « Il faut rehistoriciser les projets politiques et économiques qui ont produit ces groupes pour opérer une désessentialisation. On lutte ainsi contre le racisme et on permet d’éviter cette espèce de naturalisation race/couleur. La race ce n’est pas la couleur, ce n’est pas une chose qui serait visible dans les corps« .
La négritude n’est pas un simple retournement de stigmate mais l’ouverture d’un imaginaire. « Nègre j’étais, nègre je resterais » est une phrase d’Aimé Césaire que cite Nadia Yala Kisukidi. « Le mot nègre dans la négritude devient une propriété de l’imagination politique. Le mot négritude est un mot que l’on peut penser de façon objective chez Léopold Sédar Senghor et chez Aimé Césaire une négritude subjective pour penser à partir de l’ensemble des conditions politiques qui on fait de ce sujet de race qu’est le noir. Il s’agit de recomposer une relation au monde plus qu’une identité ».
Source : France Culture
Diffusion partielle ou totale interdite sans la mention : Source www.kassataya.com