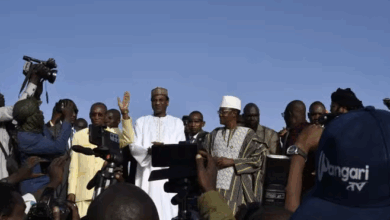Le Monde – Le coup d’Etat qui secoue le Burkina Faso depuis le 30 septembre est un nouveau coup de semonce pour Paris, un peu plus d’un mois après le départ du dernier soldat français du Mali.
Alors que le Burkina Faso était depuis plusieurs années la base des forces spéciales françaises au Sahel, le camp de Kamboinsin, partagé avec l’armée burkinabée, a été l’un des principaux lieux de rassemblement des manifestants. Même si le ministère des armées reste muet, à ce stade, sur le sort de cette implantation capitale pour sa lutte contre le terrorisme au Sahel, cette alerte rend plus urgente la redéfinition par la France de sa présence militaire en Afrique, dossier miné sur lequel progresse à tâtons l’Hôtel de Brienne.
A la veille du 14 juillet, Emmanuel Macron avait indiqué vouloir « repenser, d’ici à l’automne », l’ensemble des dispositifs militaires français en Afrique. Depuis, ce travail délicat a bel et bien démarré. Mais il progresse à pas lents, et ce n’est pas avant la fin de l’année, voire début 2023, à l’occasion des débats parlementaires sur la future loi de programmation militaire (LPM) 2024-2030, qu’il pourrait aboutir. « Le cahier des charges » a été élaboré cet été, assure au Monde le ministre des armées, Sébastien Lecornu, « l’éventail des propositions françaises » est progressivement présenté aux pays partenaires, ajoute-t-il.
Au ministère, on assume désormais une attitude plus contractuelle avec l’Afrique. A l’heure où la compétition entre puissances est considérée comme faisant partie du quotidien sur le continent, la France a elle aussi une « offre », défend-on. En juillet, M. Lecornu y a, à ce titre, réalisé une tournée. D’abord au Niger et en Côte d’Ivoire avec la ministre des affaires étrangères, Catherine Colonna, puis au Cameroun, au Bénin et en Guinée-Bissau, aux côtés du chef de l’Etat. En Algérie, enfin, du 25 au 27 août, là encore aux côtés d’Emmanuel Macron.
Nouveau traité de défense
Dernier de ces déplacements : Djibouti, le 15 septembre. Lors de cette visite en solo sur cette emprise stratégique – la plus grande base militaire française à l’étranger avec quelque 1 500 hommes – située dans le golfe d’Aden, non loin de l’accès à la mer Rouge, Sébastien Lecornu dit avoir fait plusieurs propositions aux autorités djiboutiennes. Un nouveau traité de défense – l’actuel date de 2011 – pourrait voir le jour début 2024 avec une révision de la clause de sécurité entre Paris et Djibouti, qui engage la France à fournir de l’assistance militaire en cas « d’agression armée ». Un projet de création d’« académie militaire interarmées » susciterait aussi l’intérêt du gouvernement djiboutien.
Un travail similaire a été amorcé avec la Côte d’Ivoire, où la France dispose, à Abidjan, du camp militaire de Port-Bouët, qui lui sert de réservoir de forces (environ 1 000 hommes) et de base logistique. Là encore, un projet « d’académie militaire » est à l’étude, selon le ministre. Il s’ajouterait à l’académie de « lutte contre le terrorisme », inaugurée en 2021 dans le pays.
Ces nouvelles académies auraient vocation à créer « l’interopérabilité de demain » entre militaires africains et français, aussi bien en termes relationnels qu’opérationnels. Les discussions avec Abidjan et Djibouti pourraient préfigurer une « nouvelle génération d’accords de défense », estime M. Lecornu, alors que la dernière vague d’accords entre Paris et plusieurs pays d’Afrique remonte au début des années 2010.
Tous ces projets sont censés s’inscrire dans une vaste refonte de la coopération militaire à la française. « Depuis la fin des années 1990, la France a fortement réduit ce champ d’action en Afrique. Elle s’est concentrée sur l’entraînement d’armées locales ou les interventions expéditionnaires. Deux approches considérées comme non satisfaisantes aujourd’hui. Soit car jugées inefficaces, soit parce que cela revient, malgré tout, à faire la guerre dans son coin », résume Elie Tenenbaum, directeur du centre des études de sécurité de l’Institut français des relations internationales.
« Soutien militaire à des opérations ponctuelles »
Aujourd’hui, l’ambition des armées est donc plutôt de développer de « l’appui » sélectif aux pays le souhaitant. « C’est-à-dire du soutien, soit en termes de renseignement, de logistique, d’exportation d’armement, ou encore de l’appui feu, c’est-à-dire du soutien militaire à des opérations ponctuelles, mais avec des pays dûment sélectionnés », explique M. Tenenbaum. « Une forme de retour à ce que la France pouvait faire dans les années 1970-1980 mais qui est aussi ce que proposent aujourd’hui la plupart des autres puissances militaires engagées sur le continent », précise le chercheur.
C’est dans des pays considérés comme « délaissés » ou « jamais investis », tels que le Cameroun, que le ministère des armées souhaiterait ainsi développer en premier lieu cette approche. A Yaoundé, le nombre de coopérants est passé de 80 à moins de sept ces dernières années, même si la France a repris, en 2021, une partie de la formation des forces spéciales du pays aux Israéliens, en dépit des accusations d’exactions pesant sur l’armée camerounaise.
« Il y a un besoin de France au Cameroun, actuellement nous sommes décevants », estime M. Lecornu alors que Paris redoute la phase de succession complexe de son allié Paul Biya, 89 ans, à la tête du pays depuis 1982. Signe de l’amorce de ce virage, c’est l’ancien général Thierry Marchand, qui dirigeait depuis 2019 la direction de la coopération de sécurité et de défense au Quai d’Orsay, qui vient d’arriver, le 3 octobre, comme nouvel ambassadeur au Cameroun.
Une réflexion particulière est aussi menée à Paris sur les pays du golfe de Guinée, jugés en voie de fragilisation en raison de l’expansion du djihadisme, de l’explosion du trafic de stupéfiants et de la surpêche qui menace la sécurité alimentaire. Nombre d’officiers français estiment qu’un des enjeux serait de réussir à y « structurer » la coopération en matière de renseignement. Selon M. Lecornu, Paris est effectivement en mesure d’offrir aux autorités africaines le souhaitant de l’image satellitaire ou de « l’analyse maison » à partir de données lui étant transmises.
« Réduire la vulnérabilité française »
Reste à savoir comment tous ces pays pourraient se laisser convaincre de souscrire aux propositions de Paris dans un contexte d’exacerbation du sentiment anti-français. Le Niger est, par exemple, le nouveau centre de gravité de l’opération « Barkhane » – qui poursuit son travail de lutte contre l’expansion du djihadisme au Sahel. Mais pour Niamey, le risque politique est important. « On fait du sur-mesure », dit M. Lecornu. Un travail aussi conduit au Tchad, où Paris a conservé une partie du commandement de « Barkhane ».
L’un des rares pays, avec le Niger, à assumer sa collaboration avec la France est le Bénin. Même si l’accélération de la percée djihadiste dans le nord du pays a conduit les autorités béninoises à entamer une collaboration sécuritaire avec le Rwanda tout en envisageant d’acquérir des drones turcs et chinois, Paris a proposé aider à la création d’« une direction du renseignement militaire » et d’une « direction générale de l’armement », selon le ministre des armées. Une façon indirecte de pousser la vente ou la cession de matériels en phase avec les intérêts français.
Face à la hantise d’être sans cesse rattrapée par son image d’ex-puissance coloniale, instrumentalisée notamment par la Russie, Paris s’efforce donc de rendre moins lisible sa stratégie africaine. Plus de grand plan annoncé, pas de feuille de route claire, dilution des échéances. « L’enjeu est de réduire la surface de vulnérabilité française en Afrique », reprend M. Tenenbaum. Une stratégie qui ressemble par certains égards à celle adoptée par les Etats-Unis depuis le début des années 2000, appelée Cooperative Security Locations. Pour autant, « si on voit l’intérêt politique de cette approche pour la France, on en voit aussi les limites », reprend M. Tenenbaum.
Source : Le Monde
Diffusion partielle ou totale interdite sans la mention : Source www.kassataya.com