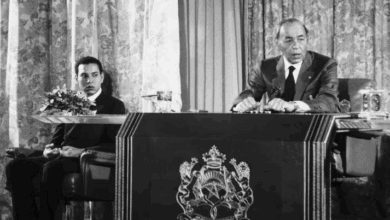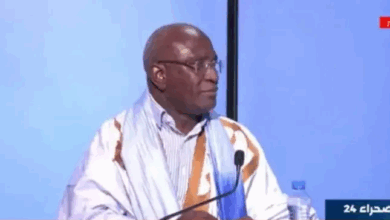– La préservation du Commonwealth sera l’une des principales œuvres de la reine Elizabeth II pendant son règne, rappelle l’historienne Virginie Roiron, spécialiste de civilisation britannique et du Commonwealth à l’Institut d’études politiques de Strasbourg, à l’occasion du décès de la souveraine le 8 septembre, à l’âge de 96 ans.
A la mort de son père le roi George VI, en 1952, Elizabeth Windsor était en voyage officiel au Kenya. C’est là qu’elle est devenue reine. Est-ce qu’elle a entretenu une relation particulière avec le continent africain pendant son règne ?
Quand Elizabeth II accède au pouvoir, l’empire est à un tournant. C’est sous son règne que les anciennes colonies britanniques africaines sont devenues indépendantes, alors que le processus était déjà enclenché en Asie. Le Royaume-Uni souhaitait garder des liens avec l’Afrique, faire en sorte que les pays nouvellement indépendants entrent et restent dans le Commonwealth.
Ce n’était pas gagné et je pense que la reine était consciente de cet enjeu : elle devait devenir la cheffe d’une union moderne et il s’agissait alors de convaincre les nouveaux dirigeants africains. La reine a accompagné l’évolution du Commonwealth vers l’organisation mondiale qu’elle est aujourd’hui. La préservation de cette « famille » comme l’appelait Elizabeth II sera l’œuvre de son règne.
Elisabeth II s’est rendue vingt et une fois en Afrique. Quel bilan tirer de ces voyages, sur le plan diplomatique et politique ?
En 1957, le Ghana indépendant devient membre du Commonwealth. Mais Accra est également attirée par le bloc de l’Est. La reine va jouer un rôle diplomatique extrêmement important pour maintenir le pays dans la « famille ». Lors de sa visite au Ghana en 1961, elle danse avec le président Kwame Nkrumah et se place sur un pied d’égalité avec un homme de couleur qui était peu de temps auparavant le ressortissant d’une colonie. Elle le fait à une époque où, en Afrique du Sud, l’apartheid se replie sur lui-même et où la ségrégation existe encore aux Etats-Unis.
Le Commonwealth, lui, devient multiracial. C’est à travers ses actes, qu’on devine les positions de la reine. Même si elle a souvent eu une action discrète, de l’ordre du symbole, une confiance s’est installée avec les pays africains et cela a fait d’elle une cheffe du Commonwealth légitime.
En 1979, elle se rend également au sommet de Lusaka contre l’avis de la première ministre de l’époque Margaret Thatcher et préside la signature de la déclaration contre le racisme et l’apartheid…
Le Commonwealth a eu un rôle de médiateur efficace au sujet des problèmes de discrimination raciale en Rhodésie, l’actuel Zimbabwe, dans les années 1970, tout comme dans la lutte contre l’apartheid dans les années 1980. Mais il est intéressant de souligner qu’en se rendant à Lusaka contre l’avis de son gouvernement, Elizabeth II a montré aux pays africains que, en tant que cheffe du Commonwealth, elle n’est pas seulement la monarque britannique, mais la représentante d’une union d’Etats souverains. Et qu’elle ne partage pas forcément les opinions du gouvernement de Londres.
Il y avait une ambivalence chez elle entre, d’une part, un côté très conservateur, une volonté de maintenir l’héritage de l’empire britannique et l’influence du Royaume-Uni sur le reste du monde et, de l’autre, un accompagnement de l’évolution du Commonwealth qui rassemble aujourd’hui cinquante-six pays, dont une vingtaine de pays africains souverains.
Comment la reine est-elle perçue dans les pays africains aujourd’hui ? Est-elle appréciée ou considérée comme une survivance du passé colonial ?
Les opinions sont sûrement contrastées et il est difficile de se prononcer là-dessus. Ce qui est certain, c’est qu’elle est respectée. Mais dans les années 2000, quand la question de sa succession s’est posée, puisqu’il faut rappeler que le titre de chef du Commonwealth n’est pas héréditaire, il y a eu des débats importants. Certains se demandaient s’il ne fallait pas un réel changement à la tête de l’organisation, afin de rompre avec l’image de la monarchie britannique et de l’ancien empire colonial. Mais on remarque que la reine a finalement réussi, en 2018, à imposer son fils comme successeur.
En 2009, le Rwanda, ancien protectorat belge, entre dans le Commonwealth. En 2022, c’est au tour du Gabon et du Togo, deux pays francophones. En quoi cette organisation est-elle attractive pour les pays africains aujourd’hui ?
L’organisation n’est pas puissante et n’a pas un budget important. Mais globalement, il y a une volonté de ces pays d’être connectés au monde anglophone, perçu comme dynamique économiquement. Le Commonwealth facilite la coopération économique, les échanges et les liens informels. Et puis, il agit comme une sorte de porte-voix pour des Etats marginalisés dans le système international, car il y a des moyens de faire entendre ses revendications au sein de l’organisation. Le Commonwealth garantit également la souveraineté des Etats, puisqu’il n’a pas d’organe supranational. Je pense que c’est un aspect important pour des pays qui ont été colonisés.
Certains de ces pays, comme le Rwanda, sont très critiqués pour leur bilan en termes de droits humains et de respect de l’Etat de droit. Leur participation à une organisation qui prône des valeurs démocratiques peut-elle être un facteur de fragilisation ?
Dans un contexte post-Brexit, marqué par la lutte contre le terrorisme et alors que l’Afrique devient un marché de plus en plus attractif, la question des droits de l’homme et la démocratie semblent en effet passer progressivement au second plan. Malgré les critiques sur le décalage entre ses idéaux et les actions de certains des pays qui la composent, le Commonwealth se recentre sur la coopération économique.
En 2013, la tenue du sommet des chefs d’Etat du Commonwealth au Sri Lanka, alors accusé de crimes de guerre dans la répression de la rébellion tamoule, avait provoqué une crise au sein de l’union. En 2022, le sommet au Rwanda, accusé de répression contre l’opposition et la liberté d’expression, n’a pas engendré le même type de réaction.
Diffusion partielle ou totale interdite sans la mention : Source www.kassataya.com