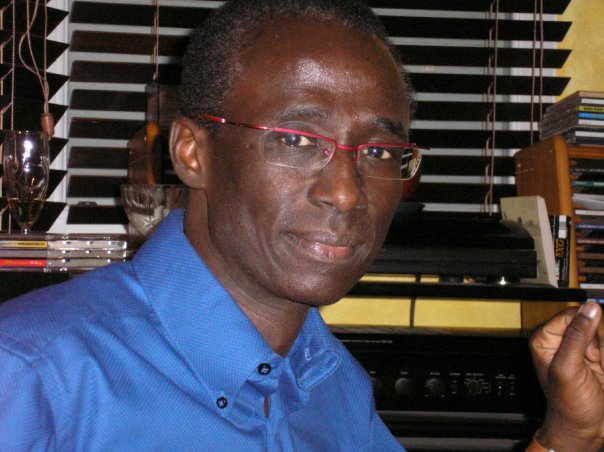
D’abord pardon pour la note personnelle. Je n’ai jamais été arrêté, emprisonné ou torturé. Je n’ai, à ce registre, aucun fait d’armes à faire valoir.
De l’exil, les principaux désagréments que j’ai connus sont ceux, à des degrés divers, propres à la moyenne des étudiants : les périodes des vaches maigres. Peu pour s’ériger en martyr. Cela me met à l’abri de tout soupçon de plaidoyer pro domo et me donne toute latitude pour évoquer une catégorie souvent injustement attaquée.
L’exilé est une figure récurrente du débat public. Il apparaît souvent sous le coup d’une accusation ou d’une volonté de disqualification, activant le procédé de l’«inversion accusatoire». Il est moins un persécuté qu’un planqué. A y regarder de près, on décèle que la mise en cause recèle un aveu implicite par le fameux : « ils ont fui et nous, nous sommes restés». Ils ont fui quoi au juste ? La réponse en creux pourrait être : ce que nous subissons. Tout n’irait donc pas pour le mieux dans le meilleur des mondes ?
Pointe dans le même temps une légère envie tenant souvent à la vie confortable prêtée aux exilés. Ne sont cités opportunément de ce fait que ceux vivant dans des pays confortables à vivre. Inopérant en l’occurrence, l’argument de l’exil n’est pour ainsi dire jamais opposé aux exilés (sur) vivant dans des camps de réfugiés par exemple.
Il faut en effet que l’exil apparaisse comme un choix d’agrément. D’où le Scud fréquent à l’occasion des débats et l’argument : je connais les réalités du pays avec le sous-entendu qu’il charrie.
Le caractère neutre, peu connoté, relativisé à d’autres notions, rend le maniement accusatoire du vocable exil plus aisé. Un exilé n’est pas nécessairement un réfugié ou un déporté. L’élément persécution physique ne lui est pas systématiquement associé.
La meilleure illustration de cette plasticité est l’exil fiscal. On pourrait néanmoins considérer le propos de l’universitaire Karen Akoka, affirmant: « il n’y a en réalité pas de réfugié en soi qui serait intrinsèquement différent du migrant».
Très souvent, l’exilé est aussi un réfugié. De facto ou en droit. On notera au passage que sa mise en cause a pour double la négation ou l’occultation de ce qu’il fut, subit et endura auparavant. Il n’existe qu’à partir de et après l’exil. Or nous connaissons tous des exilés, fustigés dans le débat public à ce titre, qui ont enduré au préalable la détention, les sévices, la confiscation, le licenciement…et dont ces désagréments ont déterminé le «départ ».
L’exil dont il s’agit s’entend de l’ «exil extérieur», le plus reconnu. Quid de l’autre? Autrice de Lettres à mon père, Leila Sebbar évoque durant la période coloniale «ces Algériens qui ont vécu l’exil le plus cruel, l’exil chez eux, dans leur pays perdu».
Cité dans le Monde diplomatique de juillet, un universitaire algérien d’aujourd’hui dit avoir «choisi une autre forme d’exil » que le départ, « le repli intérieur». «Le véritable exil n’est pas d’être arraché de son pays, c’est d’y vivre et de n’y plus rien trouver de ce qui le faisait aimer».
Tijane Bal
Facebook – Le 07 août 2022
Diffusion partielle ou totale interdite sans la mention : Source www.kassataya.com






