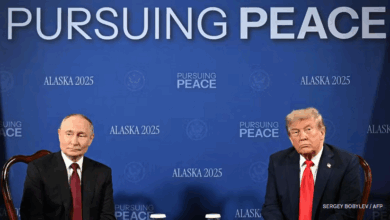Le Monde – Sur la planète, 40 % des terres sont désormais dégradées, ce qui affecte directement la moitié de l’humanité, alerte la Convention des Nations unies sur la lutte contre la désertification (UNCCD), dans un rapport publié mercredi 27 avril, Perspectives foncières mondiales (Global Land Outlook). Or, l’épuisement des sols est synonyme de pauvreté, de faim, d’émergence de zoonoses, de migrations et de conflits, exposent les auteurs de cette vaste évaluation, publiée en amont de la quinzième Conférence des parties (COP15) qui se tiendra à Abidjan, en Côte d’Ivoire, du 9 au 20 mai. La moitié du PIB mondial en est ainsi menacée, soit 44 000 milliards de dollars. Et la situation s’aggrave très rapidement : la précédente édition de ce rapport, publiée en 2017, évaluait à 25 % la part des sols dégradés, et à 3 milliards le nombre de personnes affectées.
« A aucun autre moment de l’histoire moderne, l’humanité n’a été confrontée à un tel éventail de risques et de dangers, familiers ou non », affirment les auteurs de l’UNCCD, la convention issue du sommet de Rio de 1992, aux côtés de celle sur les changements climatiques et de celle sur la diversité biologique. Soixante-dix pour cent des terres émergées de la planète ont déjà été transformées par l’homme, « provoquant une dégradation environnementale sans précédent et contribuant de manière significative au réchauffement climatique », assurent-ils.
Le rapport ne traite pas stricto sensu de l’avancée des déserts, mais de l’extension des espaces arides et des lieux qui deviennent invivables. Il révèle à quel point la dévastation des écosystèmes et l’instabilité sociale et économique sont liées et peuvent se lire dans le mauvais état des sols. Ceux-ci ne retiennent plus l’humidité, tandis que la fertilité des parcelles agricoles baisse, que les feux se multiplient et que l’érosion et les tempêtes de sable s’intensifient. De surcroît, la déforestation et, plus largement, la perte de végétalisation réduisent le captage du CO₂, ce qui accélère le dérèglement du climat. Cependant, les experts recensent aussi des dizaines de réponses à la dégradation de la nature, mises en œuvre un peu partout dans le monde, souvent avec succès.
L’agriculture moderne en cause
Urbanisation et bétonisation galopantes, industries d’extraction, les causes de dégradation sont multiples, mais la principale responsable est explicitement désignée : l’agriculture moderne. Ce secteur, qui consomme 70 % de l’eau prélevée dans le monde, « a altéré le visage de la planète plus que n’importe quelle autre activité humaine », constatent les rapporteurs. Les modèles de monoculture intensive dopée aux intrants chimiques dévorent les espaces naturels et constituent la première cause du déclin de la biodiversité. Entre 2013 et 2019, 70 % des forêts défrichées l’ont été pour les cultures et l’élevage, en violation des lois ou des règlements nationaux.
Au rythme actuel, 16 millions de kilomètres carrés seront en mauvais état d’ici à 2050, soit la taille de l’Amérique du Sud. Et la situation empire rapidement. Ibrahim Thiaw, secrétaire exécutif de l’UNCCD, insiste sur la nécessité de nourrir prochainement 9 milliards d’habitants, tout en dégradant moins. « Tout le monde comprend que nous fonçons dans le mur, prévient-il. Il faut changer de direction, transformer fondamentalement nos modes de production et de consommation. Notre système alimentaire est responsable de 80 % de la déforestation, il faut le repenser. »
« Restaurer les terres n’est pas un problème, c’est la solution à de multiples crises, sociales et environnementales », observe Ibrahim Thiaw
L’organisation onusienne avance une réponse stratégique simple à résumer : restaurer les sols et protéger les espaces naturels. Rien d’impossible à cela : les rapporteurs écrivent qu’investir 1 600 milliards de dollars au cours de cette décennie permettrait de réhabiliter un milliard d’hectares abîmés, dont 250 000 hectares de fermes, de forêts et de pâtures. Une somme à mettre en regard des 700 milliards de dollars versés chaque année aux secteurs des combustibles fossiles, à l’agriculture et la pêche.
Ibrahim Thiaw suggère aux gouvernements de réduire leurs subventions néfastes. Son message s’adresse en particulier aux 115 Etats qui se sont collectivement engagés à restaurer un milliard d’hectares – la taille de la Chine ou des Etats-Unis – d’ici à 2030. Le secteur privé et la société civile sont priés de se mobiliser aussi. « Restaurer les terres n’est pas un problème, c’est la solution à de multiples crises, sociales et environnementales, assure le secrétaire exécutif. C’est même la réponse la moins chère pour l’atténuation et l’adaptation au changement climatique », plaide-t-il. Il rappelle que, dans la Corne de l’Afrique, beaucoup de gens succombent à cause de la faim aujourd’hui, que même les chameaux meurent de soif par endroits. « On a du mal à mesurer les conséquences de long terme des sécheresses sévères. Elles parviennent à déstructurer des sociétés, font fuir les gens vers les villes, témoigne Ibrahim Thiaw, qui est originaire de Mauritanie. Moi j’en ai vécu une quand j’avais 12 ans, elle a emporté ma mère qui en avait 30. »
« Nous devons arrêter de discuter en silos, de l’eau d’une part, de l’élevage, des gaz à effet de serre d’autre part, avance Ibrahim Thiaw. Ce n’est pas efficace, et les approches divergent souvent entre les ministres de l’agriculture et ceux chargés de la biodiversité et du climat, y compris dans les pays développés. »
Trois scénarios d’évolution
Cette deuxième édition des Perspectives foncières mondiales présente trois scénarios d’évolution d’ici à 2050. Le premier, le « business as usual », conduirait, entre autres, à des conséquences désastreuses, à « un déclin persistant, de long terme, de la productivité végétale pour 12 % à 14 % des terres agricoles, des pâturages et des espaces naturels ». L’Afrique subsaharienne serait la plus affectée, notent les rapporteurs. La deuxième option consisterait à restaurer environ 50 millions de kilomètres carrés(35 % de la surface terrestre mondiale). Le Proche-Orient, l’Afrique du Nord et subsaharienne ainsi que l’Amérique latine seraient les principaux gagnants de l’amélioration des rendements. Mais cela ne suffirait pas à arrêter la perte de biodiversité, juste à la faire baisser 11 %.
Enfin, dans le dernier scénario, la moitié des terres émergées seraient restaurées, tout en prenant de surcroît des mesures pour protéger 4 millions de kilomètres carrés d’espaces importants pour la vie des espèces, la régulation de l’eau, le stockage du carbone. Il s’agit de prévenir les dégradations dues à l’exploitation des forêts, le brûlage, le drainage et l’assèchement, ainsi que la conversion des sols. Dans ces conditions, les rendements pourraient s’améliorer de 9 % par rapport aux résultats actuels, sans pour autant empêcher partout la hausse des prix des denrées alimentaires.
La vingtaine d’organisations (agences onusiennes, Convention sur la diversité biologique, Centre de recherche forestière internationale…) qui a contribué à la rédaction du rapport de l’UNCCD a recensé des dizaines d’expériences d’agriculture régénératrice, d’un retour à des variétés de semences traditionnelles plus résistantes, de réhabilitation de terres agricoles dégradées et abandonnées – elles représentent actuellement entre 3,9 et 4,7 millions de kilomètres carrés.
Source : Le Monde
Diffusion partielle ou totale interdite sans la mention : Source www.kassataya.com