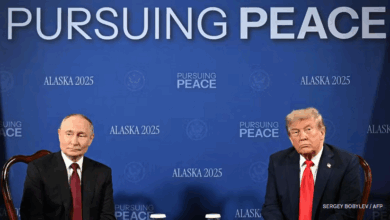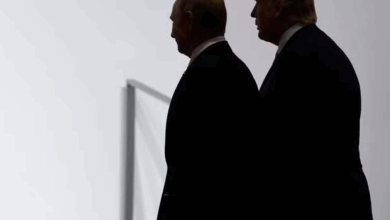Le Monde – L’Elysée a tenu à préciser que « le lieu du sommet avait été choisi avant le déclenchement de la guerre ». Il n’empêche, le symbole n’en est pas moins notable. Car c’est au château de Versailles, là même où les chefs d’Etat et de gouvernement européens se réunissaient jeudi 10 et vendredi 11 mars pour faire face à l’offensive russe en Ukraine, qu’Emmanuel Macron avait reçu Vladimir Poutine, en grande pompe, le 29 mai 2017. A l’époque, le président français, tout juste élu, espérait relancer une relation avec Moscou mise à mal par l’annexion de la Crimée trois ans plus tôt, la déstabilisation de l’est de l’Ukraine, puis par l’engagement militaire russe aux côtés de Damas.
En accueillant ses homologues européens, près de cinq ans après, Emmanuel Macron s’est sans doute souvenu de ces débuts avec le président russe et a pu mesurer les défis posés par l’invasion de l’Ukraine. Entre l’échange dans le cabinet d’angle de Madame Victoire avec le maître du Kremlin et le dîner avec les Vingt-Sept dans la galerie des Glaces, le monde a basculé dans une nouvelle ère, et les Européens aussi. « Ce sommet est très important, car il arrive en pleine guerre et que nous devons prendre des décisions fortes. Ces décisions, nous devons les prendre dans les jours, les semaines qui viennent », a dit le chef de l’Etat. La soirée de jeudi tout entière et une partie de la nuit ont été consacrées au conflit et aux multiples questions qu’il pose.
L’enjeu est stratégique pour les Européens. Alors que le conflit déclenché par Vladimir Poutine menace de durer et de déstabiliser l’ensemble du continent, la question est de savoir comment peser sur le cours des événements et inciter le président russe à accepter un cessez-le-feu, même si cette perspective s’éloigne, comme l’a reconnu M. Macron. Dans le même temps, les Européens ont souligné leur volonté d’aider le président ukrainien, Volodymyr Zelensky, sans pour autant, à l’issue de vifs débats entre l’est et l’ouest du continent, soutenir sa demande d’adhésion « sans délai » à l’UE.
Pas de consensus pour un blocus
A l’instar des Etats-Unis, les Vingt-Sept ne veulent pas entrer en guerre contre la Russie. Dès lors, il leur reste, en plus du matériel militaire livré à Kiev, le levier des sanctions économiques. Sur ce point, ils se félicitent d’avoir adopté dans l’urgence, en concertation avec Washington, des représailles massives, dont l’effet se fait déjà sentir sur l’économie et sur l’Etat russe : le rouble a perdu plus de 75 % de sa valeur depuis le 24 février, J.P. Morgan annonce une chute du PIB de 35 % au deuxième semestre, les entreprises étrangères quittent la Russie les unes après les autres, Moscou est au bord du défaut de paiement.
Jeudi, les Européens ont examiné de nouvelles représailles, en prévision d’une intensification des combats. Les Etats baltes et la Pologne ont plaidé en faveur d’un embargo sur les hydrocarbures russes. « Si nous cessons les achats à la Russie, cela arrêtera le financement de la machine militaire russe. Si l’on ne renforce pas les sanctions maintenant, alors quand ? », a lancé le premier ministre letton, Arturs Krisjanis Karins. Avant d’ajouter : « Il nous faut arrêter d’importer de l’énergie russe afin de ramener Poutine à la table des négociations. » « Les Ukrainiens payent de leur sang » les importations européennes de pétrole et de gaz russes, a renchéri un diplomate polonais.
A l’inverse, l’Allemagne et l’Italie, très dépendantes du gaz russe, ont pris leur distance avec un éventuel embargo. La Hongrie aussi. « Tout en condamnant l’offensive militaire russe et tout en condamnant aussi la guerre, nous ne permettrons pas que les familles hongroises en paient le prix », a déclaré le premier ministre hongrois, Viktor Orban.
Faute de consensus sur le blocus énergétique, les Vingt-Sept ont convenu, en revanche, qu’il leur fallait réduire sans attendre leur dépendance aux hydrocarbures russes. Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission, a même suggéré de s’en passer totalement d’ici à 2027, sans convaincre l’ensemble des Etats membres. Autre proposition controversée, l’exécutif communautaire propose que la dépendance de l’UE aux hydrocarbures russes soit réduite des deux tiers d’ici à la fin de l’année. « La question est de savoir si la Russie va utiliser l’arme du gaz : nous devons nous préparer à tous les scénarios », a jugé Emmanuel Macron.
Plan de résilience
Varsovie a, une nouvelle fois, tenté de faire revenir ses partenaires sur leur agenda climatique, censé leur permettre d’atteindre la neutralité carbone à l’horizon 2050 mais qui s’avère particulièrement difficile pour ce pays à l’économie très consommatrice de charbon. Jeudi soir, Mateusz Morawiecki a fait d’autant plus valoir ses arguments que la Pologne a accueilli plus d’un million de réfugiés ukrainiens en deux semaines : il espère obtenir des concessions des Européens, tant sur les sujets climatiques que sur le plan de relance européen dont Bruxelles lui refuse le bénéfice en raison du contentieux sur l’Etat de droit.
Au-delà du cas ukrainien, les Vingt-Sept ont également souhaité, à la demande d’Emmanuel Macron, évoquer les « dépendances » qu’ils subissent et que cette guerre a rendues encore plus visibles. L’énergie, donc, mais aussi la défense, l’agriculture et les semi-conducteurs. Le président français, qui a fait de la souveraineté européenne son mantra lors de son quinquennat, espère profiter de cette crise pour faire avancer encore ses idées.
Il s’agit de « construire la souveraineté de notre Europe pour résister », a lancé Emmanuel Macron. En plus des sanctions qui ne manqueront pas de peser sur les économies européennes, ce programme suppose des investissements qu’il va falloir financer et qui, à ce stade, sont loin de faire l’unanimité.
Dans ce contexte, Paris presse discrètement ses partenaires de mettre sur pied un plan de résilience européen, qui serait financé par un endettement commun, à l’instar du plan de relance de 750 milliards d’euros mis en place en pleine pandémie de Covid-19. Sans succès, pour l’instant. « Ce n’est pas sur la table », affirme Mark Rutte, le premier ministre néerlandais. Berlin ne cache pas non plus ses réticences. « Tous les quinze jours, Paris vient avec une idée de plan de relance 2.0. C’est comme un disque rayé », s’exaspère un diplomate d’un pays du Nord.
Les Pays-Bas, comme l’Allemagne, le Danemark et la Finlande, font valoir que le plan de relance européen et le budget communautaire offrent encore des possibilités de « 500 milliards d’euros », sans avoir à créer de nouvel instrument. « Ce n’est pas la peine de se précipiter pour acheter des nouvelles chaussures quand on a déjà de bonnes chaussures dans le placard », résume un autre diplomate.
Source : Le Monde
Diffusion partielle ou totale interdite sans la mention : Source www.kassataya.com