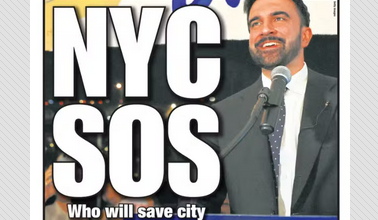Info Migrants – À leur arrivée en France, la plupart des demandeurs d’asile sont accompagnés dans leur démarches administratives, médicales ou sociales, par des interprètes. Ces hommes et femmes sont chargés de traduire le plus fidèlement possible la parole des exilés. L’enjeu est immense. Leurs erreurs ou approximations de traduction font courir le risque aux requérants d’être déboutés.
Ce sont des histoires de drames évités de justesse ou de destins qui basculent pour un mot mal interprété. Dans les procédures de demande d’asile, la plupart des récits sont passés au filtre de la traduction. Chargés de restituer le plus fidèlement possible les propos des candidats à l’asile, sans prendre parti, les interprètes sont leur voix dans une langue étrangère. Si une bonne traduction donne toutes ses chances à un demandeur d’asile d’obtenir une protection, à l’inverse, des erreurs et approximations peuvent le condamner.
Ousmane* a obtenu la protection subsidiaire en France mais a failli être débouté à cause d’une erreur de traduction du bambara vers le français. Sa demande de protection rejetée à l’issue de son entretien à l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (Ofpra), le jeune Malien a fait appel devant la Cour nationale du droit d’asile (CNDA). Face aux juges, il explique les menaces qui pesaient sur lui pendant son service militaire et sa fuite précipitée du commissariat où il vivait, puis du Mali.
« Pendant l’audience, à un moment de mon récit, j’ai dit ‘moi’, en bambara, et l’interprète a traduit ‘nous’, comme si on était plusieurs. J’ai réagi parce que ça n’allait pas. Même le président a compris qu’il y avait un problème. Il m’a demandé : ‘Vous étiez seul ou plusieurs ?’. Donc après, j’ai répondu à toutes les questions en français. »
« Moi » ou « nous ». L’erreur peut sembler minime mais, dans une procédure de demande d’asile, chaque détail compte et peut faire pencher la décision des juges, ou des officiers de protection, dans un sens ou dans l’autre.
Orienter la décision
Marie-Caroline Saglio-Yatzimirsky, anthropologue et responsable des consultations de psycho-traumatisme à l’hôpital Avicenne de Bobigny, accompagne régulièrement des demandeurs d’asile dans leurs démarches auprès de la CNDA. Bonne connaisseuse des parcours que traversent certains exilés, elle mesure toute l’importance de la traduction.
« C’est vraiment impressionnant de voir à quel point l’interprète, selon qu’il ne traduit pas un élément ou qu’il oriente, à un mot près, la réponse [du demandeur], peut changer complètement l’orientation de la décision [des juges], constate-t-elle. Récemment, j’ai eu le cas de figure d’une femme arrivée d’Angola avec ses enfants qui avaient été blessés. Elle avait tout pour être protégée et, vraiment, l’interprète ne traduisait pas bien les questions, ni les réponses, à la CNDA. On est passé pas loin de la catastrophe. »
Pour certains demandeurs d’asile, le choix de la langue dans laquelle ils s’expriment est, en lui-même, un élément de défense de leur demande d’asile.
Kutub Uddin est membre de la minorité rohingya, persécutée en Birmanie. Pour son entretien à l’Opfra, en juin 2021, le jeune homme avait demandé un interprète en langue rohingya mais s’est vu attribuer une interprète bengalie. « J’ai vécu deux ans au Bangladesh donc je comprends un petit peu mais je ne peux pas m’exprimer correctement dans cette langue, explique le jeune homme à InfoMigrants […] J’ai essayé de dire à l’officier que je ne comprenais pas bien l’interprète mais il m’a dit de continuer. J’ai poursuivi l’entretien et, environ deux semaines plus tard, j’ai reçu une lettre de l’Ofpra m’informant que la décision était défavorable. La raison, selon l’officier, était que je n’étais pas un Rohingya et que j’étais bangladais car je comprenais et parlais un peu le bengali. »
« Il y a un problème, il faut changer d’interprète »
Aude Rimailho, avocate qui intervient régulièrement auprès de demandeurs d’asile, a, elle aussi, déjà eu des sueurs froides pour ses clients en raison d’une mauvaise traduction. Elle rapporte à InfoMigrants le cas d’un entretien à l’Ofpra où le demandeur d’asile « répondait aux questions de l’officier de protection par de longues phrases de 5-10 minutes mais l’interprète synthétisait tout en une phrase ». « Ça s’est répété à plusieurs reprises, au point que l’officier a fait un commentaire à l’interprète », se souvient l’avocate.
« Ayant déjà travaillé avec cette personne, je voyais qu’il y avait des choses qui n’étaient pas traduites et que ce n’était pas exactement ça qu’il voulait dire. Et c’était un dossier qui comportait des risques de refus, clairement, raconte-t-elle. À un moment, j’ai dû mettre un terme à l’entretien. J’ai dit : ‘Il y a un problème, il faut changer d’interprète’. »
Pour l’avocate, ce sont les manques de connaissances juridiques et politiques de certains interprètes qui risquent de pénaliser le plus les demandeurs d’asile.
Dans le cas de l’entretien évoqué précédemment, l’échange se fait en langue turque et la question de la « cause kurde » est évoquée (un conflit oppose depuis les années 1980 le gouvernement turc aux Kurdes du Kurdistan turc. Plus de 40 000 personnes y ont perdu la vie et de très nombreuses violations des droits humains, perpétrées par le pouvoir turc et le parti indépendantiste kurde PKK, ont été recensées). « L »interprète a dit : ‘Qu’est-ce que c’est que la cause kurde ?’. Donc on part de loin… », souffle Aude Rimailho.
L’avocate reconnaît malgré tout que, dans l’ensemble, parmi les nationalités qu’elle a l’habitude de défendre, « les interprètes veillent à ce que le demandeur d’asile ait bien compris la question ». « On voit parfois qu’il y a une conversation entre eux pour qu’il y ait une bonne compréhension de ce que la personne veut dire. En fait, quand il y a un vrai problème de compréhension avec l’interprète, on le voit, on le sent », explique-t-elle.
L’avocate souligne aussi qu’en cas de refus de la demande de protection, c’est toujours l’interprète qui est accusé par le demandeur d’avoir trahi ses propos. « Ils ne se reconnaissent jamais responsables de leur mauvaise prestation, pour eux, c’est toujours l’interprète qui a mal traduit, donc il faut aussi faire le tri dans ces accusations « , nuance-t-elle.
« Traduire des récits douloureux »
Les vrais manquements à l’éthique existent aussi. Aman a fait, en 2013, les frais d’un interprète trop intrusif. À l’époque, cet Érythréen, aujourd’hui âgé de 30 ans et qui ne souhaite pas que son nom de famille soit publié, dépose une demande d’asile aux Pays-Bas alors qu’il est dubliné en Italie.
« J’ai expliqué que je ne voulais pas y retourner parce que j’étais maltraité en Italie mais ma demande d’asile a été rejetée par l’IND, l’équivalent néerlandais de l’Ofpra. J’ai alors fait un recours devant l’équivalent de la CNDA aux Pays Bas, explique-t-il. Là, mon interprète m’a dit qu’il fallait que je dise certaines choses en particulier, que ça serait mieux pour moi. J’ai refusé de changer mon récit mais l’interprète n’a pas traduit ce que j’ai déclaré. Le juge a réagi en disant : ‘Vous avez menti monsieur : au début, vous aviez dit que vous ne vouliez pas retourner en Italie parce que vous y étiez maltraité et maintenant vous dites autre chose’. »
Suggestion kassataya.com :
Source : Info Migrants (Le 11 février 2022)
Diffusion partielle ou totale interdite sans la mention : Source www.kassataya.com